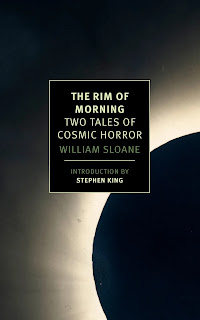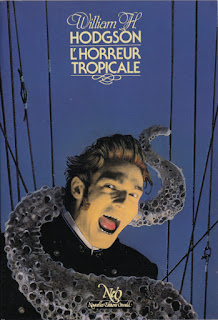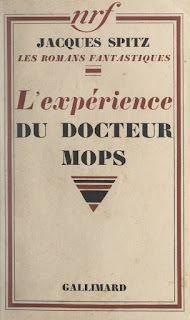mardi 31 décembre 2019
The Edge of Running Water - William Sloane (The Rim of Morning)
The Edge of Running Water partage en gros les mêmes thèmes et la même forme que l'autre roman de William Sloane, To Walk the Night. C'est plus ou moins un huit-clos qui prend le temps de développer les tensions entre les personnage et qui cache derrière son murder mystery un fond d'horreur cosmique, comme l'annonce fièrement la couverture de cette édition.
La narrateur va rejoindre un vieil ami à lui, un scientifique brisé par le décès de sa femme qui s'entête à percer le voile de la mort, dans un coin paumé du Maine. Il se retrouve à devoir gérer une jolie jeune fille (au cours d'une amourette vaguement gênante), son ami perturbé (syndrome classique du savant qui ne sait pas où s'arrêter), une femme médium étrange et coriace (élément perturbateur et malaise face à la féminité non conventionnelle) et une bourgade pleine de gens xénophobes et potentiellement amateurs de lynchages. La trame fonctionne très bien grâce au talent littéraire de Sloane : on navigue entre les genres, mais la prose reste élégante, efficace. J'ai craint un moment qu'il allait retomber sur une banale histoire de fantômes, mais heureusement ce n'est pas le cas. S'il y a bien, d'une certaine façon, un aperçu d'un autre monde, ce n'est pas un au-delà classique, loin de là. Ce sont les personnages qui projettent leurs désirs là où, finalement, il n'y a littéralement rien. Cependant j'aurais aimé que Sloane soit un poil plus clair sur ce sujet : qu'est-ce que la médium pouvait distinguer là-dedans ? Mais le fait est que quand le voile est levé, quand le monde les "âmes" est révélé, il n'y a rien d'autre qu'un chaos aveugle et dévastateur. C'est là le point fort du récit : les humains n'acceptent pas le néant et s’efforcent de le remplir par leurs fantasmes d'importance et leur besoin de causalité.
samedi 28 décembre 2019
Je suis Providence (t.1) - S.T. Joshi
Je n'ai pas pour habitude de lire des biographies, et pourtant, c'est la deuxième biographie de Lovecraft que je m'aventure à fréquenter (c'est dire l’attrait quasi obsessionnel que déclenche le personnage chez une certaine frange plus ou moins marginale de la population dont je fais apparemment partie). La première était celle de Houellebecq, il y a longtemps, qui, si je me souviens bien, parlait indirectement plus de Houellebecq que de Lovecraft. Le pavé de S.T. Joshi est autrement plus sérieux (et massif : 700 pages pour ce premier tome). J’apprécie l'introduction qui prend la peine de mentionner les divers choix de traduction, bien que l'indéniable qualité de la traduction soit entachée par une impressionnante quantité de coquilles et de fautes.
S.T. Joshi va dans les détails, c'est le moins qu'on puisse dire, et si j'ai parfois survolé quelques passages, le plaisir de lecture est incontestablement là. Je reprocherais peut-être à Joshi une certaine tendance à taper sur les doigts de Lovecraft à propos de ses opinions les plus douteuses, son racisme notamment. Et si on comprend bien le désir du biographe de se détacher ainsi de certains aspects de Lovecraft, on aimerait que nous soient épargnées ces leçons de morale basique. Ce premier tome commence par la famille de Lovecraft, explore son enfance, sa précocité intellectuelle, son adolescence (si le mot est adapté) solitaire, sa passion pour le journalisme amateur, ses nourritures littéraires et philosophiques, ses premières gloires d'écrivain et la première moitié de son mariage avec Sonia à New York.
Je ne vais pas citer Joshi, mais surtout Lovecraft. Ainsi, une auto-analyse de ses intérêts : « a) Amour de l'étrange et du fantastique. b) Amour de la vérité abstraite et de la logique scientifique. c) Amour de l'ancien et du permanent. Les diverses combinaisons de ces trois tendances expliqueront sans doute tous mes goûts étranges et mes excentricités. » (1920) En effet, ces trois idées se contredisent partiellement : ainsi Lovecraft a bien conscience de l'unité discutable que constitue une personnalité, à commencer par la sienne.
Dès son enfance (12, 13 ans) il lit énormément de science et écrit de nombreux essais d'astronomie ou de chimie. Il va jusqu'à écrire et imprimer lui-même des dizaines de journaux amateurs divers. Un petit exemple de ce qu'il écrit à 13 ans, à propos des canaux de la lune : « Concernant la théorie du professeur Pickering, à savoir qu'ils constituent des traces de végétation, je dois dire que n'importe quel astronome intelligent considérerait cette remarque comme indigne d'être relevée. »
Son rapport au catéchisme :
J'avais 12 ans et cette institution me désespérait. Aucune des réponses de mes pieux précepteurs ne me satisfaisait, et je le irritais à force de réclamer qu'ils cessent de prendre les choses pour acquises. Le raisonnement était quelque chose de fondamentalement nouveau dans leur petite mythologie sémite. Finalement, je me suis aperçu qu'ils étaient prisonniers de traditions et d'un dogme infondés, et j'ai alors cessé de les prendre au sérieux. (1920)L'apport de l'astronomie :
À 13 ans, j'étais complètement convaincu de la futilité et de l'insignifiance de l'homme, et à 17 ans, à l'époque où j'écrivis des textes particulièrement détaillés sur le sujet, je possédais, pour l'essentiel, les vues pessimistes sur le cosmos qui sont miennes à présent. La futilité de toute existence commença à m'oppresser et à m'accabler et je montrai de moins en moins d'enthousiasme et d'espérance vis-à-vis du progrès humain.Une petite phrase de Joshi que j’apprécie, à propos de la SF comparée au fantastique : « Dagon lui-même peut être considéré comme de la proto-science-fiction car le phénomène de l'intrigue étend étend nos compréhensions de la réalité plus qu'il ne les défie. » (p.338)
Mentionnons la folie (relative) des deux parents de Lovecraft. Son père qui finit dans un asile et sa mère à la fin pas si différente. Dans un passage frappant, une voisine décrit la mère de Lovecraft comme évoquant « des créatures étranges et fantastiques qui surgissaient de derrière les immeubles et des recoins à la nuit tombée ».
Sur sa position artistique : « Le rapport de l'homme avec lui-même ne me captive pas. C'est sa relation au cosmos - à l'inconnu - qui seul parvient à enflammer mon imagination créative. La pose authropocentrée m'est impossible, car je ne puis acquérir la myopie primitive qui magnifie la terre et ignore l'arrière-plan. » Mais pourtant, dans la perspective cosmissiste d'un univers indifférent, que reste-t-il à part le rapport de l'homme à lui-même ?
Aussi, je n'avais pas pleinement réalisé ce que Lovecraft doit à la philosophie antique (notamment les épicuriens, Lucrèce), à Schopenhauer et surtout à Nietzsche (notamment ici : « Si un acte correspond à nos désirs, c'est la nature à travers nous qui a formulé ce désir, et assuré son accomplissement. »). Et un extrait où on croirait lire les stoïciens : « Dans la perspective de l'infinité cosmique, la victoire d'un enfant aux billes n'a rien à envier à celle d'Octave à Actium. » Plus loin : « Quelle importance si personne n'entend jamais parler du fruit de mon travail, ou si ce travail n'affecte que les médiocres et les affligés ? Il est sans aucun doute important d'offrir à ces malheureux le plus de bonheur possible ; et celui qui se montre gentil, serviable et patient avec ses frères de misère ajoute autant de capital de sérénité du monde que celui qui, doué de plus grandes facultés, promeut la naissance d'empires, ou fait avancer le savoir de la civilisation et de l'humanité. » Une idée qui prend particulièrement sens quand on considère l'opinion de Lovecraft que l'humanité ne va nulle part en particulier sinon vers sa propre fin ; ainsi la notion de progrès devient quasi absurde.
Pour conclure ce premier tome, peut-être le passage de plus drôle : quand, à New York, un ami de Lovecraft veut lui donner le job de rédacteur en chef de... Magazine of Fun !
Libellés :
Je suis Providence,
Joshi S.T.,
Lettres,
Lovecraft H.P.,
Philosophie
vendredi 20 décembre 2019
Hommage to Catalonia - George Orwell
Dans Homage to Catalonia (1938) Orwell évoque son expérience personnelle au cours de la guerre civile espagnole (qui n'était pas encore terminée à la publication du livre). Un peu comme en lisant l'excellent Dans la dèche à Paris et à Londres (1933) et, dans une moindre mesure (c'est un roman partiellement autobiographique), Burmese Days (1934), on est étonné par l'aventurisme nonchalant d'Orwell. Il a envie de combattre le fascisme et d'écrire quelques articles, alors il va en Espagne, directement au front. Au moins, il accorde ses actes à ses opinions. On ne peut que respecter cette sincérité, bien que j'ai un peu grincé des dents à certains passages : après tout, il va faire la guerre. Il va tuer.
Le début est un peu pénible. Le lecteur est plongé dans le vif du sujet sans guère de contexte et mieux vaut prendre le temps de faire quelques passages sur Wikipédia. Orwell est au front, c'est un récit de guerre un peu vide dans lequel on met du temps à comprendre les enjeux. C'est un conflit absurde, où les miliciens, faute d'équipement, ne font pas grand chose d'autre que manger leurs rations, accumuler des poux, grelotter vainement et se prendre des balles perdues. On est frappé par l'union entre anarchistes et communistes qui luttent contre Franco et le fascisme. Dans le feu de l'action, l'utopie socialiste semble presque réalisée, officiers et soldats sont frères, le mot camarade a vraiment du sens. Mais, une fois qu'Orwell revient à Barcelone, cette belle union tombe en morceaux : elle est réservée aux honnêtes combattants, mais dans les grandes villes, on s'étripe idéologiquement. Orwell est traqué, en tant que membre d'une faction soudainement jugée « trotskiste ». L'URSS œuvre dans l'ombre pour empêcher une révolution espagnole qui risque fort de ne pas mimer le stalinisme et qui affaiblirait les alliés de l'URSS, et finalement les anarchistes et les socialistes authentiques, ceux qui ont combattu, les hommes du peuple, se retrouvent pris entre les étaux de la démocratie capitaliste, de l'URSS monolithique et du fascisme lui aussi capitaliste. Face à toutes ces forces, les révolutionnaires sont trompés, décriés et finalement écrasés à grand coup de propagande. On voit là ce qui a nourri 1984 : la force arbitraire des superpuissances, la destruction de la vérité au profit de l’intérêt des dites puissances et la négation de la valeur de la vie humaine individuelle.
Mentionnons aussi l’imperturbabilité peut-être typiquement anglaise d'Orwell. Ainsi, quand il se prend une balle : « The whole experience of being hit by a bullet is very interesting and I think it is worth describing in details. » Une autre anecdote croustillante : quand la police fouille la chambre d'hôtel de sa femme façon Gestapo. Ils tombent sur Mein Kampf, ce qu'ils prennent comme un aveu de fascisme, mais ils sont ensuite apaisés quand ils trouvent un pamphlet de Staline sur la façon dont il convient de liquider les trotskistes. En somme, un bouquin important pour mieux comprendre l'Europe et plus précisément la partie sanglante mais souvent négligée de son histoire. J'ai envie de conclure en mentionnant d'autres livres lus récemment qui ont le même effet : We The Living, d'Ayn Rand, à propos de la vie dans la jeune URSS (un roman particulièrement brillant), The Cellist of Sarajevo, sur le siège de la capitale, et Girl at War, sur plus globalement la guerre de Yougoslavie.
Libellés :
Essais,
Orwell George,
Récits de voyage/survie/guerre,
Société,
Univers réaliste
dimanche 15 décembre 2019
Dark Gods - T.E.D. Klein
T.E.D. Klein a fait sa thèse sur Lovecraft, qui est décidément incontournable. Klein n'a que peu écrit et Dark Gods, publié en 1985, regroupe quatre grosses nouvelles. L'ensemble mérite le coup d’œil : Klein sait écrire et sa grande force se trouve souvent dans l'étoffement de ses personnages.
La première nouvelle, Petey, se déroule dans un cadre classique : un grande maison un peu sinistre dans un endroit paumé. Mais ce cadre est utilisé d'une façon inventive : les propriétaires donnent une soirée avec une trentaine de personnes, essentiellement des couples plus qu'aisés dont les hommes travaillent dans la finance et les femmes s'occupent de décoration intérieure. Klein arrive à donner rapidement de la personnalité à sa nuée de personnages, et on apprend notamment, au bout d'un moment, que les heureux propriétaires ont acquis leur bâtisse d'une façon peu honorable. L'ancien propriétaire était un homme bizarre. Toute la nouvelle est en fait une longue accumulation d'indices qui laissent entrevoir le dénouement sanglant, et le lecteur ne manque pas de sourire, car il voir ce à quoi les personnages restent aveugles. La technique est maniée avec doigté : au bout d'un moment, l'accumulation de signes annonciateurs devient si colossale, si ridiculement évidente, que j'en suis venu à me dire que l'auteur ne pouvait se permettre une telle libéralité que s'il faisait une fin très ouverte. Avec une telle tonne d'indices, toute conclusion sanglante ne pourrait être qu'évidente et plate. Et j'avais bien vu : la fin est en queue de poisson. Ainsi la nouvelle dépasse son postulat classique de maison hantée par un monstre grâce à une forme narrative plus recherchée.
Si Petey était une entrée en matière tout à fait sympathique, le niveau monte d'un cran avec Children of the Kingdom. Dans un New York qui suinte la misère, la violence et la peur, la narrateur cherche une maison de retraite appropriée pour son grand-père. Le grand-père s'adapte sans souci à sa nouvelle vie et, malgré le caractère peu fréquentable du quartier, il passe ses journées à l'extérieur à papoter avec une mama noire et un vieux latino qui se prétend prêtre et a écrit un obscur bouquin révisionniste sur les origines de l'homme. Il défend l'existence d'une autre race, maudite par Dieu, qui aurait chassé les hommes originels de l’éden. En parallèle, des événement étranges se produisent dans la mégalopole. Il y a des rumeurs sur d'étranges hommes à la peau pâle, sans visage, qui malgré leur absence de sexe humain rôdent à la recherche de femmes vulnérables. On le devine, ces deux trames vont se rejoindre jusqu'à ce que le narrateur dévoile juste assez de la sombre vérité pour avoir certainement des nuits blanches pendant le reste de sa vie. Déjà, Klein accroche facilement avec sa narration, ses personnages vivants et même pétillants. L'horreur s'insinue par petites touches, progressivement. Il joue énormément sur les peurs raciales, comme Lovecraft, mais aussi sur les peurs sexuelles, en parvenant à ne jamais tomber dans le glauque gratuit. C'est une métaphore de la promiscuité et de la misère d'une mégalopole où l'étranger, l'agresseur, le violeur, le décadent, prend une forme véritablement monstrueuse. Habile et prenant, la meilleure nouvelle des quatre.
Black Man with a Horn est presque une conversation avec Lovecraft. Le narrateur est un vieil écrivain qui se désole que son œuvre n'existe que dans l'ombre du reclus de Providence, et le texte lui est adressé. La narrateur se retrouve plongé dans ce qui ressemble à un récit de Lovecraft quand l'homme assis à côté de lui dans un avion, un missionnaire, lui raconte ce qu'il a vécu dans un coin reculé d'Afrique. Ensuite la trame s'épaissit, tout en restant très floue, et le narrateur fait beaucoup de recherches en bibliothèque. Classique. La partie, disons, horrifique de cette nouvelle est un peu décevante tant on reste dans l'évasif, mais la trame plus personnelle, la personnalité du narrateur et le thème de la création littéraire lui donnent néanmoins une épaisseur appréciable.
C'est un peu la même chose avec Nadelman's God : un récit très prenant mais qui déçoit un peu sur la partie horreur. Nadleman est toute la définition du succès : un boulot dans la pub, un bon appart à New York, une femme et une amante... Mais un beau jour, un groupe de rock utilise un poème fantastique qu'il avait écrit à seize ans et un type étrange commence à être obsédé par ses vers. Le petites habitudes de Nadleman se font lentement chambouler et il doit replonger dans son adolescence, quand il avait encore des ambitions créatives, peut-être un peu naïves. Le rapport au harceleur est excellent, mais je suis moins convaincu par l'espèce de monstre.
Libellés :
Fantastique,
Klein T.E.D.,
Littérature,
Science fiction
jeudi 12 décembre 2019
To Walk the Night - William Sloane (The Rim of Morning)
The Rim of the Morning est la réédition des deux romans de William Sloane. Le premier est To Walk the Night, publié en 1937. Il existe une édition française, sous le titre Lutte avec la nuit. Mais mieux vaut avoir une couverture sobre, tant les couvertures illustrées ne peuvent pas vraiment faire autrement que révéler certains éléments de ce qui est un mélange d'horreur cosmique, de roman à suspense et de drame familial. Le résultat est assez brillant.
To Walk the Night commence lentement. Le narrateur revient chez son père adoptif après le suicide de Jerry, son ami de toujours et fils de sang du père en question. Le narrateur entreprend de lui raconter tout ce qui a mené à ce suicide. Tout commence par le meurtre inexplicable d'un ami de Jerry, mathématicien et astronome. Sa veuve, magnifique et étrange, semble réagir de façon détachée. Jerry s'éprend d'elle et, allant contre toutes les normes sociales, ils ne tardent pas à se marier. Mais cette femme, on s'en doute, cache quelque chose.
Pas la peine d'aller beaucoup plus loin dans les détails du récit. L'écriture de William Sloane est tranquillement littéraire et le récit coule comme la plus élégante des rivières. Le suspense provient du mystère qui entoure la mort du mathématicien et de l'identité de sa veuve au nom éloquent : Selena. Ce n'est pas un vulgaire suspense de polar : il ne s'agit pas de trouver qui est l'assassin. Non, il ne s'agit pas d'une connaissance aussi bassement spécifique, mais de la connaissance en général. Une vérité qui chamboule les bases de l'univers rationnel et borné dans lequel les personnages ont l'habitude de vivre. Comme chez Lovecraft, cette vérité, cette connaissance, est une menace pour l'équilibre mental des personnages. L'un se suicide, un autre se noie dans la peur, un autre encore refuse l'évidence pour s'accrocher à l'explication rationnelle. Comme toujours, ces réactions sont un choix esthétique : après tout, pourquoi les personnages des histoires d'horreur cosmique ne ressentiraient-ils pas un peu d'émerveillement face à la découverte de l'inconnu et l'élargissement de leurs horizons ? Car, d'une certaine façon, c'est ce que ressent le lecteur. Mais les protagonistes subissent l'esthétique de cette littérature : ils sont les victimes sacrificielles offertes à l’appétit du lecteur. Ce sont sont eux qui souffrent sous les coups de butoir la vérité : la petitesse de l'humain dans l'univers, son insignifiance, et l'existence de choses bien plus grandes et vastes pour lesquelles le temps et l'espace, les barreaux de notre prison, ne sont rien. Ainsi le lecteur exorcise son nihilisme dépressif et peut cultiver son nihilisme positif : pour lui, comme pour Lovecraft, la position esthétique de l'horreur cosmique est une position philosophique, mais son angoisse se sublime dans l'art, et il est libre de goûter à ce qui est refusé aux personnages : la jouissance dans la découverte de l'inconnu total. Au fond, l'horreur cosmique est optimiste : elle postule qu'il y a autre chose.
William Sloane, dans To Walk the Night, va plus loin que Lovecraft dans cet « optimisme ». Ses personnages s'aiment, ils ont une vie sociale dense, et tout le récit est centré autour cette vie sociale : le problème est qu'une chose indéfinissable, chez cette femme, coince socialement. Toute la tension vient de détails de conversations, d'étrangetés du comportement. Mais, au fond, ce qui est vraiment optimiste, c'est que l'humanité aurait finalement un petit quelque chose d'unique, une essence qui mériterait qu'un étranger vienne y goûter.
lundi 9 décembre 2019
La Chose dans les algues - William Hope Hodgson
Ce recueil, dont j'aime particulièrement la couverture, recèle diverses nouvelles de William Hope Hodgson, l'auteur de La Maison au bord du monde. Les meilleures du recueil sont certainement L’Épave et La Voix dans la nuit, ce sont d'ailleurs les deux nouvelles (lues en VO par ici) qui m'ont convaincu d'explorer l’œuvre de Hodgson plus en détail. On trouve à la fin du bouquin deux courtes aventures de Carnacki, enquêteur du surnaturel, mais j'avoue ne même pas être allé au bout de la première. Ceci dit, il y a du bon là-dedans, mais du passable aussi. D'autres nouvelles maritimes dans L'Horreur tropicale.
Les Chevaux marins (The Sea Horses) ouvre le bal en opposition totale au ton annoncé par la couverture. Loin de toute créature tentaculaire, un jeune garçon habite chez son grand-père qui lui raconte histoires extraordinaires sur les chevaux marins. Le garçon se prend au jeu, d'autant plus que le grand-père lui construit un charmant petit cheval marin en bois. Pour fuir une épidémie, ils vont se réfugier sur le bateau du grand-père, qui est plongeur. Le gamin, vraiment, se prend trop au jeu... Une nouvelle étonnante par sa sensibilité. Le gamin est franchement un sale gosse, le grand-père est renfrogné et pas bavard, mais ils sont très humains et leur relation parait naturelle. On est face à l'enfance et à la puissance des histoires, l'imagination pouvant encore prendre le pas sur la réalité. J'aurais aimé savoir pourquoi le grand-père est sous-marinier (mais qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps sous l'eau ?!) et la fin est un peu too much. Ceci dit, Hodgson déploie là un talent inattendu de conteur. La fin, très sombre, est ponctuée par une vision chrétienne de l'après-vie que j'interprète comme n'étant que les hallucinations d'un grand-père déchiré par la douleur et affaibli et son activité sous-marine immodéré. À mes yeux Hogson ne peut qu'être matérialiste, ce qui rend cette fin d'autant plus habile de sa part : il écrit les croyances de son personnage tout en s'en distançant.
La nouvelle éponyme, La Chose dans les algues (The Thing in the Weeds, 1912), revient aux tentacules auxquels on s'attend. Mais sa forme est étonnamment moderne : on a vraiment l'impression de retrouver la structure d'un bon film de monstre à la Alien. Dans la mer des Sargasses, un navire se fait comme d'habitude attaquer par un vil poulpe géant, mais cette fois le ton est tout en retenue. Pendant la majeure partie du récit, on ne voit pas le monstre, c'est une forme vague qui rôde dans les ténèbres, on le devine, on le sent, on l'entend, il crée la terreur, mais impossible d'être certain de quoi que ce soit. Dommage que la fin ne parvienne pas à parachever cette montée de la tension, mais j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle qui ressemble à un prototype bien foutu du genre "film d'horreur à monstre".
De la mer immobile (From the Tideless Sea, 1906) est, je crois, la première nouvelle de Hodgson à mettre en scène la mer des Sargasses. On retrouve donc des ingrédients familiers, algues et poulpes, et si la narration parvient à mettre en scène une certaine tension, Hodgson a fait mieux par la suite. Reste la bonne idée de ce pauvre couple bloqué pendant des années dans la mer des Sargasses. Le Cinquième message (From the Tideless Sea Part Two: Further News of the Homebird, 1907) en est la suite directe, et si on pouvait espérer un développement de cette situation, c'est plutôt décevant : la narrateur est toujours bloqué sur le navire avec sa femme et sa jeune fille, mais il ne se passe rien d'autre qu'un jeu de cache-cache avec un énième monstre qui n'a rien d'unique à offrir.
Dans L'Île de Ud (The Island of the Ud, 1912), on passe à se la chasse au trésor. Les deux personnages, un capitaine alcoolique et violent et un jeune mousse, ne font pas oublier la banalité de l'aventure : ile mystérieuse, autochtones agressifs et plus ou moins bestiaux, jolie jeune femme sacrifiée à un crabe géant... Bof bof. L'Aventure au promontoire (The Adventure of the Headland, 1912) reprend les mêmes personnages et la même structure avec un peu plus de succès. L'accent est vraiment mit sur la relation entre le capitaine lunatique et le mousse débrouillard, qui passent leur temps à se chamailler, même pourchassés.
Le Mystère de l'épave (The Mystery of the Derelict, 1907) est une nouvelle variation sur la mer des Sargasses. Épave et rats géants. Parfaitement oubliable. Par contre, Le Dernier voyage du Shamraken (The Shamraken Homeward-Bounder) revient à une sensibilité qui rappelle la première nouvelle de ce recueil. Le Shamraken est un antique navire avec un équipage tout aussi antique : le mousse a 55 ans et tous les autres sont encore plus vieux. Ils font leur dernier voyage et ils s'inquiètent pour la retraite forcée qui les attend : après tout, la navigation est toute leur vie, il n'y rien pour eux à terre. Mais voilà qu'un étrange brouillard se lève, une ambiance mystique tombe sur le navire, d'autres phénomènes étranges se montrent : les vieux marins, rendus larmoyants par l'émotion, sont persuadés d'être devant les portes du paradis. Eh non : ce n'était que le début d'un typhon. Alors ils meurent tous, mais pas de signe du paradis. Un excellent petit récit, drôle et touchant
Le Bateau de pierre (The Stone Ship) semble tout d'abord être une énième aventure maritime : une étrange épave, de méchants monstres... La nouvelle prend du temps à décoller, mais on se rend bientôt compte qu'on est dans une veine différente qui commence à me sembler récurrente chez Hodgson : la puissance de l'imagination humaine. En effet, par la suite, tous les évènements sont expliqués rationnellement : le navire de pierre était en fait une vieille épave minéralisée remontée par un glissement de terrain sous-marin, les hommes de pierre n'étaient que des cadavres minéralisés mais recouverts par des limaces de mer qui donnaient une impression de mouvement... Et j'ai vraiment l'impression de voir comment Lovecraft a pu en tirer des leçons. Après tout, il aime bien les antiquités surgies du fond des mers par des glissements de terrain (Dagon, L'Appel de Cthulhu) et chez lui aussi ces choses étranges s'expliquent rationnellement. Hélas, retour à du plus que médiocre avec L'Équipage du Lancing (The Crew of the Lancing). Il y a une éruption volcanique sous-marine, seul point intéressant, mais Hodgson n'en fait rien : navire hanté, vils montres et ennui. Les Habitants de l'îlot du milieu (The Habitants of Middle Islet) bouscule un peu la formule et parvient à instaurer une véritable curiosité et une tension habile autour d'un navire bizarrement abandonné, mais il manque une conclusion efficace. Le Monstre de l'île aux algues (The Voice in the Dawn) est une énième visite de la mer des Sargasse particulièrement dénuée d'intérêt.
Libellés :
Fantastique,
Hodgson W. H.,
Littérature,
Science fiction
vendredi 6 décembre 2019
The Limits to Growth - Club of Rome
Faith in technology as the ultimate solution to all problems can thus divert our attention from the most fundamental problem—the problem of growth in a finite system—and prevent us from taking effective action to solve it.
Paru en 1972, The Limits to Growth est une étape importante de la pensée environnementaliste. En gros, ses auteurs, des chercheurs du MIT notamment, utilisent un modèle du développement humain basé sur cinq variables : la démographie, l'économie, la pollution, la production de nourriture et les ressources naturelles. Ils ont beau tourner ce modèles dans tous les sens crédibles, une seule conclusion s'impose : les limites de la croissance seraient atteintes avant 2100 et s’accompagneraient d'un effondrement global, d'un désastre environnemental et d'un grand manque de ressources naturelles pour les générations suivantes. En conséquence, ils recommandent de se débarrasser de la croissance, ou de moins de la croissance débridée. (Et ils ne prennent même pas en compte le réchauffement climatique.) Des idées que l'on retrouve toujours aujourd'hui, et toujours en marge, dans Prospérité sans croissance ou Tout peut changer pour n'en citer que deux.
Ils aiment beaucoup les courbes exponentielles. En effet, la croissance humaine est souvent caractérisée par des courbes exponentielles. Problème : tout va si vite qu'il est impossible de saisir les conséquences des "progrès" avant de les subir à grande échelle. Autre problème, plus limpide, et devenu depuis un classique : toute croissance infinie dans un système fini est impossible. Il est un peu triste de lire leurs espoirs et de constater que strictement n'a été fait dans ce sens depuis 57 ans. Notamment quand ils espèrent que les missions de CO2 seront limitées avant qu'elles aient des effets néfastes... Et déjà ils mentionnent et critiquent le courant techno-optimiste, pour ne pas dire techno-utopiste, qui voit le progrès comme apportant nécessairement les solutions à ses potentiels problèmes.
Ci-dessous quelques graphiques tirés du bouquin indiquant différentes possibilité de l'évolution du rapport entre croissance et capacité de l'environnement à permettre cette croissance.
mercredi 4 décembre 2019
L'Horreur tropicale - William Hope Hodgson
L'auteur de La Maison au bord du monde m'avait plus que convaincu avec deux nouvelles lues récemment. Et je ne peux que difficilement résister à de telles couvertures (quoique ce n'est pas encore la meilleure). Il y a du bon et du moins bon là-dedans, la première et surtout la troisième nouvelle méritent le détour.
La nouvelle éponyme, L'Horreur tropicale (A Tropical Horror, 1905) est amusante par son manque absolu de retenue. Le narrateur est sur un bateau, et paf, tout d'un coup, dès la première page, un gros monstre surgit des flots et sème la terreur sur le pont. Tout le monde se planque et le narrateur est bloqué avec un mousse dans un abri précaire. Il reste coincé là pendant plusieurs jours alors que la chose (dont on ne distingue jamais vraiment la forme sans savoir si c'est voulu par Hodgson ou simplement dû à une écriture maladroite) massacre absolument tout le monde. Ce n'est pas un récit particulièrement fin, mais cette accumulation de tentacules et de morts horribles parvient néanmoins à être réjouissante.
Une Voix dans la tempête (Out of the Storm) est un peu un piège : un marin qui subit les assauts d'une chose envoie un message de détresse grandiloquent. Mais on comprends rapidement que la chose en question n'est pas un énième monstre, mais l'océan lui-même. Ce qui est monstrueux, c'est la petitesse de l'humain face aux éléments et les horreurs commises sous l'impulsion des instincts de survie qui ressurgissent. Une pirouette appréciable
A la recherche du Graiken (The Finding of the Graiken, 1913) est une nouvelle clairement plus ambitieuse. Une structure classique mais efficace : la narrateur, ayant récemment hérité d'un oncle (comme toujours) se retrouve en possession d'un navire et décide d'aller faire une croisière en compagnie d'un ami dont l'amoureuse a récemment disparu en mer. L'ami a un comportement bizarre, fomente une mutinerie, dirige le navire vers la mer des Sargasses où, en plus de tonnes d'algues et de pieuvres vicieuses, ils retrouvent le navire de la bien-aimée. Le récit est percutant et dynamique, mais il est surtout mémorable pour un autre aspect. L'ami mutin est presque comme possédé : à la fin de l'aventure il ne se souvient de rien et à un moment il a une prémonition, il s'exclame "Il arrive !" alors qu'un courant mystérieux déblaie les algues et leur permet d'atteindre l'autre navire. C'est tout, pas de détails. Mais voilà ce que je comprends : en plus des vils poulpes, la mer des Sargasses est habitée par au moins une mystérieuse entité de taille massive. Elle a pris possession à distance de l'ami mutin pour le mener jusqu'à sa copine et c'est elle qui déblaie les algues avec son corps massif, sans jamais se montrer. Vraiment, c'est très habile de la part de Hodgson : la,partie la plus importante de son récit n'est pas explicite, ce qui est gratifiant pour le lecteur. Et je ne serais pas étonné que Lovecraft ait trouvé là de l'inspiration : souvent, dans ses nouvelles, une menace plus profonde et insaisissable que celle qui occupe le cœur de l'intrigue rôde loin des regards
On change de genre avec Eloi Eloi Lama Sabachthani (1919). Un savant prétend expliquer l'épisode des ténèbres de la croix, dont je ne me souvenais pas, par une théorie de la lumière. Il fabrique une substance qui permet de la répliquer et il se l'injecte avant de s'infliger un supplice parodiant celui du Christ. À la fin il crève avec ce qui ressemble à un moment de possession démoniaque. Un nouvelle peu intéressante et pénible à lire à cause des scènes d'automutilation. Le Réservoir de la peur (Terror of the Water-Tank, 1907) est une sorte d'intrigue policière, mais disons que quand on a un peu lu Hodgson, on a besoin que du titre deviner que le coupable est une bestiole quelconque qui se planque dans le réservoir.
Retour à l'océan avec L’Albatros. Un récit d'aventure parfaitement classique : un albatros apporte un message d'une damoiselle en détresse, le valeureux narrateur défie les ordres de son capitaine pour partir à sa recherche, il fait preuve de courage et de virilité, dégomme un millier de rats (vraiment) et chope la jolie jeune fille en détresse. Bon, pas franchement mauvais, mais d'un intérêt limité. On achève ce recueil avec Le Fantôme de lady Shannon (The Haunting of the Lady Shannon). Encore une fois, bof : un vil capitaine et ses seconds martyrisent un équipage, on devine qu'un vrai/faux fantôme va venir les embêter.
Libellés :
Fantastique,
Hodgson W. H.,
Littérature,
Science fiction
lundi 2 décembre 2019
L'Expérience du docteur Mops - Jacques Spitz
L'Expérience du docteur Mops (1939) n'est pas un roman majeur de Jacques Spitz. Déjà, la forme est plus plus classique dans la plupart de ses autres œuvres : pas d'évènements qui bouleversent l'ordre mondial, ou presque, et on reste accroché au point de vue d'un unique personnage. Pierre, architecte colonial en congé, se ballade dans le sud de la France et rencontre une jeune damoiselle en la sauvant de la noyade. S'ensuit une amourette assez classique, mais très bien décrite : j'ai pas mal rigolé tant Spitz parvenait à me faire m'identifier à son narrateur, qui s'éprend d'une jeune fille tout à fait charmante avec un mélange bien dosé d’enthousiasme et d’appréhension. Mais la jolie a un beau-père suspect : l'éponyme docteur Mops, figure classique du savant aux activités louches que l'on retrouve ailleurs chez Spitz et qui vient peut-être directement de chez Wells et plus particulièrement de L'Ile du docteur Moreau.
L'expérience de Mops, progressivement révélée, se rapproche de celle que l'on trouve dans L’œil du purgatoire : il travaille à projeter la conscience de son cobaye humain dans le futur. Comme souvent avec les histoires de manipulation temporelle, il m'a semblé percevoir des incohérences, mais rien de trop dramatique. Quand le cobaye révèle la mort future de la femme aimée, le roman se transforme en mélodrame un peu lourd. Il est également regrettable que l'argument science-fictif ne mène finalement pas à grand chose, notamment parce que Spitz fait l'étrange choix, au lieu d'aller au bout des possibilités, de laisser planer le doute sur la réalité de la chose. Frustrant. Ceci dit, L'Expérience du docteur Mops se lit avec aisance, tant Spitz, même quand il n'est pas au sommet de sa forme, parvient à attiser la curiosité avec une profonde ironie sous-jacente, et le voir se pencher sur un format narratif plus sobre n'est pas sans intérêt.
samedi 30 novembre 2019
The Voice in the Night & The Derelict - W. H. Hodgson
 |
| Kumataro Ito |
William Hope Hodgson est notamment l'auteur du bizarre et tout à fait recommandable La Maison au bord du monde, mais aussi des Pirates fantômes, qui ne m'a pas laissé le moindre souvenir. Par contre, sa courte nouvelle The Voice in the Night (1907) est particulièrement brillante. Par une nuit noire, sur un petit bateau de pêche (Hodgson adore les cadres marins) le narrateur entend une voix. C'est un homme sur une petite barque qui refuse qu'on l'éclaire et qui demande poliment un peu de nourriture. Le narrateur et son pote ont pitié de cet être étrange, notamment quand il mentionne sa dulcinée qui a faim sur leur petite île de naufragés. Bien sûr, il y a du louche, et l'homme va revenir raconter son histoire à ses bienfaiteurs. L'amorce est extrêmement classique : le naufrage, le navire abandonné et l'île mystérieuse. Mais ici, l'horreur ne vient pas d'un monstre et d'une menace de mort violence, c'est beaucoup plus insidieux. La navire et l'île sont infestés d'une sorte de moisissure vorace qui, on s'en doute, ne va pas tarder à réclamer les deux naufragés. La corruption progressive mais certaine de l'environnement puis des corps est mille fois plus dérangeante qu'un monstre quelconque et on sent l'influence que cette nouvelle a pu (peut-être) avoir sur Lovecraft, chez qui la décadence physique est un thème récurrent, notamment dans The Thing on the Doorstep ou The Case of Charles Dexter Ward. La chute, ici, n'est pas une prétendue révélation, mais un coup d’œil concret sur ce que le narrateur et le lecteur ont appris dans le noir. On peut bien parler d'horreur cosmique, tant la menace est une chose insaisissable, implacable, sans doute dénuée de volonté, qui détruit l'humain d'une manière mécanique.
The Derelict (1912) pourrait presque être considéré comme une suite. Encore une fois, un récit marin. Un vieux docteur raconte une aventure de sa jeunesse pour justifier son point de vue matérialiste :
And, anyway, the thing I'm going to tell you won't explain the mystery of life, but only give you one of my pegs on which I hang my feeling that life is as I have said, a force made manifest through conditions — that is to say, natural chemistry — and that it can take for its purpose and need, the most incredible and unlikely matter; for without matter it cannot come into existence — it cannot become manifest.Après une tempête, son navire croise une épave flottante. Bien sûr, une petite expédition se monte : le capitaine, le second, le narrateur et quelques autres décident d'aller farfouiller dans la ruine, qui se révèle être entourée d'une sorte de mélasse liquide qui se fait de plus en plus collante alors que la barque des explorateurs s'approche. Une fois à bord, tout le navire semble recouvert d'une étrange moisissure. L'investigation se poursuit jusqu'à la révélation progressive que l'épave est vivante : c'est une créature qui, à la manière d'une plante carnivore, attire ses proies en se faisant belle. La tension monte, monte, monte, c'est habile, même si le vocabulaire marin très spécifique rend la compréhension parfois un peu difficile. Puis quand la vérité éclate dans l'esprit des humains pris au piège, que la chose s'éveille et commence à digérer leurs pieds, le rythme explose brutalement. Vraiment, c'est excellent. C'est, à la manière de Lovecraft, plus de la science-fiction que du fantastique : rien de vraiment inexplicable, juste une forme de vie inconnue, froidement hostile et radicalement incompréhensible.
Liens Wikisource vers The Voice in the Night et The Derelict.
Libellés :
Fantastique,
Hodgson W. H.,
Littérature,
Science fiction
jeudi 21 novembre 2019
Dark Ecology - Paul Kingsnorth
 |
| Mikalojus Konstantinas Ciurlionis - The Goat - 1904 |
Cet article de 2012 lisible par ici tente de faire de faire le point sur l'échec des mouvements environnementalistes et, plus globalement, sur le rapport intime à la certitude de l'effondrement. Je vais commencer par critiquer une certaine idéalisation du primitif. C'est presque de la mauvaise foi de ma part, parce que Paul Kingsnorth est bien conscient de ce piège, mais j'ai pourtant l'impression qu'il tombe dedans. Par exemple :
If there was an age of human autonomy, it seems to me that it probably is behind us. It is certainly not ahead of us, or not for a very long time.Ou encore, à propos de l'apologie du travail manuel qu'il fait au long de son texte avec l'exemple de la faux :
You concentrate without thinking, you follow the lay of the ground with the face of your blade, you are aware of the keenness of its edge, you can hear the birds, see things moving through the grass ahead of you. Everything is connected to everything else, and if it isn’t, it doesn’t work.Et il cite notamment Anna Karenine qui, en effet, est tout à fait lié à ces problématiques. Je ne veux pas dire que les idées qu'il exprime ici sont fausses. En effet la technique prive l'humain de bien des choses. En effet le travail manuel possède une valeur intrinsèque. Mais un mode de vie ne prend l'essentiel de sa valeur que comparé à d'autres et, en effet, si on compare le meilleur de l'antique (via ses exemples) et le pire de la modernité, la conclusion est claire. Mais le fait est qu'on peut très aisément comparer le pire de l'antique au meilleur de la modernité. L'argument suprême est que la modernité est un grand suicide ; ce à quoi je réponds (sans certitude) que la la modernité n'est que la conséquence, la suite logique, de l'antique.
Je développe, au risque de faire du straw man envers un potentiel primitivisme. J'ai une vision du développement assez déterministe forgée partiellement en lisant Jared Diamond et une certaine biologie comportementale évolutionnaire (une telle chose existe-t-elle ?) comme Wired for Culture : si une entité civilisationnelle peut maintenir une certaine cohérence quand elle est livrée à elle-même, c'est dans la compétition que la course en avant est inévitable. Ainsi si la Chine et le Japon antiques pouvaient rester relativement figés, en Europe, notamment à partir de la renaissance, la compétition entre une multitude d'unités civilisationnelles en contact direct ne laisse pas d'autre choix que la course en avant. Si dix pays font des choix conservateurs mais que le onzième se fait progressiste, en finançant Christophe Colomb par exemple, ou en brulant du charbon, alors les dix autres suivront par choix ou par coercition, ce qui est arrivé à la Chine et au Japon. Ainsi à moins de faire du monde une unique entité civilisationnelle, la stabilité technique et sociale est impossible. Et même si le monde s'unifie d'une façon ou d'une autre, ce n'est qu'un ralentissement, pas un point final. Bref, tout projet qui nie le "progrès" (j'utilise le terme d'une façon dénuée de valeur, on pourrait le remplacer par "évolution" ou "changement") me semble voué à l'échec car basé sur des prémisses erronées. Mais, bien sûr, et pour ne pas déformer le propos de Paul Kingsnorth, la nature de ce "progrès" n'est peut-être pas déterminée. Peut-être, car j'ai tendance à supposer que le "progrès" le plus extrême écrase le plus modéré.
Paul Kingsnorth ne serait sans doute pas d'accord puisqu'il m'a l'air d'avoir un point de vue constructiviste :
To ask that question in those terms is to misunderstand what is going on. Brushcutters are not used instead of scythes because they are better; they are used because their use is conditioned by our attitudes toward technology. Performance is not really the point, and neither is efficiency. Religion is the point: the religion of complexity.Encore une fois l'exemple est assez indéniable... quand on reste au point de vue individuel. Nier que les débroussailleuses soient, globalement, plus efficaces que les faux, me semble un mauvais point de départ. Mieux vaut admettre l'efficacité des débroussailleuses, mais faire remarquer que l'efficacité optimale dans une tâche précise n'est pas un objectif valable : il faut prendre en compte l'impact de l'outil sur l’environnement et l'humain. Dans ce cas, malgré son efficacité moindre, la faux gagne certainement le duel. Mais le fait est que le raisonnement de Paul Kingsnorth (ou le mien d'ailleurs) ne convaincra pas grand monde, ainsi la conclusion globale est pessimiste :
What does the near future look like? I’d put my bets on a strange and unworldly combination of ongoing collapse, which will continue to fragment both nature and culture, and a new wave of techno-green “solutions” being unveiled in a doomed attempt to prevent it. I don’t believe now that anything can break this cycle, barring some kind of reset: the kind that we have seen many times before in human history. Some kind of fall back down to a lower level of civilizational complexity.Si j'approuve le point de vue global, un détail (que je croise régulièrement) me chiffonne : en quoi le reset changerait quoi que ce soit ? C'est un peu comme cet argument que j'ai beaucoup entendu à propos de l’élection de Trump : "Au moins ça va faire prendre conscience aux gens que..." Mais non ! Il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a qu'un abaissement général. Comme si une guerre mondiale servait à empêcher la suivante. Comme si l'humanité post-effondrement (qui devra de toutes façons affronter un monde mille fois plus hostile) aurait une nature différente. (Solution, donc, dans la modification de cette nature, comme dans The Hedonistic Imperative ?) Ainsi, à mes yeux, le progress trap suivant, bien qu'il soit parfaitement juste, n'est pas, en soi, un bon argument contre le progrès :
This is the progress trap. Each improvement in our knowledge or in our technology will create new problems, which require new improvements. Each of these improvements tends to make society bigger, more complex, less human-scale, more destructive of nonhuman life, and more likely to collapse under its own weight.C'est parfaitement juste, donc, et une critique valide contre la modernité en général. Mais pas contre le progrès, puisque tout est un progrès à un moment ou à un autre, y compris la faux que défend tant Paul Kingsnorth (et il y en conscience). Ainsi le progrès n'est pas en cause, c'est l'ordre social et économique qui l'est, et son inertie est colossale. Pour conclure son article très sombre (comme l'indique son titre), Kingsnorth donne cinq pistes:
- La retraite. L'inaction comme vertu. Un peu d'ascétisme, un peu de désobéissance civile à la Thoreau.
- Préserver la vie non humaine. En tant que campagnard, il propose des solutions matérielles, actives, et ne mentionne pas le végétarisme. En tant que citadin, je n'ai que le végétarisme et ses variantes à proposer.
- Mettre les mains à la terre. Pour moi, qui habite dans un cube en centre ville, le point le plus difficile, mais certainement pas le moins valable.
- Garder et transmettre l'idée d'une valeur inhérente à la nature, au-delà de l'utilité à l'humain.
- "Construire des refuges." Il ne s'agit pas de construire des bunkers pour se préparer à l'apocalypse. Les refuges peuvent prendre bien des formes face à un effondrement qui pourra prendre bien des formes. Un tissu social est un refuge.
mardi 19 novembre 2019
The Uninhabitable Earth - David Wallace-Wells
Pour écrire The Uninhabitable Earth (2019), David Wallace-Wells a lu les mêmes livres que moi. Enfin, certainement bien plus, mais le fait est que j'ai eu l'impression de relire des choses lues ailleurs. Tout peut changer de Naomi Klein, Le syndrome de l'autruche de George Marshall pour l'aspect psychologique, Les guerres du climat de Harald Welzer, Drawdown sur les pistes de sortie plus ou moins techno-utopiques, les bouquins de Jared Diamond pour la prise de recul évolutionnaire ou encore, pour mettre des français, L'événement anthropocène et le très bon Cataclysmes de Laurent Testot... J'ai donc lu The Uninhabitable Earth en diagonale. L'auteur récapitule les effets du bouleversement environnemental, l'inertie sociétale qui bloque l'action et termine même, il faut croire que c'est une tradition, sur le paradoxe de Fermi en posant l’effondrement environnemental comme potentiel Grand Filtre. C'est pas joyeux.
Il récapitule les effets qui risquent de rendre une partie de la Terre inhabitable d'ici 100 ans en différents chapitres. Faisons brièvement le tour, en gardant en tête que ces points sont bien sûr liés entre eux et s'influencent négativement : hausse de la température (entre 4 et 7 degrés, si ce n'est plus), baisse des récoltes et famines, montée des eaux et inondations, feux de forêts (et du reste) de plus en plus fréquents, désastres en tous genre (typhons, tempêtes...), pénurie d'eau douce, mort des océans, pollution atmosphérique, épidémies, effondrement économique et guerres du climat.
Vraiment, après avoir pas mal lu sur le sujet, la conclusion me semble assez limpide : à moins d'une improbable surprise, le vingt-et-unième siècle et les suivants frapperont l'humanité par un déclin constant du niveau de vie, un déclin de l'espérance de vie, des migrations inimaginablement massives, une chute des démocraties libérales, une recrudescence des conflits armés et une zone équatoriale progressivement inhabitable.
Bon, je relève quelques points.
- Pour chaque degré de plus, les récoltes de céréales baissent de 10%.
- D'ici 2080, l’Europe du sud sera en état de sécheresse permanent. Sans parler du reste du monde.
- La hausse du taux de CO2 dans l'air entraine une importante baisse de la qualité nutritionnelle des aliments : moins de vitamines, plus de glucides.
- La hausse du taux de CO2 dans l'air entraine une baisse des capacités cognitives.
- Jusqu'à présent, les océans ont absorbé la majeure partie de la nouvelle chaleur : ils arrivent à leur limite.
- Feedback loop : plus de CO2 = feuilles des végétaux plus épaisses = plantes absorbent moins de CO2.
- Feedback loop : Albedo effect : moins de glace aux pôles = moins de rayons solaires réfléchis par le blanc de la glace = plus de réchauffement.
- Feedback loop : fonte du permafrost = libération massive, mais vraiment massive, de méthane = plus de réchauffement (d'ici 2100, équivalent à la moitié du carbone relâche par l'humanité depuis l'industrialisation)
- Feedback loop : réchauffement = plus de feux de forêts = plus de carbone relâché et moins d'arbres pour le réabsorber
- Le climat changerait plus rapidement qu'à n'importe quel moment depuis la fin des dinosaures.
- D'ici 2050, 140 millions de migrants climatiques. Et ce chiffre, c'est selon la Banque Mondiale. Donc probablement optimiste. Entre 200 millions et 1 milliard selon... les Nations Unies.
- Les humains brûlent actuellement 80% plus de charbon qu'en 2000.
jeudi 14 novembre 2019
The Hedonistic Imperative - David Pearce
The Hedonistic Imperative (1995) est peut-être la vision utopique la plus radicale que j'aie jamais lue. En gros, c'est de l'utilitarisme poussé jusqu'au bout de sa logique : éradiquer toute souffrance pour toute créature, partout, avec l'aide, notamment, de la reprogrammation génétique.
La souffrance est un élément capital dans la vie darwinienne. Et tant que l'humain reste dans un schéma darwinien de la souffrance en tant que motivateur principal, il n'a aucun moyen d'échapper à l'adaptation hédonique. Il s'agit donc de modifier les fondements même du fonctionnement humain. Si annihiler la souffrance est un utilitarisme négatif, David Pearce ne s'arrête pas là : il défend le développement de la capacité au bonheur, de façon à ce que l'extase absolu d'aujourd'hui ne soit même pas l'humeur la plus basse possible dans un lointain futur. Les gens en parfaite santé mentale d’aujourd’hui sont donc pires que dépressifs si on compare leur état d'esprit à ceux qui sont potentiels.This manifesto outlines a strategy to eradicate suffering in all sentient life. The abolitionist project is ambitious, implausible, but technically feasible. It is defended here on ethical utilitarian grounds. Genetic engineering and nanotechnology allow Homo sapiens to discard the legacy-wetware of our evolutionary past. Our post-human successors will rewrite the vertebrate genome, redesign the global ecosystem, and abolish suffering throughout the living world.
Il ne s'agit pas d'atteindre un état d'extase et de s'y prélasser (bien que ceux qui choisiraient cette option seraient dans leur droit) mais d'étendre le champ de conscience humain. De plus, Pearce argumente que quelqu'un d'heureux, d'épanoui, est plus motivé et productif que quelqu'un de dépressif : ainsi un état mental inimaginablement heureux est corrélé à une plus grande implication dans le réel, à une hypermotivation. Après tout, si notre bien-être est en bonne partie causé par une chimie partiellement aléatoire et conçue pour favoriser la réplication du vivant dans un contexte darwinien dépassé, pourquoi ne pas l'optimiser ?
Il s'agit bien de toute souffrance :
At some momentous and exactly dateable time, the last unpleasant experience ever to occur on this planet will take place. Possibly, it will be a (purely comparatively) minor pain in some (to us) obscure marine invertebrate.Bon argument : il nous est quasi-impossible de concevoir à quel point notre existence est misérable faute de point de comparaison. Ainsi, de la même façon, l'un de nos ancêtre d'il y a dix-mille ans ne pouvait pas imaginer les réalités contemporaines dans le domaine de la diminution de la douleur : ce n'est pas pour autant qu'il devait rester dans son état. Sans compter que la course au statut social nous pousse à nous prétendre, à nous croire, heureux. L'idée, c'est véritablement que notre conscience actuelle sera vue par les posthumains comme nous voyons celle d'un singe. Idée classique, mais ce qui est précisément défendu ici, c'est que cette différence ne concernera pas seulement l'intelligence, mais surtout la capacité au bonheur. Et la capacité au bonheur ne changerait pas moins notre façon d'interagir avec le monde que l'intelligence.
Pour remplacer la motivation procurée par la crainte de la souffrance, Pearce propose des nuances de béatitude. Ainsi l'on agirait non pas pour fuir la souffrance, mais pour rechercher un bonheur plus vif, plus net, plus varié.
Dans un futur plus proche, la course vers ce bonheur passerait temporairement par des drogues plus classique. J'aime l'idée d'un « hypo-hedonic disorder » : ne serait plus seulement une pathologie le malheur actif, c'est à dire la dépression, mais le bonheur insuffisant. Dans un tel contexte, serait-ce maltraiter ses enfants que de leur refuser ces drogues ? Ou plus tard de leur refuser la reprogrammation génétique ?
David Pearce consacre la dernière partie de son livre à se confronter aux critiques faites à la thèse défendue. Ses réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. En fait, il y a tellement de contradictions qui viennent à l'esprit à la lecture de The Hedonistic Imperative que c'en est éprouvant. Comment imaginer une humanité sans douleur ? Pire : comment imaginer un règne animal sans douleur ? Si l'humain peut se targuer d'avoir bien d'autres motivations, que serait une souris qui n'aurait plus à craindre le moindre prédateur ? Ni même à craindre la faim ? Que serait un tigre rendu végétarien ? La douleur n'est-elle pas indispensable au bonheur ? La douleur n'est-elle pas indispensable à la vie même ? Dans un gradient d'extase, le fond du gradient ne se transformerait-il pas en douleur ? N'est-ce pas réduire le champ de la conscience humaine que de rendre impossible tout état mental négatif ? Ne serait-ce pas se priver d'une bonne partie de la création humaine ? Comme je l'ai dit, Pearce s'attaque à ces questions, et à bien d'autres, mais sans vraiment convaincre. Cependant, en se posant la grande question téléologique « Où allons-nous en tant qu'espèce ? » il devient difficile de trouver de meilleur réponse que celle proposée dans ce livre. Que signifient tous les progrès dans le cadre de l'adaptation hédonique ? Et l'analogie de l'anesthésie fonctionne à merveille : comment être contre la réduction de la souffrance ?
Je dirais que The Hedonistic Imperative a deux principaux problèmes. Déjà, c'est terriblement optimiste. L'auteur a une foi inébranlable en l'idée de progrès. Qui sait si l'humanité ira jusque là ? Et qui sait s'il n'y a pas des limites physiques à l’interventionnisme humain sur son environnement et son propre corps ? Ensuite, The Hedonistic Imperative est follement en avance sur son temps. Toutes les questions, tous les espoirs et tous les problèmes peuvent être mis de côté ainsi : « On n'en sait rien pour l'instant. Il est encore trop tôt. » Mais Pearce dirait qu'il n'est pas trop tôt pour commencer à financer des recherches dans la direction qu'il esquisse...
jeudi 7 novembre 2019
Le gai savoir - Nietzsche
Le gai savoir (1882) trouve sa place entre Aurore (1881) et Ainsi parlait Zarathoustra (1883). Un rythme de production dense, donc, et on perçoit dans chaque volume ce qui va faire naitre le suivant. Le gai savoir m'a fait un peu la même impression que les précédents volumes de Nietzsche : comme il passe beaucoup de temps à tourner et retourner autour des mêmes sujets, plus on avance dans le livre, moins l'impact est fort, même ne le lisant pas d'une traite comme un roman. Ici Nietzsche enrobe ses aphorismes par deux petits assemblages de poèmes, et le tout est précédé d'une introduction écrite quelques temps plus tard.
Cette intro est particulièrement lyrique et enflammée. Nietzsche y évoque essentiellement son rapport à la maladie et à la douleur : « Vivre — cela signifie pour nous : changer constamment en lumière et en flamme tout ce que nous sommes ; de même, aussi, transformer tout ce nous frappe ; nous ne saurions absolument pas faire autrement. » C'est grandiloquent, certes, mais objectif est certain atteint : j'ai envie que Nietzsche soit mon ami et d'aller me balader dans les montagnes avec lui.
Je passe sur les poèmes, je vais déjà passer assez de temps à écrire ceci. Le premier aphorisme frappe très fort, dès sa première phrase : « J'ai beau considérer les hommes d'un bon ou d'un mauvais œil, je ne les vois jamais appliqués qu'à une tâche : à faire ce qui est profitable à la conservation de l'espèce. » Mais pas par choix : « parce que cet instinct est absolument l'essence de l'espèce grégaire que nous sommes. » Il me semble que le grégaire est un peu superflu : une espèce n'a pas besoin d'être grégaire pour que sa conservation soit son but unique. Et, plus intéressant, le propos de Nietzsche est que la classification classique des humains en bons et mauvais n'est pas pertinente car même le mauvais contribuent à cette grande préservation. Il est une sorte d'excitant, d'épée de Damoclès stimulante. « La haine, la joie de détruire, la soif de rapine et de domination, et tout ce qui par ailleurs est décrié comme méchant : tout cela appartient à l'étonnante économie de la conservation de l'espèce, à une économie sans doute couteuse, gaspilleuse, et dans l'ensemble prodigieusement insensée — mais on peut prouver qu'elle a conservé notre espèce jusqu'à ce jour. » En effet, difficile de prouver le contraire.
31. Nietzsche, comme souvent, se projette dans un futur lointain. Il compare la chasse au commerce, en tant qu'activité autrefois nécessaire à tous et aujourd'hui luxe pour le plaisir de quelques-uns. Et si le commerce lui aussi devenait un luxe inutile ? Et la politique ? Nietzsche n'est-il pas en train d'imaginer une société de l'abondance ?
54. La conscience comme entassement d'atavismes qui se donnent des airs : « J'ai découvert pour ma part que la vieille humaine animalité, voire la totalité des temps originels et du passé de tout être sensible continuaient en moi à poétiser, à aimer, à haïr, à construire des déductions, — je me suis brusquement réveillé au milieu de ce rêve, mais rien que pour prendre conscience que je ne faisais que rêver et qu'il me faudra continuer de rêver encore pour ne point périr : comme il faut que le somnambule continue de rêver pour ne pas faire de chute. »
109. « Gardons-nous de déclarer qu'il y a des lois dans la nature. Il n'y a que des nécessités : là nul ne commande, nul n’obéit, nul ne transgresse. Dès lors que vous savez qu'il n'y a point de but, vous savez aussi qu'il n'y a point de hasard. Ce n'est qu'au regard d'un monde de buts que le mot hasard a un sens. » Ainsi Nietzsche s'attaque au hasard non pas tant pour démontrer un déterminisme qui lui serait opposé que pour présenter l'idée même de hasard comme supposant bien trop d'ordre.
111. Sur l'inévitabilité de la nature humaine, voire de la nature de la vie : « Nul être vivant ne se serait conservé, si la tendance contraire à affirmer plutôt qu'à suspendre le jugement, à errer et à imaginer plutôt qu'à attendre, à approuver plutôt qu'à nier, à juger plutôt qu'à être équitable — n'avait été stimulée de façon extrêmement forte. » Ainsi nos prétentieuses pensées : «l'antique mécanisme se déroule à présent en nous de façon si rapide et si dissimulée que nous ne nous apercevons jamais que du résultat de la lutte. »
179. Toujours la même idée : « Les pensées sont les ombres de nos sentiments — toujours obscures, plus vides, plus simples que ceux-ci. » Je réalise que c'est sans doute le thème qui me touche le plus chez Nietzsche : la critique de la valeur de l'intelligence humaine via une sorte de psychologie évolutionnaire.
338. Sur une certaine « nécessité personnelle du malheur » : « Car bonheur et malheur sont deux frères jumeaux qui ou bien grandissent ensemble ou bien, comme c'est le cas chez vous, — demeurent petit ensembles ! » Nietzsche s'adresse ici aux adeptes de la religion théoriquement compassionnelle. J'aime cette idée de la capacité au bonheur comme écho de la capacité à la douleur. J'en parlais il y a quelques temps à un oncle qui n'était pas d'accord. Il me semble que, dans mon propre paysage mental, les deux sont en effet des jumeaux : ou plutôt les deux choses sont un arbre, l'une est le tronc qui jette son feuillage vers le soleil, l'autre constitue les racines qui vont chercher leur nourriture loin dessous, et les deux grandissent inévitablement ensemble. Et pour développer ces jumeaux, ou cet arbre : « Vis dans l'ignorance de ce qui semble le plus important à son siècle ! Mets entre aujourd'hui et toi-même au moins l’épaisseur de trois siècles ! » Et une conclusion que j'aime voir comme presque épicurienne : secourir non pas le monde, mais ses amis, et les secourir par la joie — cette joie qui nécessite l'entièreté de l'arbre.
351. Nietzsche évoque pour la première fois l'amor fati, il annonce Zarathoustra, mais finissons plutôt sur une pique envers le religieux : « l'âme a aussi besoin de cloaques pour ses ordures ». Quel dommage, les racines de l'arbre ne demandent qu'à s'en nourrir.
mardi 29 octobre 2019
Le Monde comme volonté et comme représentation - Livre 2 - Schopenhauer
Après le premier livre du Monde comme volonté et comme représentation, voici le second. Schopenhauer s'y fait très métaphysique et, en conséquence, se heurte à mon instinct matérialiste. Le vocabulaire, lui, devient plus délicat à manier.
Voilà une sorte d'annonce de ce qui l'intéresse dans ce second livre : « ... il ne nous suffit pas de savoir que nous avons des représentations, que ces représentations sont telles ou telles, et dépendent de telle ou telle loi, dont l'expression générale est toujours le principe de raison. Nous voulons savoir la signification de ces représentations ; nous demander si le monde ne les dépasse pas, auquel cas il devrait se présenter à nous comme un vain rêve ; ou comme une forme vaporeuse semblable à celle des fantômes ; il ne serait pas digne d'attirer notre attention. Ou bien, au contraire, n'est-il pas quelque chose d'autre que la représentation quelque chose de plus ; et alors, qu'est-il ? » (p.139) On devine là la quête d'une sorte d'essence du réel qui dépasse nos simples sens.
Donc, le monde serait « Volonté ». Certes, certes, mais ça veut dire quoi ? Prenons l'exemple du corps pour essayer de comprendre : « Le sujet de la connaissance, par son identité avec le corps, devient un individu ; dès lors, ce corps lui est donné de deux façon toutes différentes ; d'une part comme représentation dans la connaissance phénoménale, comme objet parmi d'autres objets et soumis à leurs lois ; et d'autre part, en même temps, comme ce principe immédiatement connu de chacun, que désigne le mot Volonté. » Peu après : « Le corps entier n'est que la volonté objectivée, c'est-à-dire devenue perceptible ». Et encore : « La volonté est la connaissance a priori du corps ; le corps est la connaissance a posteriori de la volonté. » (p.141) Jusque là, c'est relativement limpide et certainement élégant ; mais quel est le rapport avec le monde ?
La volonté est donc un moyen de connaissance. Pour rester sur le corps : le fait qu'il est objectivisation de notre volonté, ou qu'il est notre volonté, nous donne de lui une connaissance non pas seulement en tant qu'objet, mais « sur ce qu'il est en dehors de la représentation, sur ce qu'il est en soi ». (p.145) Schopenhauer compte se servir de cette double connaissance comme d'une clé pour « pénétrer jusqu'à l'essence de toues les phénomènes et de tous les objets de la nature qui ne nous sont pas donnés, dans la conscience, comme étant notre propre corps, et que par conséquent nous ne connaissons pas de deux façons, mais qui ne sont que nos représentations ; nous les jugerons par analogie avec notre corps et nous supposerons que si, d'une part, ils sont semblables à lui, en tant que représentation, et, d'autre part, si on leur ajoute l'existence en tant que représentation du sujet, le reste, par son essence, doit être le même que ce que nous appelons en nous volonté. » (p.147) L'analogie me semble être un point de départ douteux, mais voyons.
Schopenhauer cherche des causes : « la vie animale, dans son ensemble et dans son développement, n'est qu'un phénomène de la volonté. » (p.150) J'aurais plutôt tendance à prendre la position exactement inverse : la volonté comme phénomène de la vie animale. Il évoque ensuite la « convenance parfaite qu'il existe entre le corps de l'homme ou de l'animal et la volonté de l'homme ou de l'animal » (p.151) Mais qu'en est-il de la maladie ? De la vieillesse ? Encore un point qui me chiffonne quand il reprend Kant (que je n'ai encore jamais lu) : « l'espace, le temps et la causalité ne conviennent pas à la chose en soi, mais ne sont que des formes de la connaissance ». (p.156) Alors il existerait une essence des choses hors de l'espace et du temps ?
Une image qui illustre bien le déterminisme de Schopenhauer : « Spinoza dit qu'une pierre lancée par quelqu'un dans l'espace, si elle était douée de conscience, pourrait s'imaginer qu'elle ne fait en cela qu'obéir à sa volonté. Moi, j'ajoute que la pierre aurait raison. L'impulsion est pour elle ce qu'est pour moi le motif, et ce qui apparait en elle comme cohésion, pesanteur, persévérance dans l'état donné, est par lui-même identique à ce que je reconnais en moi comme volonté, et que la pierre reconnaitrait aussi comme volonté si elle était douée de connaissance. » (p.171) Ainsi selon lui les motifs humains ne sont pas moins déterminés qu'un simple mouvement physique.
« A son origine et dans son universalité, une force naturelle n'est dans son essence rien d'autre que l'objectivisation, à un degré inférieur, de la volonté. Un tel degré, nous l’appelons une idée éternelle, au sens de Platon. » (p.180) Ainsi il semble embrasser les idées, ou formes, platoniciennes, ce qui explique pourquoi il peut parler de l'uniformité des millions de manifestations « qui se produisent avec une infaillible exactitude ». Dans cette vision, une sorte d'essence existe hors du monde et fige celui-ci dans une régularité totale. Il me semble que Schopenhauer s'enfonce là, à l'image des théistes, dans une recherche d'un ordre global ordonné et perfectionné, comme pour nier le chaos.
De nouveau : « toute cause naturelle n'est qu'une cause occasionnelle ; elle ne donne que l'occasion de la manifestation de cette volonté une et indivisible, qui est substance de toutes les choses et dont les degrés d'objectivisation constituent tout le monde visible. » (p.184) Peut-on voir cette volonté comme représentant les lois physique de l'univers ? Peut-être, mais il me semble que Schopenhauer y met toujours trop d'ordre, trop d’intemporalité, alors que les lois physique de l'univers ne sont (sans doute ?) pas hors du temps. Il qualifie ensuite cette volonté d'« inexplicable ». Ainsi ne tombe-t-il pas dans son propre piège : à quoi bon tenter de connaitre une chose dont de toutes façons on ne peut pas connaitre les causes ultimes ?
« La volonté doit se nourrir d'elle-même, puisque, hors d'elle, il n'y a rien, et qu'elle est une volonté affamée. De là cette chasse, cette anxiété et cette souffrance qui la caractérisent. » (p.203) Pas tout à fait rien semble-t-il, puisqu’il y a les idées qui « résident hors du temps ». (p.210) Et pour quelqu’un qui produit des sentences aussi pessimistes, Schopenhauer semble n'avoir pas une faible opinion de l'humanité à l'échelle cosmique : « Ainsi la course les planètes, l'inclinaison de l’écliptique, la rotation de la terre, le partage du continent et de la mer, l’atmosphère, la lumière, la chaleur et tous les phénomènes analogues, qui sont dans la nature ce qu'est dans l'harmonie la basse fondamentale, se sont conformés avec précision aux races futures d'êtres vivants dont ils devaient être les supports et les soutiens. » (p.211) Quoi ? Ne serait-ce pas encore une fois l'exacte inverse : la vie naissant en conséquence d'un terreau propice, plutôt que le terreau se façonnant lui-même dans le but de faire germer la vie ? Et comment justifier cet univers qui a pour but la vie dans une perspective non déiste ? Pire encore : « Aujourd'hui les espèces n'ont plus à naitre, mais seulement à subsister ». Pardon ? Alors certes, Schopenhauer n'a pas pu lire Darwin, mais tout de même, il ne semble pas s'extraire d'une vision théiste dans laquelle l'univers est figé avec la vie à son sommet, et c'est une claire régression par rapport aux anciens.
« L'effort de la matière ne peut qu'être contenu, il ne peut jamais être réalisé ou satisfait. C'est ce qu'il a de commun avec toutes les forces qui sont des manifestations de la volonté ; le but atteint n'est jamais que le point de départ d'une carrière nouvelle, et cela à l'infini. » (p.215) Toute matière et toute vie a comme unique fin de produire de la nouvelle matière et de la nouvelle vie. Cependant le « à l'infini » est contestable, puisque, sans même parler des modifications de la matière, la vie ne se reproduit pas à l’identique : je me demande ce que Schopenhauer aurait tiré de Darwin, qui semble lui manquer cruellement.
Terminons sur un beau morceau de pessimisme :« Tout acte particulier a un but ; la volonté même n'en a pas. » (p.216) Je crois qu'il se penche ensuite sur les conséquences de ce fait sur la condition humaine.
jeudi 24 octobre 2019
Le Monde comme volonté et comme représentation - Livre 1 - Schopenhauer
Après avoir découvert Schopenhauer avec Sur la liberté de la volonté humaine, je m'aventure dans son œuvre majeure, Le Monde comme volonté et comme représentation (1819). Mais je m'y aventure prudemment, en prenant mon temps, ainsi je ne vais faire le point ici que sur le premier livre du volume (de plus de 1400 pages). Déjà, Schopenhauer est étonnamment lisible. Son propos ne m'est pas toujours limpide, mais son écriture, elle, l'est. Ce premier livre ressemble à une base pour ce qui va suivre : il se penche sur la perception du réel, et étant donné le caractère très abstrait du sujet, l’ensemble peut paraitre un peu abscons. J'essaie donc de m'y dépatouiller.
Il commence par poser la différence fondamentale entre l'objet et le sujet : le sujet, c'est ce qui connait, l'objet, c'est ce qui est connu. Par exemple, notre corps est un objet pour notre conscience. Il amène ensuite la causalité et annonce dès la seconde page sa vision déterministe : « Un objet quelconque est lié nécessairement à d'autres, étant déterminé par eux et les déterminant à son tour. Cette loi est si vraie que toute la réalité des objets en tant qu'objets ou simples représentations consiste uniquement dans ce rapport de détermination nécessaire et réciproque ; cette réalité est donc purement relative. »
Viens ensuite l'entendement, la capacité de faire sens des perceptions : « De même que l'apparition du soleil découvre le monde visible, ainsi l'entendement, par son action soudaine et unique, transforme en intuition ce qui n'était que sensation vague et confuse. » (p.36) C'est la représentation du titre. Les sens ne sont pas l'intuition ; c'est l'entendement qui lie la cause et l'effet, l'entendement est donc la représentation de la causalité. Ainsi « Devant les sens et l'entendement, le monde se donne et se révèle avec une sorte de naïve franchise pour ce qu'il est, pour une représentation intuitive, qui se développe sous le contrôle de la loi de la causalité. » (p.40)
Après l'entendement vient la raison : « Savoir est l'unique fonction de la raison ; à l'entendement seul, en dehors de toute influence de la raison, appartient l'intuition. » (p.52)
Page 58, le relativisme de Schopenhauer semble aller un peu loin pour moi. Il tape sur le matérialisme en prétendant que celui-ci nie le sujet : « Il n'y a point d'objet sans un sujet ; tel est le principe qui condamne à tout jamais le matérialisme. » Et quelques lignes plus loin : l’œil est « l’intermédiaire indispensable de la connaissance, pour laquelle et dans laquelle seul le monde existe, sans laquelle il est impossible même de le concevoir ; car le monde n'est que représentation, et, par suite, il a besoin du sujet connaissant comme support de son existence. » Position extrême : l'univers n'existerait donc pas sans conscience pour le percevoir ? Mais alors, l'univers est-il né avec la perception ? Idée étonnante pour un non théiste. Ensuite les choses s'éclairent un peu : Schopenhauer semblait vouloir mettre en avant une contradiction : « Nous voyons donc que, d'une part, l'existence du monde entier dépend du premier être pensant, quelque imparfait qu'ait été cet être ; d'autre part, il n'est pas moins évident que ce premier animal suppose nécessairement avant lui une longue chaine de causes et d'effets, dont il forme lui-même un petit anneau. » Certes, mais je ne suis toujours pas convaincu par la justesse de la première partie du paradoxe : le monde est représentation pour nous, et sans nous, eh bien, le monde est tout court.
Schopenhauer fait ensuite honneur à sa réputation de pessimiste : il semble présenter la raison comme l'origine du doute, de l'erreur, de l'anxiété et du regret, rien que ça : « Si, dans le représentation intuitive, l'apparence peut un instant déformer la réalité, dans le domaine de la représentation abstraite l'erreur peut régner pendant des siècles, étendre sur des peuples entiers son joug de fer... » (p.64) Et il continue ainsi. Alors d'accord, mais quelle est l'alternative ? Rester dans la représentation intuitive ?
Récapitulatif (p.68) :
- L'entendement : « connaissance immédiate du rapport de cause à effet ; et l’intuition du monde réel, aussi bien que la prudence, la sagacité, la faculté de l'invention... »
- La raison : « la formation des concepts »
Toujours sur ce doute envers la raison : « la raison se porte toujours à reporter devant la connaissance ce qui a été perçu d'autre part, elle n'élargit pas à proprement parler notre connaissance ». L’entendement comprend la causalité des choses ; la raison transforme cela en concepts et permet donc de reproduire et modifier la causalité intuitivement saisie. (p.86,7)
Et donc je retrouve ce qui m'avait déjà marqué chez Schopenhauer reprit par Nietzsche : cette séparation de la conscience en deux parties qui ressemblent trait pour trait à celle développée, à grand coup d'études modernes, par Daniel Kahneman dans Thinking, Fast and Slow. C'est le duo connaissance intuitive / concepts abstraits. Comme Kahneman avec toute une vie de recherches scientifique derrière lui, Schopenhauer, à pas encore 30 ans, rappelle l'importance de l'abstraction, moins facile, si l'on peut dire, que l'intuition : « On peut acquérir, à l'aide du simple entendement, une connaissance intuitive immédiate du rapport causal des modifications et des mouvements des corps naturels, et s'en contenter pleinement ; mais on ne peut la communiquer que lorsqu'on l'a fixée dans des concepts. » (p.89)
Retour au doute envers la raison et la science : pour Schopenhauer, il y a à l'origine de toute preuve une vérité prise pour acquise, et donc non démontrée. (p.100) Ainsi, pour lui, « l'intuition est la source première de toute évidence ». (p.106) On le comprend donc quand il oppose la philosophie aux sciences : « Le propre de la philosophie, c'est qu'elle ne suppose rien de connu, mais qu'au contraire tout lui est également étranger et problématique... » (p.120) Il me semble que Nietzsche n'a pas été en grand désaccord avec ceci.
Pour conclure ce premier livre, Schopenhauer s'attaque, avec une relative bienveillance, aux stoïciens. J'aime sa discussion sur le sujet, et particulièrement la façon dont il regrette la vertu en tant que moyen vers le bonheur, et non en tant que but auquel il faut sacrifier le bonheur. (p.126, 131) Cependant sa vision des compagnons du Portique me semble un peu polluée par un absolutisme peut-être d'origine chrétienne : il pointe à juste titre que l'idéal stoïcien est presque (et c'est discutable) un « mannequin inerte, raide », et que « le contentement et le bonheur parfaits sont en opposition directes avec la nature humaine ». Certes, mais Schopenhauer prend cet idéal trop au sérieux, à la façon des chrétiens qui prennent trop au sérieux une perfection divine fantasmée. La position du stoïcien, ce n'est pas tant l'idéal que le chemin qui mène à l'idéal. Pensons à Sénèque se défendant face à ses détracteurs (avec une once de mauvaise foi d'ailleurs) : il ne prétend même pas que l'idéal soit atteignable, mais il défend le chemin qui y mène. Le philosophe marche ainsi, paisiblement et délibérément, entre l'inconscient, qui ignore le chemin, et le religieux, qui se flagelle faute de pouvoir jamais arriver à l'idéal au bout de la route. J'ai l'impression que Schopenhauer se rapproche de ce second cas.
Eh bien, à ce rythme-là, je ne suis pas près de voir le bout du Monde comme volonté et comme représentation : tout ce que je viens d'écrire concerne moins de 10% du volume.
Inscription à :
Articles (Atom)