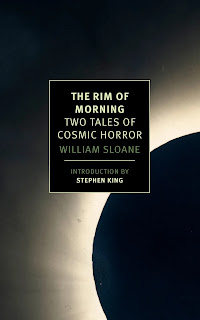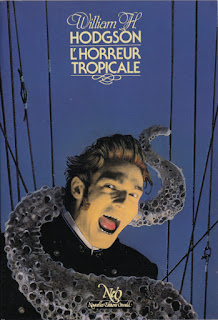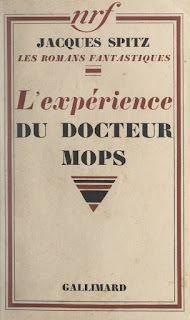mardi 31 décembre 2019
The Edge of Running Water - William Sloane (The Rim of Morning)
The Edge of Running Water partage en gros les mêmes thèmes et la même forme que l'autre roman de William Sloane, To Walk the Night. C'est plus ou moins un huit-clos qui prend le temps de développer les tensions entre les personnage et qui cache derrière son murder mystery un fond d'horreur cosmique, comme l'annonce fièrement la couverture de cette édition.
La narrateur va rejoindre un vieil ami à lui, un scientifique brisé par le décès de sa femme qui s'entête à percer le voile de la mort, dans un coin paumé du Maine. Il se retrouve à devoir gérer une jolie jeune fille (au cours d'une amourette vaguement gênante), son ami perturbé (syndrome classique du savant qui ne sait pas où s'arrêter), une femme médium étrange et coriace (élément perturbateur et malaise face à la féminité non conventionnelle) et une bourgade pleine de gens xénophobes et potentiellement amateurs de lynchages. La trame fonctionne très bien grâce au talent littéraire de Sloane : on navigue entre les genres, mais la prose reste élégante, efficace. J'ai craint un moment qu'il allait retomber sur une banale histoire de fantômes, mais heureusement ce n'est pas le cas. S'il y a bien, d'une certaine façon, un aperçu d'un autre monde, ce n'est pas un au-delà classique, loin de là. Ce sont les personnages qui projettent leurs désirs là où, finalement, il n'y a littéralement rien. Cependant j'aurais aimé que Sloane soit un poil plus clair sur ce sujet : qu'est-ce que la médium pouvait distinguer là-dedans ? Mais le fait est que quand le voile est levé, quand le monde les "âmes" est révélé, il n'y a rien d'autre qu'un chaos aveugle et dévastateur. C'est là le point fort du récit : les humains n'acceptent pas le néant et s’efforcent de le remplir par leurs fantasmes d'importance et leur besoin de causalité.
samedi 28 décembre 2019
Je suis Providence (t.1) - S.T. Joshi
Je n'ai pas pour habitude de lire des biographies, et pourtant, c'est la deuxième biographie de Lovecraft que je m'aventure à fréquenter (c'est dire l’attrait quasi obsessionnel que déclenche le personnage chez une certaine frange plus ou moins marginale de la population dont je fais apparemment partie). La première était celle de Houellebecq, il y a longtemps, qui, si je me souviens bien, parlait indirectement plus de Houellebecq que de Lovecraft. Le pavé de S.T. Joshi est autrement plus sérieux (et massif : 700 pages pour ce premier tome). J’apprécie l'introduction qui prend la peine de mentionner les divers choix de traduction, bien que l'indéniable qualité de la traduction soit entachée par une impressionnante quantité de coquilles et de fautes.
S.T. Joshi va dans les détails, c'est le moins qu'on puisse dire, et si j'ai parfois survolé quelques passages, le plaisir de lecture est incontestablement là. Je reprocherais peut-être à Joshi une certaine tendance à taper sur les doigts de Lovecraft à propos de ses opinions les plus douteuses, son racisme notamment. Et si on comprend bien le désir du biographe de se détacher ainsi de certains aspects de Lovecraft, on aimerait que nous soient épargnées ces leçons de morale basique. Ce premier tome commence par la famille de Lovecraft, explore son enfance, sa précocité intellectuelle, son adolescence (si le mot est adapté) solitaire, sa passion pour le journalisme amateur, ses nourritures littéraires et philosophiques, ses premières gloires d'écrivain et la première moitié de son mariage avec Sonia à New York.
Je ne vais pas citer Joshi, mais surtout Lovecraft. Ainsi, une auto-analyse de ses intérêts : « a) Amour de l'étrange et du fantastique. b) Amour de la vérité abstraite et de la logique scientifique. c) Amour de l'ancien et du permanent. Les diverses combinaisons de ces trois tendances expliqueront sans doute tous mes goûts étranges et mes excentricités. » (1920) En effet, ces trois idées se contredisent partiellement : ainsi Lovecraft a bien conscience de l'unité discutable que constitue une personnalité, à commencer par la sienne.
Dès son enfance (12, 13 ans) il lit énormément de science et écrit de nombreux essais d'astronomie ou de chimie. Il va jusqu'à écrire et imprimer lui-même des dizaines de journaux amateurs divers. Un petit exemple de ce qu'il écrit à 13 ans, à propos des canaux de la lune : « Concernant la théorie du professeur Pickering, à savoir qu'ils constituent des traces de végétation, je dois dire que n'importe quel astronome intelligent considérerait cette remarque comme indigne d'être relevée. »
Son rapport au catéchisme :
J'avais 12 ans et cette institution me désespérait. Aucune des réponses de mes pieux précepteurs ne me satisfaisait, et je le irritais à force de réclamer qu'ils cessent de prendre les choses pour acquises. Le raisonnement était quelque chose de fondamentalement nouveau dans leur petite mythologie sémite. Finalement, je me suis aperçu qu'ils étaient prisonniers de traditions et d'un dogme infondés, et j'ai alors cessé de les prendre au sérieux. (1920)L'apport de l'astronomie :
À 13 ans, j'étais complètement convaincu de la futilité et de l'insignifiance de l'homme, et à 17 ans, à l'époque où j'écrivis des textes particulièrement détaillés sur le sujet, je possédais, pour l'essentiel, les vues pessimistes sur le cosmos qui sont miennes à présent. La futilité de toute existence commença à m'oppresser et à m'accabler et je montrai de moins en moins d'enthousiasme et d'espérance vis-à-vis du progrès humain.Une petite phrase de Joshi que j’apprécie, à propos de la SF comparée au fantastique : « Dagon lui-même peut être considéré comme de la proto-science-fiction car le phénomène de l'intrigue étend étend nos compréhensions de la réalité plus qu'il ne les défie. » (p.338)
Mentionnons la folie (relative) des deux parents de Lovecraft. Son père qui finit dans un asile et sa mère à la fin pas si différente. Dans un passage frappant, une voisine décrit la mère de Lovecraft comme évoquant « des créatures étranges et fantastiques qui surgissaient de derrière les immeubles et des recoins à la nuit tombée ».
Sur sa position artistique : « Le rapport de l'homme avec lui-même ne me captive pas. C'est sa relation au cosmos - à l'inconnu - qui seul parvient à enflammer mon imagination créative. La pose authropocentrée m'est impossible, car je ne puis acquérir la myopie primitive qui magnifie la terre et ignore l'arrière-plan. » Mais pourtant, dans la perspective cosmissiste d'un univers indifférent, que reste-t-il à part le rapport de l'homme à lui-même ?
Aussi, je n'avais pas pleinement réalisé ce que Lovecraft doit à la philosophie antique (notamment les épicuriens, Lucrèce), à Schopenhauer et surtout à Nietzsche (notamment ici : « Si un acte correspond à nos désirs, c'est la nature à travers nous qui a formulé ce désir, et assuré son accomplissement. »). Et un extrait où on croirait lire les stoïciens : « Dans la perspective de l'infinité cosmique, la victoire d'un enfant aux billes n'a rien à envier à celle d'Octave à Actium. » Plus loin : « Quelle importance si personne n'entend jamais parler du fruit de mon travail, ou si ce travail n'affecte que les médiocres et les affligés ? Il est sans aucun doute important d'offrir à ces malheureux le plus de bonheur possible ; et celui qui se montre gentil, serviable et patient avec ses frères de misère ajoute autant de capital de sérénité du monde que celui qui, doué de plus grandes facultés, promeut la naissance d'empires, ou fait avancer le savoir de la civilisation et de l'humanité. » Une idée qui prend particulièrement sens quand on considère l'opinion de Lovecraft que l'humanité ne va nulle part en particulier sinon vers sa propre fin ; ainsi la notion de progrès devient quasi absurde.
Pour conclure ce premier tome, peut-être le passage de plus drôle : quand, à New York, un ami de Lovecraft veut lui donner le job de rédacteur en chef de... Magazine of Fun !
Libellés :
Je suis Providence,
Joshi S.T.,
Lettres,
Lovecraft H.P.,
Philosophie
vendredi 20 décembre 2019
Hommage to Catalonia - George Orwell
Dans Homage to Catalonia (1938) Orwell évoque son expérience personnelle au cours de la guerre civile espagnole (qui n'était pas encore terminée à la publication du livre). Un peu comme en lisant l'excellent Dans la dèche à Paris et à Londres (1933) et, dans une moindre mesure (c'est un roman partiellement autobiographique), Burmese Days (1934), on est étonné par l'aventurisme nonchalant d'Orwell. Il a envie de combattre le fascisme et d'écrire quelques articles, alors il va en Espagne, directement au front. Au moins, il accorde ses actes à ses opinions. On ne peut que respecter cette sincérité, bien que j'ai un peu grincé des dents à certains passages : après tout, il va faire la guerre. Il va tuer.
Le début est un peu pénible. Le lecteur est plongé dans le vif du sujet sans guère de contexte et mieux vaut prendre le temps de faire quelques passages sur Wikipédia. Orwell est au front, c'est un récit de guerre un peu vide dans lequel on met du temps à comprendre les enjeux. C'est un conflit absurde, où les miliciens, faute d'équipement, ne font pas grand chose d'autre que manger leurs rations, accumuler des poux, grelotter vainement et se prendre des balles perdues. On est frappé par l'union entre anarchistes et communistes qui luttent contre Franco et le fascisme. Dans le feu de l'action, l'utopie socialiste semble presque réalisée, officiers et soldats sont frères, le mot camarade a vraiment du sens. Mais, une fois qu'Orwell revient à Barcelone, cette belle union tombe en morceaux : elle est réservée aux honnêtes combattants, mais dans les grandes villes, on s'étripe idéologiquement. Orwell est traqué, en tant que membre d'une faction soudainement jugée « trotskiste ». L'URSS œuvre dans l'ombre pour empêcher une révolution espagnole qui risque fort de ne pas mimer le stalinisme et qui affaiblirait les alliés de l'URSS, et finalement les anarchistes et les socialistes authentiques, ceux qui ont combattu, les hommes du peuple, se retrouvent pris entre les étaux de la démocratie capitaliste, de l'URSS monolithique et du fascisme lui aussi capitaliste. Face à toutes ces forces, les révolutionnaires sont trompés, décriés et finalement écrasés à grand coup de propagande. On voit là ce qui a nourri 1984 : la force arbitraire des superpuissances, la destruction de la vérité au profit de l’intérêt des dites puissances et la négation de la valeur de la vie humaine individuelle.
Mentionnons aussi l’imperturbabilité peut-être typiquement anglaise d'Orwell. Ainsi, quand il se prend une balle : « The whole experience of being hit by a bullet is very interesting and I think it is worth describing in details. » Une autre anecdote croustillante : quand la police fouille la chambre d'hôtel de sa femme façon Gestapo. Ils tombent sur Mein Kampf, ce qu'ils prennent comme un aveu de fascisme, mais ils sont ensuite apaisés quand ils trouvent un pamphlet de Staline sur la façon dont il convient de liquider les trotskistes. En somme, un bouquin important pour mieux comprendre l'Europe et plus précisément la partie sanglante mais souvent négligée de son histoire. J'ai envie de conclure en mentionnant d'autres livres lus récemment qui ont le même effet : We The Living, d'Ayn Rand, à propos de la vie dans la jeune URSS (un roman particulièrement brillant), The Cellist of Sarajevo, sur le siège de la capitale, et Girl at War, sur plus globalement la guerre de Yougoslavie.
Libellés :
Essais,
Orwell George,
Récits de voyage/survie/guerre,
Société,
Univers réaliste
dimanche 15 décembre 2019
Dark Gods - T.E.D. Klein
T.E.D. Klein a fait sa thèse sur Lovecraft, qui est décidément incontournable. Klein n'a que peu écrit et Dark Gods, publié en 1985, regroupe quatre grosses nouvelles. L'ensemble mérite le coup d’œil : Klein sait écrire et sa grande force se trouve souvent dans l'étoffement de ses personnages.
La première nouvelle, Petey, se déroule dans un cadre classique : un grande maison un peu sinistre dans un endroit paumé. Mais ce cadre est utilisé d'une façon inventive : les propriétaires donnent une soirée avec une trentaine de personnes, essentiellement des couples plus qu'aisés dont les hommes travaillent dans la finance et les femmes s'occupent de décoration intérieure. Klein arrive à donner rapidement de la personnalité à sa nuée de personnages, et on apprend notamment, au bout d'un moment, que les heureux propriétaires ont acquis leur bâtisse d'une façon peu honorable. L'ancien propriétaire était un homme bizarre. Toute la nouvelle est en fait une longue accumulation d'indices qui laissent entrevoir le dénouement sanglant, et le lecteur ne manque pas de sourire, car il voir ce à quoi les personnages restent aveugles. La technique est maniée avec doigté : au bout d'un moment, l'accumulation de signes annonciateurs devient si colossale, si ridiculement évidente, que j'en suis venu à me dire que l'auteur ne pouvait se permettre une telle libéralité que s'il faisait une fin très ouverte. Avec une telle tonne d'indices, toute conclusion sanglante ne pourrait être qu'évidente et plate. Et j'avais bien vu : la fin est en queue de poisson. Ainsi la nouvelle dépasse son postulat classique de maison hantée par un monstre grâce à une forme narrative plus recherchée.
Si Petey était une entrée en matière tout à fait sympathique, le niveau monte d'un cran avec Children of the Kingdom. Dans un New York qui suinte la misère, la violence et la peur, la narrateur cherche une maison de retraite appropriée pour son grand-père. Le grand-père s'adapte sans souci à sa nouvelle vie et, malgré le caractère peu fréquentable du quartier, il passe ses journées à l'extérieur à papoter avec une mama noire et un vieux latino qui se prétend prêtre et a écrit un obscur bouquin révisionniste sur les origines de l'homme. Il défend l'existence d'une autre race, maudite par Dieu, qui aurait chassé les hommes originels de l’éden. En parallèle, des événement étranges se produisent dans la mégalopole. Il y a des rumeurs sur d'étranges hommes à la peau pâle, sans visage, qui malgré leur absence de sexe humain rôdent à la recherche de femmes vulnérables. On le devine, ces deux trames vont se rejoindre jusqu'à ce que le narrateur dévoile juste assez de la sombre vérité pour avoir certainement des nuits blanches pendant le reste de sa vie. Déjà, Klein accroche facilement avec sa narration, ses personnages vivants et même pétillants. L'horreur s'insinue par petites touches, progressivement. Il joue énormément sur les peurs raciales, comme Lovecraft, mais aussi sur les peurs sexuelles, en parvenant à ne jamais tomber dans le glauque gratuit. C'est une métaphore de la promiscuité et de la misère d'une mégalopole où l'étranger, l'agresseur, le violeur, le décadent, prend une forme véritablement monstrueuse. Habile et prenant, la meilleure nouvelle des quatre.
Black Man with a Horn est presque une conversation avec Lovecraft. Le narrateur est un vieil écrivain qui se désole que son œuvre n'existe que dans l'ombre du reclus de Providence, et le texte lui est adressé. La narrateur se retrouve plongé dans ce qui ressemble à un récit de Lovecraft quand l'homme assis à côté de lui dans un avion, un missionnaire, lui raconte ce qu'il a vécu dans un coin reculé d'Afrique. Ensuite la trame s'épaissit, tout en restant très floue, et le narrateur fait beaucoup de recherches en bibliothèque. Classique. La partie, disons, horrifique de cette nouvelle est un peu décevante tant on reste dans l'évasif, mais la trame plus personnelle, la personnalité du narrateur et le thème de la création littéraire lui donnent néanmoins une épaisseur appréciable.
C'est un peu la même chose avec Nadelman's God : un récit très prenant mais qui déçoit un peu sur la partie horreur. Nadleman est toute la définition du succès : un boulot dans la pub, un bon appart à New York, une femme et une amante... Mais un beau jour, un groupe de rock utilise un poème fantastique qu'il avait écrit à seize ans et un type étrange commence à être obsédé par ses vers. Le petites habitudes de Nadleman se font lentement chambouler et il doit replonger dans son adolescence, quand il avait encore des ambitions créatives, peut-être un peu naïves. Le rapport au harceleur est excellent, mais je suis moins convaincu par l'espèce de monstre.
Libellés :
Fantastique,
Klein T.E.D.,
Littérature,
Science fiction
jeudi 12 décembre 2019
To Walk the Night - William Sloane (The Rim of Morning)
The Rim of the Morning est la réédition des deux romans de William Sloane. Le premier est To Walk the Night, publié en 1937. Il existe une édition française, sous le titre Lutte avec la nuit. Mais mieux vaut avoir une couverture sobre, tant les couvertures illustrées ne peuvent pas vraiment faire autrement que révéler certains éléments de ce qui est un mélange d'horreur cosmique, de roman à suspense et de drame familial. Le résultat est assez brillant.
To Walk the Night commence lentement. Le narrateur revient chez son père adoptif après le suicide de Jerry, son ami de toujours et fils de sang du père en question. Le narrateur entreprend de lui raconter tout ce qui a mené à ce suicide. Tout commence par le meurtre inexplicable d'un ami de Jerry, mathématicien et astronome. Sa veuve, magnifique et étrange, semble réagir de façon détachée. Jerry s'éprend d'elle et, allant contre toutes les normes sociales, ils ne tardent pas à se marier. Mais cette femme, on s'en doute, cache quelque chose.
Pas la peine d'aller beaucoup plus loin dans les détails du récit. L'écriture de William Sloane est tranquillement littéraire et le récit coule comme la plus élégante des rivières. Le suspense provient du mystère qui entoure la mort du mathématicien et de l'identité de sa veuve au nom éloquent : Selena. Ce n'est pas un vulgaire suspense de polar : il ne s'agit pas de trouver qui est l'assassin. Non, il ne s'agit pas d'une connaissance aussi bassement spécifique, mais de la connaissance en général. Une vérité qui chamboule les bases de l'univers rationnel et borné dans lequel les personnages ont l'habitude de vivre. Comme chez Lovecraft, cette vérité, cette connaissance, est une menace pour l'équilibre mental des personnages. L'un se suicide, un autre se noie dans la peur, un autre encore refuse l'évidence pour s'accrocher à l'explication rationnelle. Comme toujours, ces réactions sont un choix esthétique : après tout, pourquoi les personnages des histoires d'horreur cosmique ne ressentiraient-ils pas un peu d'émerveillement face à la découverte de l'inconnu et l'élargissement de leurs horizons ? Car, d'une certaine façon, c'est ce que ressent le lecteur. Mais les protagonistes subissent l'esthétique de cette littérature : ils sont les victimes sacrificielles offertes à l’appétit du lecteur. Ce sont sont eux qui souffrent sous les coups de butoir la vérité : la petitesse de l'humain dans l'univers, son insignifiance, et l'existence de choses bien plus grandes et vastes pour lesquelles le temps et l'espace, les barreaux de notre prison, ne sont rien. Ainsi le lecteur exorcise son nihilisme dépressif et peut cultiver son nihilisme positif : pour lui, comme pour Lovecraft, la position esthétique de l'horreur cosmique est une position philosophique, mais son angoisse se sublime dans l'art, et il est libre de goûter à ce qui est refusé aux personnages : la jouissance dans la découverte de l'inconnu total. Au fond, l'horreur cosmique est optimiste : elle postule qu'il y a autre chose.
William Sloane, dans To Walk the Night, va plus loin que Lovecraft dans cet « optimisme ». Ses personnages s'aiment, ils ont une vie sociale dense, et tout le récit est centré autour cette vie sociale : le problème est qu'une chose indéfinissable, chez cette femme, coince socialement. Toute la tension vient de détails de conversations, d'étrangetés du comportement. Mais, au fond, ce qui est vraiment optimiste, c'est que l'humanité aurait finalement un petit quelque chose d'unique, une essence qui mériterait qu'un étranger vienne y goûter.
lundi 9 décembre 2019
La Chose dans les algues - William Hope Hodgson
Ce recueil, dont j'aime particulièrement la couverture, recèle diverses nouvelles de William Hope Hodgson, l'auteur de La Maison au bord du monde. Les meilleures du recueil sont certainement L’Épave et La Voix dans la nuit, ce sont d'ailleurs les deux nouvelles (lues en VO par ici) qui m'ont convaincu d'explorer l’œuvre de Hodgson plus en détail. On trouve à la fin du bouquin deux courtes aventures de Carnacki, enquêteur du surnaturel, mais j'avoue ne même pas être allé au bout de la première. Ceci dit, il y a du bon là-dedans, mais du passable aussi. D'autres nouvelles maritimes dans L'Horreur tropicale.
Les Chevaux marins (The Sea Horses) ouvre le bal en opposition totale au ton annoncé par la couverture. Loin de toute créature tentaculaire, un jeune garçon habite chez son grand-père qui lui raconte histoires extraordinaires sur les chevaux marins. Le garçon se prend au jeu, d'autant plus que le grand-père lui construit un charmant petit cheval marin en bois. Pour fuir une épidémie, ils vont se réfugier sur le bateau du grand-père, qui est plongeur. Le gamin, vraiment, se prend trop au jeu... Une nouvelle étonnante par sa sensibilité. Le gamin est franchement un sale gosse, le grand-père est renfrogné et pas bavard, mais ils sont très humains et leur relation parait naturelle. On est face à l'enfance et à la puissance des histoires, l'imagination pouvant encore prendre le pas sur la réalité. J'aurais aimé savoir pourquoi le grand-père est sous-marinier (mais qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps sous l'eau ?!) et la fin est un peu too much. Ceci dit, Hodgson déploie là un talent inattendu de conteur. La fin, très sombre, est ponctuée par une vision chrétienne de l'après-vie que j'interprète comme n'étant que les hallucinations d'un grand-père déchiré par la douleur et affaibli et son activité sous-marine immodéré. À mes yeux Hogson ne peut qu'être matérialiste, ce qui rend cette fin d'autant plus habile de sa part : il écrit les croyances de son personnage tout en s'en distançant.
La nouvelle éponyme, La Chose dans les algues (The Thing in the Weeds, 1912), revient aux tentacules auxquels on s'attend. Mais sa forme est étonnamment moderne : on a vraiment l'impression de retrouver la structure d'un bon film de monstre à la Alien. Dans la mer des Sargasses, un navire se fait comme d'habitude attaquer par un vil poulpe géant, mais cette fois le ton est tout en retenue. Pendant la majeure partie du récit, on ne voit pas le monstre, c'est une forme vague qui rôde dans les ténèbres, on le devine, on le sent, on l'entend, il crée la terreur, mais impossible d'être certain de quoi que ce soit. Dommage que la fin ne parvienne pas à parachever cette montée de la tension, mais j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle qui ressemble à un prototype bien foutu du genre "film d'horreur à monstre".
De la mer immobile (From the Tideless Sea, 1906) est, je crois, la première nouvelle de Hodgson à mettre en scène la mer des Sargasses. On retrouve donc des ingrédients familiers, algues et poulpes, et si la narration parvient à mettre en scène une certaine tension, Hodgson a fait mieux par la suite. Reste la bonne idée de ce pauvre couple bloqué pendant des années dans la mer des Sargasses. Le Cinquième message (From the Tideless Sea Part Two: Further News of the Homebird, 1907) en est la suite directe, et si on pouvait espérer un développement de cette situation, c'est plutôt décevant : la narrateur est toujours bloqué sur le navire avec sa femme et sa jeune fille, mais il ne se passe rien d'autre qu'un jeu de cache-cache avec un énième monstre qui n'a rien d'unique à offrir.
Dans L'Île de Ud (The Island of the Ud, 1912), on passe à se la chasse au trésor. Les deux personnages, un capitaine alcoolique et violent et un jeune mousse, ne font pas oublier la banalité de l'aventure : ile mystérieuse, autochtones agressifs et plus ou moins bestiaux, jolie jeune femme sacrifiée à un crabe géant... Bof bof. L'Aventure au promontoire (The Adventure of the Headland, 1912) reprend les mêmes personnages et la même structure avec un peu plus de succès. L'accent est vraiment mit sur la relation entre le capitaine lunatique et le mousse débrouillard, qui passent leur temps à se chamailler, même pourchassés.
Le Mystère de l'épave (The Mystery of the Derelict, 1907) est une nouvelle variation sur la mer des Sargasses. Épave et rats géants. Parfaitement oubliable. Par contre, Le Dernier voyage du Shamraken (The Shamraken Homeward-Bounder) revient à une sensibilité qui rappelle la première nouvelle de ce recueil. Le Shamraken est un antique navire avec un équipage tout aussi antique : le mousse a 55 ans et tous les autres sont encore plus vieux. Ils font leur dernier voyage et ils s'inquiètent pour la retraite forcée qui les attend : après tout, la navigation est toute leur vie, il n'y rien pour eux à terre. Mais voilà qu'un étrange brouillard se lève, une ambiance mystique tombe sur le navire, d'autres phénomènes étranges se montrent : les vieux marins, rendus larmoyants par l'émotion, sont persuadés d'être devant les portes du paradis. Eh non : ce n'était que le début d'un typhon. Alors ils meurent tous, mais pas de signe du paradis. Un excellent petit récit, drôle et touchant
Le Bateau de pierre (The Stone Ship) semble tout d'abord être une énième aventure maritime : une étrange épave, de méchants monstres... La nouvelle prend du temps à décoller, mais on se rend bientôt compte qu'on est dans une veine différente qui commence à me sembler récurrente chez Hodgson : la puissance de l'imagination humaine. En effet, par la suite, tous les évènements sont expliqués rationnellement : le navire de pierre était en fait une vieille épave minéralisée remontée par un glissement de terrain sous-marin, les hommes de pierre n'étaient que des cadavres minéralisés mais recouverts par des limaces de mer qui donnaient une impression de mouvement... Et j'ai vraiment l'impression de voir comment Lovecraft a pu en tirer des leçons. Après tout, il aime bien les antiquités surgies du fond des mers par des glissements de terrain (Dagon, L'Appel de Cthulhu) et chez lui aussi ces choses étranges s'expliquent rationnellement. Hélas, retour à du plus que médiocre avec L'Équipage du Lancing (The Crew of the Lancing). Il y a une éruption volcanique sous-marine, seul point intéressant, mais Hodgson n'en fait rien : navire hanté, vils montres et ennui. Les Habitants de l'îlot du milieu (The Habitants of Middle Islet) bouscule un peu la formule et parvient à instaurer une véritable curiosité et une tension habile autour d'un navire bizarrement abandonné, mais il manque une conclusion efficace. Le Monstre de l'île aux algues (The Voice in the Dawn) est une énième visite de la mer des Sargasse particulièrement dénuée d'intérêt.
Libellés :
Fantastique,
Hodgson W. H.,
Littérature,
Science fiction
vendredi 6 décembre 2019
The Limits to Growth - Club of Rome
Faith in technology as the ultimate solution to all problems can thus divert our attention from the most fundamental problem—the problem of growth in a finite system—and prevent us from taking effective action to solve it.
Paru en 1972, The Limits to Growth est une étape importante de la pensée environnementaliste. En gros, ses auteurs, des chercheurs du MIT notamment, utilisent un modèle du développement humain basé sur cinq variables : la démographie, l'économie, la pollution, la production de nourriture et les ressources naturelles. Ils ont beau tourner ce modèles dans tous les sens crédibles, une seule conclusion s'impose : les limites de la croissance seraient atteintes avant 2100 et s’accompagneraient d'un effondrement global, d'un désastre environnemental et d'un grand manque de ressources naturelles pour les générations suivantes. En conséquence, ils recommandent de se débarrasser de la croissance, ou de moins de la croissance débridée. (Et ils ne prennent même pas en compte le réchauffement climatique.) Des idées que l'on retrouve toujours aujourd'hui, et toujours en marge, dans Prospérité sans croissance ou Tout peut changer pour n'en citer que deux.
Ils aiment beaucoup les courbes exponentielles. En effet, la croissance humaine est souvent caractérisée par des courbes exponentielles. Problème : tout va si vite qu'il est impossible de saisir les conséquences des "progrès" avant de les subir à grande échelle. Autre problème, plus limpide, et devenu depuis un classique : toute croissance infinie dans un système fini est impossible. Il est un peu triste de lire leurs espoirs et de constater que strictement n'a été fait dans ce sens depuis 57 ans. Notamment quand ils espèrent que les missions de CO2 seront limitées avant qu'elles aient des effets néfastes... Et déjà ils mentionnent et critiquent le courant techno-optimiste, pour ne pas dire techno-utopiste, qui voit le progrès comme apportant nécessairement les solutions à ses potentiels problèmes.
Ci-dessous quelques graphiques tirés du bouquin indiquant différentes possibilité de l'évolution du rapport entre croissance et capacité de l'environnement à permettre cette croissance.
mercredi 4 décembre 2019
L'Horreur tropicale - William Hope Hodgson
L'auteur de La Maison au bord du monde m'avait plus que convaincu avec deux nouvelles lues récemment. Et je ne peux que difficilement résister à de telles couvertures (quoique ce n'est pas encore la meilleure). Il y a du bon et du moins bon là-dedans, la première et surtout la troisième nouvelle méritent le détour.
La nouvelle éponyme, L'Horreur tropicale (A Tropical Horror, 1905) est amusante par son manque absolu de retenue. Le narrateur est sur un bateau, et paf, tout d'un coup, dès la première page, un gros monstre surgit des flots et sème la terreur sur le pont. Tout le monde se planque et le narrateur est bloqué avec un mousse dans un abri précaire. Il reste coincé là pendant plusieurs jours alors que la chose (dont on ne distingue jamais vraiment la forme sans savoir si c'est voulu par Hodgson ou simplement dû à une écriture maladroite) massacre absolument tout le monde. Ce n'est pas un récit particulièrement fin, mais cette accumulation de tentacules et de morts horribles parvient néanmoins à être réjouissante.
Une Voix dans la tempête (Out of the Storm) est un peu un piège : un marin qui subit les assauts d'une chose envoie un message de détresse grandiloquent. Mais on comprends rapidement que la chose en question n'est pas un énième monstre, mais l'océan lui-même. Ce qui est monstrueux, c'est la petitesse de l'humain face aux éléments et les horreurs commises sous l'impulsion des instincts de survie qui ressurgissent. Une pirouette appréciable
A la recherche du Graiken (The Finding of the Graiken, 1913) est une nouvelle clairement plus ambitieuse. Une structure classique mais efficace : la narrateur, ayant récemment hérité d'un oncle (comme toujours) se retrouve en possession d'un navire et décide d'aller faire une croisière en compagnie d'un ami dont l'amoureuse a récemment disparu en mer. L'ami a un comportement bizarre, fomente une mutinerie, dirige le navire vers la mer des Sargasses où, en plus de tonnes d'algues et de pieuvres vicieuses, ils retrouvent le navire de la bien-aimée. Le récit est percutant et dynamique, mais il est surtout mémorable pour un autre aspect. L'ami mutin est presque comme possédé : à la fin de l'aventure il ne se souvient de rien et à un moment il a une prémonition, il s'exclame "Il arrive !" alors qu'un courant mystérieux déblaie les algues et leur permet d'atteindre l'autre navire. C'est tout, pas de détails. Mais voilà ce que je comprends : en plus des vils poulpes, la mer des Sargasses est habitée par au moins une mystérieuse entité de taille massive. Elle a pris possession à distance de l'ami mutin pour le mener jusqu'à sa copine et c'est elle qui déblaie les algues avec son corps massif, sans jamais se montrer. Vraiment, c'est très habile de la part de Hodgson : la,partie la plus importante de son récit n'est pas explicite, ce qui est gratifiant pour le lecteur. Et je ne serais pas étonné que Lovecraft ait trouvé là de l'inspiration : souvent, dans ses nouvelles, une menace plus profonde et insaisissable que celle qui occupe le cœur de l'intrigue rôde loin des regards
On change de genre avec Eloi Eloi Lama Sabachthani (1919). Un savant prétend expliquer l'épisode des ténèbres de la croix, dont je ne me souvenais pas, par une théorie de la lumière. Il fabrique une substance qui permet de la répliquer et il se l'injecte avant de s'infliger un supplice parodiant celui du Christ. À la fin il crève avec ce qui ressemble à un moment de possession démoniaque. Un nouvelle peu intéressante et pénible à lire à cause des scènes d'automutilation. Le Réservoir de la peur (Terror of the Water-Tank, 1907) est une sorte d'intrigue policière, mais disons que quand on a un peu lu Hodgson, on a besoin que du titre deviner que le coupable est une bestiole quelconque qui se planque dans le réservoir.
Retour à l'océan avec L’Albatros. Un récit d'aventure parfaitement classique : un albatros apporte un message d'une damoiselle en détresse, le valeureux narrateur défie les ordres de son capitaine pour partir à sa recherche, il fait preuve de courage et de virilité, dégomme un millier de rats (vraiment) et chope la jolie jeune fille en détresse. Bon, pas franchement mauvais, mais d'un intérêt limité. On achève ce recueil avec Le Fantôme de lady Shannon (The Haunting of the Lady Shannon). Encore une fois, bof : un vil capitaine et ses seconds martyrisent un équipage, on devine qu'un vrai/faux fantôme va venir les embêter.
Libellés :
Fantastique,
Hodgson W. H.,
Littérature,
Science fiction
lundi 2 décembre 2019
L'Expérience du docteur Mops - Jacques Spitz
L'Expérience du docteur Mops (1939) n'est pas un roman majeur de Jacques Spitz. Déjà, la forme est plus plus classique dans la plupart de ses autres œuvres : pas d'évènements qui bouleversent l'ordre mondial, ou presque, et on reste accroché au point de vue d'un unique personnage. Pierre, architecte colonial en congé, se ballade dans le sud de la France et rencontre une jeune damoiselle en la sauvant de la noyade. S'ensuit une amourette assez classique, mais très bien décrite : j'ai pas mal rigolé tant Spitz parvenait à me faire m'identifier à son narrateur, qui s'éprend d'une jeune fille tout à fait charmante avec un mélange bien dosé d’enthousiasme et d’appréhension. Mais la jolie a un beau-père suspect : l'éponyme docteur Mops, figure classique du savant aux activités louches que l'on retrouve ailleurs chez Spitz et qui vient peut-être directement de chez Wells et plus particulièrement de L'Ile du docteur Moreau.
L'expérience de Mops, progressivement révélée, se rapproche de celle que l'on trouve dans L’œil du purgatoire : il travaille à projeter la conscience de son cobaye humain dans le futur. Comme souvent avec les histoires de manipulation temporelle, il m'a semblé percevoir des incohérences, mais rien de trop dramatique. Quand le cobaye révèle la mort future de la femme aimée, le roman se transforme en mélodrame un peu lourd. Il est également regrettable que l'argument science-fictif ne mène finalement pas à grand chose, notamment parce que Spitz fait l'étrange choix, au lieu d'aller au bout des possibilités, de laisser planer le doute sur la réalité de la chose. Frustrant. Ceci dit, L'Expérience du docteur Mops se lit avec aisance, tant Spitz, même quand il n'est pas au sommet de sa forme, parvient à attiser la curiosité avec une profonde ironie sous-jacente, et le voir se pencher sur un format narratif plus sobre n'est pas sans intérêt.
Inscription à :
Articles (Atom)