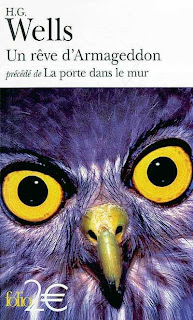Affichage des articles dont le libellé est Wells H.G.. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Wells H.G.. Afficher tous les articles
dimanche 18 décembre 2016
The Country of the Blind - H.G. Wells
J'ai consommé cette nouvelle d'une façon particulière : en la lisant en version originale sur wikisource, tout en écoutant une version audio, très agréable, disponible également sur wikisource. Ça dure une heure, et c'est chouette.
Quelque part dans les Andes, perdue dans une vallée isolée, existe une petite civilisation. Ils sont peu nombreux, quelques centaines, peut-être moins, et depuis quinze générations, tous sont aveugles. Dans leur petit coin paisible, la vie n'est pas trop dure pour eux, et leurs autres sens se sont développés pour palier à leur absence de vision. Et un beau jour, après une longue chute dans la neige, le long de pentes abruptes, égaré, voici qu'arrive un homme du dehors. Un homme qui voit.
“What is blind?” asked the blind man, carelessly, over his shoulder.
Se sentant supérieur, il est tenté d'abuser de sa force. Les locaux croient que leur vallée est le monde, qu'au dessus de leurs têtes se dresse un plafond bien défini, que le chant des oiseaux est la voix des anges. L'homme qui voit désire le pouvoir, mais seul, il ne peut qu'échouer. Alors il se résigne, et accepte les coutumes locales. Peu importe la vérité quand il faut manger. Considéré comme un handicapé simplet, incapable de percevoir les sons avec finesse, son intégration se poursuit lentement, jusqu'à ce que l'amour le mette face à un grand problème : doit-il renoncer à sa vision pour devenir définitivement l'un des leurs ?
Dans cette petite nouvelle à la prose délicieuse, Wells examine la normalité. Pour ces aveugles, la normalité est de ne pas voir, ils ignorent l'existence d'un sens supplémentaire. Non seulement toute leur conception du monde en est chamboulée, mais cela pose la question suivante : et si l'humanité dans son ensemble ignorait un ou plusieurs sens ? Et si chacun d'entre nous était comme l'un de ces aveugles, incapable de voir l'évident ? Et il semble que ce soit le cas, il n'y a qu'à voir (ou pas, du coup) le spectre limité de la vision humaine par rapport à tout ce qui pourrait être perçu. Ce genre d'idée a été exploré vers la même époque par Rosny dans Un autre monde puis par Maurice Renard dans L'Homme truqué. Et l'homme étant un animal social, la normalité est définie par les croyances communes. Ainsi, étant le seul à voir, que ce soit vrai ou non, l'étranger est fou, et en vient à douter lui-même de la réalité de ses perceptions. La fin de la nouvelle, magnifique, fait ressentir au lecteur toute la beauté des choses simples qui l'entourent, beauté qui apparait à l'étranger quand il est sur le point de la perdre. Dans The History of Mr. Polly, Wells fait redécouvrir cette beauté à son personnage : « After a lapse of fifteen years he rediscovered this interesting world, about witch so many people go incredibly blind and bored. He went along country roads while all the birds were piping and chirruping and cheeping and singing, and looked at fresh new things, and felt as happy and irresponsible as a boy with an unexpected half-holiday. » (p180)
Allez, je m'autorise un plaisir rare : une petite morale.
Ne soyons pas aveugles à la beauté gratuite.
1904
mercredi 14 décembre 2016
The History of Mr. Polly - H.G. Wells
Quand le roman commence, Mr Polly est un homme de 37 ans, sujet aux indigestions, propriétaire malheureux d'un petit magasin d'habillement enfermé dans un mariage raté. Mr Polly n'aime pas sa vie, pas du tout. Du coup, gros retour en arrière pour comprendre comment il en est arrivé là. Un parcours fort banal : études plus que minimales, employé dans divers magasins, décès du paternel et héritage, mariage foireux et lancement du petit magasin. Les quinze années suivantes passent en un éclair, un éclair de totale platitude, et l'on se retrouve au point de départ. Pour en finir, Mr Polly décide de se suicider. Mais en faisant croire à un accident, pour que sa femme puisse avoir l'argent de l'assurance, parce que Mr Polly est gentil. Mais il se loupe totalement. Cependant, cette tentative de suicide ratée est une révélation : il est libre ! Il peut faire ce qu'il lui chante ! Mr Polly s'improvise donc vagabond, se ballade sur les routes, et finira par trouver sa place dans une auberge campagnarde.
Le ton employé par Wells, presque satirique mais pas tout à fait, est un régal. C'est très drôle, même si j'ai dû passer à coté de pas mal de jeux de langage. Mr Polly est un personnage fort attachant. J'ai lu sur la page Wikipedia anglophone du roman qu'il serait une version de Wells n'ayant pas eu la chance de faire des études, et cela me semble pertinent. Polly est plutôt intelligent, il aime lire et jouer avec les mots, il aime son prochain mais aussi se balader seul dans la nature. Une scène particulièrement réussie montre son premier contact avec des canetons : « Mr. Polly had never been near young duckling before, and their extreme blondness and the delicate completness of their feet and beaks filled him with admiration. It is open to question whether there is anything more friendly in the world than a very young duckling. » Bref, Polly est sensible à la beauté, il a du potentiel, mais n'a jamais eu la chance de le développer. Du coup, il est resté flou, frustré, incertain, accompagné d'un profond sentiment d’insatisfaction. Au cours de son mariage, il sait au fond de lui qu'il fait une erreur, qu'un mouvement passager ne devrait pas l'engager sur toute une vie : « He tried to asssure himself that he was acting upon his own forceful initiative, but at the back of his mind was the complete realization of his powerlessness to resist the gigantic social forces he has set in motion. » Polly se fait entrainer par les évènement, passif, jusqu'au moment où il se réinvente. Plus de travail désespérant, plus de vie conjugale encore plus désespérante. A la fin du roman, un vil personnage vient menacer la tenancière de l'auberge où Mr Polly s'est refait une nouvelle vie, et ces quelques pages au ton plus belliqueux ne sont pas les plus passionnantes. Pourtant, elles font sens dans la construction romanesque : c'est la première fois que Polly est confronté à un grave problème, une menace qui requiert de sa part une réponse vive, une conviction. The History of Mr. Polly est un excellent morceau de littérature sur la vie banale d'un homme banal. Un peu comme pour The New Machiavelli, une partie du plaisir vient d'une certaine empathie, ou plutôt d'une empathie certaine, pour le personnage principal.
234 pages, 1910, Penguin Books
mercredi 30 novembre 2016
L'île du docteur Moreau - H.G. Wells
Un classique qui a mieux vieilli que dans mes souvenirs. Prendick, le narrateur, survit de justesse à un naufrage et se fait recueillir par un navire à la cargaison fort suspecte. Pourquoi amener des chiens et un puma sur une ile isolée ? Et cet étrange serviteur, à l'air à peine humain, suscite quelques questions désagréables. Contre sa volonté, Pendrick se retrouve sur l'ile, en compagnie du docteur Moreau et de son assistant Montgomery. La faune locale est assez surprenante, les humanoïdes ayant tous un coté assez... animal. Bref, on connait la suite, ce sont en fait les résultats des expériences de Moreau, tentatives de créer des humains à partir de divers animaux. Le point faible du roman, c'est son second quart, une longue course poursuite dans les bois qui n'est due qu'à un manque de communication entre les personnages, Pendrick étant persuadé qu'un sort funeste l'attend entre les mains du docteur, alors que celui-ci n'est pas si méchant. Mais ensuite, L'île du docteur Moreau se révèle encore très efficace. Il y a l'inévitable discours du docteur, défendant la science pour la science, la poursuite du savoir à n'importe quel prix. Est particulièrement troublante sa tentative de justifier toute la souffrance infligée à ses victimes. Puis, bien sur, les choses tournent mal. Wells parvient à donner à ses créatures, entre humanité et animalité, un coté dérangeant et inquiétant. L'animalité reprend lentement le dessus, et l'homme, pour s'adapter, doit lui-même modifier son comportement et devenir plus animal, plus sauvage. Autre outil à sa disposition pour assurer sa domination : la religion. Un ensemble de lois communes qui se maintiennent grâce à la crainte et la vénération d'un être supérieur. Vraiment, il n'y a que de naïfs animaux pour se laisser prendre à ce genre de piège !
212 pages, 1896, folio
samedi 22 octobre 2016
Les premiers hommes dans la Lune - H.G. Wells
Ah, le bon vieux temps, l'époque dorée dans laquelle il suffisait d'avoir un pote scientifique pour aller se balader dans l'espace en pantoufles, littéralement. Pas la peine d'en parler à qui que ce soit, ni de se poser trop de questions, fonçons à l'aventure, tout simplement ! Bedford, le narrateur, est un magouilleur dans une mauvaise passe. Espérant se refaire, il s'installe dans un coin paumé de l'Angleterre pour écrire une pièce de théâtre. Mais voilà qu'il fait la rencontre de Cavor, joli cliché du scientifique génial mais mais sans aucun sens pratique. Cavor est sur le point de faire une découverte fort importante : la cavorite. Un métal possédant l’étonnante propriété de faire écran à la gravité. Voilà qui ouvre bien des possibilités. Après quelques déboires, nos deux héros décident de s'embarquer sur la Lune, pour
Sur la Lune, il n'y a, comme on peut s'y attendre, pas grand chose. Pas beaucoup de gravité non plus, ce qui donne à nos héros les mêmes capacités que John Carter. Mais voilà que le jour se lève, le soleil montre le bout de ses rayons, et fait fondre l'air gelé pendant la nuit, créant ainsi une atmosphère temporaire. Atmosphère bien entendu respirable, ce ne serait pas pratique sinon. Et soudain, des plantes percent le sol lunaire, et grandissent, grandissent à une vitesse folle. Nos deux explorateurs, pas très futés, vont se balader et perdent de vue leur vaisseau. Il va de soi que la Lune est habitée par des êtres intelligents, vivant sous terre, parce que la Lune est creuse, et possède un vaste océan souterrain. Bref, nos héros se font capturer par des aliens plutôt pacifiques, doivent s’échapper suite à un malentendu, Bedford parvenant à rentrer maladroitement sur Terre, alors que Cavor reste coincé sur place. La dernière partie du roman laisse la parole à Cavor,qui envoit des messages radio depuis la Lune, et c'est là qu'on en apprend le plus sur cette civilisation.
Wells a le don de mêler aventure rocambolesque et idées intéressantes. On s'amuse bien à suivre les péripéties d'un duo de bras cassés, certes, mais l’intérêt véritable est ailleurs. La cavorite est une substance qui laisse supposer des applications aussi folles que la flohrisation dans l'Homme élastique, mais Wells choisit de laisser le secret de sa fabrication se perdre, sous-entendant clairement que l'humanité ne ferait pas que du bien avec ce savoir. La civilisation lunaire est une utopie inquiétante et ambiguë. Chez les lunaires, pas de guerre. Le monde est uni, et chacun, dès son plus jeune age, est formé pour une tache précise. Formé aussi bien mentalement que physiquement. Chaque lunaire a un corps adapté à son métier : grosse tête pour les intellectuels, habilité des doigts pour les peintres, gros muscles pour les gardiens de l'ordre... Et tous trouvent dans leur tâche leur unique bonheur. Ainsi, quand ils n'ont pas d'ouvrage, ils prennent un narcotique pour dormir jusqu’à ce que la société ait à nouveau besoin de leurs services. Et selon Cavor, « droguer l’ouvrier dont on a pas besoin et le mettre en réserve vaut sûrement beaucoup mieux que de le chasser de son atelier pour qu'il aille mourir de faim dans les rues.» Moui. Tiens, notons au passage, pour un petit rire facile, que certaines femelles, « en certains cas, possèdent un cerveau de dimension presque masculine. » Ah, le charme de la littérature d'un autre temps. Donc, pour résumer, l’être lunaire est heureux et vit en paix parce qu'il est une machine. Mais... une machine, vraiment ? C'est là tout l’intérêt de ce genre de fiction : selon nos critères, une telle organisation parait horrible. Disparition totale non seulement de la liberté, mais aussi, plus important, de l'idée de liberté. Pas d'illusions de free will, non, pur déterminisme totalement assumé, recherché. Et plus le roman avance, plus progresse la communication entre les espèces, et plus l’intérêt augmente. Dans le dialogue final entre le chef de la Lune, son plus gros cerveau, et Carvor, ce dernier commet une grossière erreur : expliquer en détail aux aliens perplexes ce qu'est la guerre. Ils n'ont pas l'air d’être convaincus de l’intérêt de la chose.
Ma foi, Les premiers hommes dans la Lune est un bon p'tit roman dont l’intérêt va croissant. Un premier contact plein d'idées et d'humour. On n'est pas sans sourire quand Wells, dans un clin d’œil à l'Utopie de Thomas More, fait s’émerveiller ses personnages devant leurs menottes et chaines lunaires, fabriquées en or. Quand Bedford revient sur Terre avec ces précieux trophées, l'or pèse bien plus lourd, au sens propre comme au figuré.
1901
lundi 2 mai 2016
The New Machiavelli - H.G. Wells
Un roman de Wells au ton réaliste qui serait, à priori, partiellement autobiographique. Mais ce n'est pas un point capital, il vaut mieux le prendre comme une fiction nous plongeant dans l’Angleterre du début du vingtième siècle. Heureusement, The New Machiavelli a plus qu'un simple intérêt historique.
Je crois qu'une partie non négligeable du plaisir que m'a procuré ce livre vient d'une identification avec son personnage principal et narrateur, Remington. Ou du moins une certaine empathie. Remington nait dans une famille moyenne, fils unique, il perd son père vers dix ans. Mis à l’abri du besoin par un oncle riche, il a un goût inné pour l'abstraction. Au grand regret de son oncle, il désire aller à l’université au lieu de travailler. Ce qui le branche, c'est de théoriser l'organisation sociale, de rêver d'un futur meilleur. Il ambitionne de se faire une place dans le monde de l'écriture et de la politique. Et il y parviendra. Il faut bien avouer que les passages du roman qui sont principalement consacrés à la politique ne sont pas les plus passionnants. Tout cela semble un peu loin, et ce n'est pas toujours très clair pour le lecteur d'aujourd'hui, surtout pour le lecteur non anglais. Mais on peut toujours suivre et comprendre les grandes oppositions entre les hommes d'idées et la majorité pragmatique, avec entre les deux le politique moyen qui n'a guère d'autre ambition que le maintien du statu quo.
Mais tout devient plus captivant quand se mêlent à cette abstraction l'amour et le désir. En même temps que son apprentissage de la vie politique, Remington fait l'apprentissage de la vie amoureuse. Et le crépuscule de l'ère victorienne n'est pas des plus favorables à une nature sensuelle. Réprimant ses désirs, Remington va se marier à une femme dans le seul but de tenter d'éliminer ses désirs et de se concentrer sur sa mission politique. Margaret est une alliée et non pas une amante, c'est un mariage d'idée et non de désir. On devine que les choses ne peuvent qu'aller droit dans le mur. Ainsi quand les idées de Remington évoluent et que celles de Margaret restent les mêmes, ils n'ont plus entre eux une mission commune pour les unir. La jeune Isabel, par contre, a le mérite non seulement d'avoir avec Remington le lien idéologique, les structures de pensées communes qui semblent capitales pour ces êtres tournés vers l'abstraction, mais surtout, elle éveille le désir et l'amour. Entre eux nait la passion. Passion non compatible avec l'étouffante morale victorienne. Alors, renoncer à l'amour véritable pour se consacrer froidement au bien public ou embrasser la chaleur de la vie et dire merde aux grands idéaux, de toutes façons probablement irréalisables ?
C'est là que The New Machiavelli réussit particulièrement bien : décrire ce combat entre le désir et la raison. Mais le fait est que ce combat ne peut exister que dans une société défaillante. Quel gâchis que de condamner les meilleurs au mépris public parce qu'ils ont eu le courage d'essayer de se connaitre et d'agir en accord avec cette connaissance. Du moins, c'est l'idée que veut faire passer Wells, sans doute pour justifier sa propre vie amoureuse assez aventureuse. Il le fait avec adresse et a le bon goût de laisser la place au doute. Il est intéressant de noter que les idées de Remington sont en lien avec une certaine fascination pour, disons, l'ordre. Rêve d'organisation parfaite, d'optimisation totale, de réalisation de tous les potentiels. Idéal que l'on peut imaginer facilement dériver vers des terrains plus sombres. Je remarque parfois le même genre de faille dans mes divagations intérieures.
The world I hate is the rule-of-thumb world, the thing I and my kind of people exist for primarily is battle with that, to annoy it, disarrange it, reconstruct it. We question everything, disturb anything that cannot give a clear justification to our questionning, because we believe inherently that our sense of disorder implies the possibility of a better order. Of course we are detestable.
396 pages, 1911, Penguin Book
mardi 5 mars 2013
Un rêve d'Armageddon - H.G. Wells
J'ai découvert H.G. Wells avec le chef d’œuvre qu'est La machine à explorer le temps. Une véritable pépite. J'ai ensuite lu La guerre des mondes et L'ile du docteur Moreau, qui ont un peu plus subis le passage du temps mais restent très bons. Le petit livre ici présent contient quand à lui deux nouvelles partageant une même ambiance onirique.
Dans La porte dans le mur, un ministre évoque un problème qui le tourmente depuis son enfance. Il se souvient avoir par hasard découvert une porte menant à un monde fantastique et merveilleux. Malheureusement, après y avoir gouté bien des plaisirs, la réalité l'a rattrapée. Puis, pendant le restant de sa vie, il lui est arrivé à plusieurs reprises de croiser à nouveau cette fameuse porte, qui semble n'apparaitre qu'aléatoirement (si elle existe vraiment). Cependant, poussé à chaque fois par les mornes nécessités de sa vie d'homme fort occupé, il est à chaque fois passé à coté sans l'ouvrir. Cette vision d'un homme hanté par un monde idyllique découvert pendant son enfance n'est pas sans me rappeler le cas de Randolph Carter dans La clé d'argent de Lovecraft. Quoi qu'il en soit, on a ici un récit onirique assez sombre, remettant en question l'importance des honneurs et des satisfactions qui font le le charme de la vie réelle.
Un rêve d'Armageddon, c'est le récit que fait un homme à un autre de ses rêves. Ces rêves, à vrai dire, n'en sont pas vraiment : ils ont une telle force, un tel impact, qu'ils prennent souvent plus de place que la vie éveillée du rêveur. Dans ces rêves, situés quelques centaines années dans le futur, le rêveur est un homme de pouvoir, l'un des leaders d'une vaste nation totalitaire. Cependant, il a renoncé à sa position pour une vie de plaisir en compagnie de la femme qu'il aime. Bien sur, cela ne peut être aussi simple. Il était le seul à pouvoir réfréner les ardeurs du dirigeant de son pays, et maintenant qu'il n'est plus là, ce dictateur se sent venir des envies de guerre. Il pourrait encore faire marche arrière, renoncer à son amour pour aller régler la situation : il est le seul homme à pouvoir empêcher la guerre. Mais il choisit de rester avec la femme qu'il aime. Et la guerre éclate. Si le précédent récit ne se distinguait pas par son optimiste, celui-ci est terriblement pessimiste. Il dépeint un monde où l'homme doit choisir entre le bonheur véritable et ses énormes responsabilités. Mais ici, aucun choix n'est le bon. La guerre semble être un mal inévitable, inhérent à la civilisation, qui d’ailleurs est toujours dirigée par quelques hommes ivres de puissance tenant entre leurs mains la vie de centaines de millions d'autres.
Ces deux nouvelles partagent plusieurs points communs : à chaque fois, un homme puissant est confronté à un rêve inaccessible, qui finalement sera sa perte. Deux bons textes oniriques et pessimistes, servis par le style simple et fluide de Wells.
109 pages, Folio
Un autre avis sur Naufragés Volontaires
Libellés :
Fantastique,
Littérature,
Science fiction,
Wells H.G.
Inscription à :
Articles (Atom)