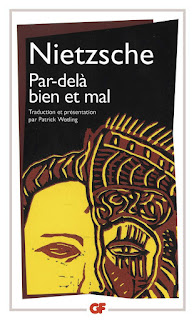Après La généalogie de la morale (1887), l’année 1888, la dernière de la vie consciente de Nietzsche, est riche en écrits. Le cas Wagner, une diatribe contre l’ancien ami de Nietzsche, est sans doute trop imprégné de l’époque, et de la figure de Wagner, pour être d’un grand intérêt au lecteur non spécialiste. En somme, Nietzsche l’accuse de développer une musique « sédentaire », qui abaisse plus qu’elle n’élève. Le Crépuscule des Idoles, au contraire, se veut un texte à la fois large et condensé : une sorte de résumé mis à jour de la pensée de Nietzsche pour préparer le terrain à sa grande œuvre, qui ne verra jamais le jour. Je tire quelques passages de la préface qui parvient à être relativement éclairante (ce n’est pas donné à toutes les préfaces) : « L’activité philosophique, illégitimement comprise jusqu’alors comme une élucidation de la réalité en termes de connaissance, est donc bien une pratique appliquée à modifier les conditions mêmes de la vie humaines (…). » Et l’idole du titre suggère « une modalité affective – l’idée d’attachement et de respect, mieux encore de vénération – plutôt que le contenu d’un attachement. »
La foi comme volonté extérieure imaginaire : « Qui ne sait mettre sa volonté dans les choses y insère à tout le moins un sens : à savoir, il croit qu’elles contiennent déjà une volonté (principe de la "foi"). »
Un aphorisme qui m’a fait rire, en plus d’incarner l’exigence de mobilité mentale de Nietzsche : « On ne peut penser et écrire qu’assit (G. Flaubert). – Ton compte est bon, nihiliste ! Rester vissé à sa chaise, voilà justement le péché contre le saint esprit. Seules ont de la valeur les pensées venues en marchant. »
Dans le chapitre qui suit les petits aphorismes introductifs, Nietzsche reproche à Socrate son manque d’amour de la vie : en somme, c’est que Nietzsche appelle le nihilisme : le rejet de l’instinct de vie au profit d’autres instincts plus artificiels. Ceci dit, il reconnaît le caractère élusif de la valeur de la vie : « On doit absolument étendre la main pour faire la tentative de saisir cette finesse étonnante que la valeur de la vie ne peut être appréciée. Pas par un vivant, parce qu’il est partie, et même objet du litige et non pas juge ; pas par un mort, pour une autre raison. » Ainsi, pour comprendre la valeur de la vie, il faudrait être hors de la vie, ce qui est impossible. Nietzsche s’attaque bien sûr à l’idée d’un monde « apparent » opposé à un monde « caché » qui serait le véritable, mais il défend les mondes crées par les artistes : « Que l’artiste place l’apparence plus haut que la réalité n’est pas une objection contre cette proposition. Car "l’apparence" signifie ici la réalité encore une fois, simplement sous une forme choisie, renforcée, corrigée... »
Le chapitre sur les « quatre grandes erreurs » commence sur une idée capitale : la confusion entre la cause et la conséquence. Nietzsche prend un exemple concret et convainquant : un auteur célèbre qui recommande, pour la santé, un régime extrêmement frugal. Mais, selon Nietzsche, ce n’est pas son régime donne à cet homme sa santé, au contraire : c’est sa constitution particulière, son métabolisme lent, qui exige un régime frugal. « Il ne lui appartenait pas en toute liberté de manger peu ou bien beaucoup, sa frugalité n’était pas une "volonté libre" : il tombait malade lorsqu’il mangeait davantage. » Et toujours sur cette éternelle méprise envers les causes : « Le "monde intérieur" est pavé de mirages et de feux follets : la volonté en est un. La volonté ne met plus rien en mouvement, par conséquent elle n’explique plus rien non plus – elle se contente d’accompagner des processus, elle peut aussi être absente. »
Ici, Nietzsche se heurte à Darwin en une sentence qui me semble expliciter de façon assez claire ce qu’il entend par « volonté de puissance » : « S’agissant de la célèbre lutte pour la vie, elle me semble pour l’instant plus affirmée que démontrée. Elle se produit, mais comme exception ; l’aspect d’ensemble de la vie n’est pas la détresse, la disette, mais bien plutôt la richesse, l’opulence, même l’absurde prodigalité – là où on lutte, on lutte pour la puissance... »
Ensuite, voyons un peu la valeur de l’égoïsme selon Nietzsche. Encore une fois, face à certaine de ces sentences, j’ai eu la certitude qu’Ayn Rand s’y était nourrie, en lui enlevant ce genre d’ambiguïté Nietzschéenne : « L’égoïsme vaut autant que celui qui physiologiquement le possède : il peut valoir énormément, il peut être abject et méprisable. » Plus loin : « Se plaindre n’est jamais bon à rien : cela provient de la faiblesse. Que l’on impute son état de faiblesse à autrui ou à soi-même – la première attitude est celle du socialisme, la seconde par exemple celle du chrétien – ne fait pas véritablement de différence. Ce qu’il y a de commun à ces attitudes, et ajoutons d’indigne, c’est que ce doive être la faute de quelqu’un si l’on souffre – bref, que le souffrant se prescrive contre sa souffrance le miel de la vengeance. » Et dans l’aphorisme suivant : « Ce qu’il y a de meilleur vient à manquer quand vient à manquer l’égoïsme. Choisir d’instinct ce qui vous nuit, être séduit par des motifs "désintéressés", cela fournit presque la formule de la décadence : "Ne pas chercher son avantage" – c’est en tout et pour tout la feuille de vigne morale substituée à état de fait tout autre, à savoir physiologique : "je ne sais plus trouver mon avantage"... Désagrégation des instincts ! »
Si Nietzsche peut avoir l’air, disons, réactionnaire, parce qu’il est à peu près anti-tout et qu’il se dresse contre l’essentiel de la modernité, ses analyses politiques peuvent se faire diablement pertinentes. Sur le progrès : « … nous nous imaginons en fait que cette humanité douillette que nous représentons, que cette unanimité que nous avons atteinte dans le ménagement, dans la serviabilité, dans la confiance mutuelle, est un progrès positif, que nous avons de ce fait largement dépassé les hommes de la Renaissance. Mais c’est ce que pense toute époque, ce qu’elle doit nécessairement penser. » Étrangement, Nietzsche, quand il critique « l’hyperexcitabilité qui est propre à tout ce qui est décadent », me semble défendre une sorte de stoïcisme : la force dans un détachement, un délai réflectif entre stimulation et réflexion. Sur les institutions libérales, qui selon Nietzsche nivellent la montagne et la vallée, peut-être l’un des passages les plus frappants de cet essai : « Tant que l’on continue à se battre pour elles, ces mêmes institutions produisent de tout autres effets ; alors, elles sont de fait de puissants promoteurs de la liberté. À y regarder de plus près, c’est la guerre qui produit ces effets, la guerre pour des institutions libérales, qui, en tant que guerre, fait perdurer les instincts alibéraux. » Plus loin dans le même aphorisme : « Les peuples qui avaient de la valeur, acquirent de la valeur, ne l’acquirent jamais à la faveur d’institutions libérales : c’est le pire danger qui en fit quelque chose qui mérite le respect, le danger qui seul nous fait connaître nos ressources, nos vertus, nos défenses et nos armes, notre esprit – qui nous contraint à être fort... »
Et pour finir, une dernière critique de la modernité, qui ne manque pas de piquant : « Nos institutions ne valent plus rien : on en convient unanimement. Seulement, cela ne tient pas à elles, mais au contraire à nous. Après que nous avons perdu tous les instincts dont sortent les institutions, nous perdons les institutions tout court parce que nous ne les valons plus. »