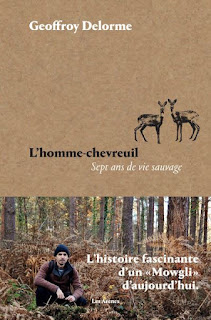Après un excellent premier tome : la ferme du Bec-Hellouin, second tome, le plus massif. Toujours un peu trop d'illustrations pleine page, et les 50 pages de tableaux sur les légumes ne sont pas un modèle d’ergonomie ni d'économie de papier, mais, le plus important, toujours un contenu riche, dense et passionnant.
On commence avec la butte de culture permanente, qui a pour avantage d'augmenter la profondeur du sol. Sa permanence fait qu'elle n'est jamais piétinée ou tassée, et que l'ajout de compost et de mulch contribue année après année à créer une terre qui gagne en fertilité. De plus, en densifiant les cultures sur ces buttes, on peut réaliser ses amendements de façon plus dense. Les buttes étant surélevées, leur réchauffement est favorisé au printemps et le ressuyage du sol est favorisé (la perte de l’excédent d'eau au printemps). Les auteurs avancent que les potagers plus traditionnels, où les rangs de cultures sont séparées par des allées, ne sont la plupart du temps pas justifiés : tout cet espace serait nécessaire avant tout aux bêtes de trais et aux machines, pas aux plantes. En resserrant les cultures, on augmente l’efficacité globale et on réduit les besoin de désherbage, qui peuvent se faire à la main. L'idée est que les feuilles des légumes se touchent quand ils atteignent les 3/4 de leur développement, afin de former une "canopée". De plus, dans le cas des buttes rondes, la courbe offre un espace de culture supérieur à un simple sol plat. Notons que les pommes de terre, qui nécessitent de "détruire" la butte à la récolte, et les courges, qui prennent beaucoup de place, ne sont pas forcément adaptées aux buttes. Sur les buttes rondes, il n'est pas question d'utiliser des semoirs mécanique et l'usage de voiles de forçage est limité (ce qui n'est guère un problème pour l'amateur). Dans les climats très chauds, la butte n'est pas une bonne idée car elle favorise l'évaporation, et mieux vaudrait cultiver au contraire en creux. Mais on n'en est pas encore là en France.
La morale générale est de faire aussi petit et aussi soigné que possible. Il ne faut pas créer une plus grande surface que celle que l'on est capable d'entretenir et de désherber, ne jamais semer dans un sol qui n'est pas impeccable (décompacté, fertilisé, sans adventices). Le désherbage régulier, quand les adventices sont encore très jeunes, est capital.
La butte permanente n'est pas une invention : son usage est répandu depuis des millénaires. Mais, bien sûr, elle n'est pas compatible avec la mécanisation. Les buttes rondes ne doivent pas être trop hautes, pour éviter le ruissellement de l'eau et des graines. Idéalement, les allées sont paillées pour limiter les adventices, ce qui peut nécessiter l'apport, 3 fois par an, d'une grande quantité de biomasse. Et en échange les allées peuvent produire plusieurs centimètres de compost par an. Lors de la création de la butte, ne pas oublier de bien décompacter le sol. Les buttes elles aussi sont quasiment toujours muchées, sauf peut-être quelques semaines au printemps, voire un ou deux mois, pour réchauffer la terre et réaliser des faux semis. Avant nouveau paillage et pendant ces semaines d'exposition, plusieurs sarclages superficiels pour tuer les adventices et casser la croute de battance. Les planches plates sont utilisées notamment pour les semis directs, avec semoir pro, et ce sont elles qui dominent sous la serre. Notons que les auteurs déconseillent l'apport de bois dans les buttes. D'après leur expérience, les bûches remontent avec le temps et les pointes de la grelinette se plantent dedans. Dans la nature, le bois se décompose en surface et les organismes qui causent cette décomposition vivent en aérobie. Dans les pays d'Afrique, cette technique fonctionne grâce aux termites.
Les apports de paillage et de compost n'apportent pas immédiatement des nutriments : les nutriments sont libérés progressivement par les organismes du sol et seront utiles sur le moyen terme. L'idée est de maintenir la présence de tous les stades de décomposition pour une assurer une fertilité dans l'immédiat comme sur la durée. Les auteurs n'utilisent pas d'engrais classique. Comme n'y a pas encore d'étude scientifique approfondie sur les apports de fertilité par la biomasse, le dosage se fait encore à l'instinct et à l'expérience.
Afin de relativiser l'idée d'autofertilité, je note la composition du substrat à semi de la ferme : 40% de substrat bio du commerce, 40% de compost maison tamisé et mûr, et 20% de sable de rivière. Je ne crois que le sable de rivière soit une ressource renouvelable.
Au Bec-Hellouin, les arrosages sont très modérés : après les semis et repiquages, en quantité stable mais modérée pour stimuler la croissance profonde des racines, et en période de sécheresse. Il leur arriverait, certaines années, de ne pas arroser hors semis et jeunes plans, sans doute grâce à la combinaison mulch et richesse organique du sol. Leurs planches plates sont équipées de tuyaux d'arrosages au goutte à goutte. Les bons outils pour le travail pro à la main ne sont pas monnaie courante, et ils prennent le temps de conseiller sur ces questions. Je ne noterai ici que la nécessité, pour les récoltes notamment, d'un bon sécateur à lames longues, souvent mentionné.
Le gros morceau suivant est l'association des cultures. Comme pour la forêt-jardin, l'idée est d'optimiser en associant des végétaux complémentaires, pour des raisons très pratiques. Notons que les plantations se font en quinconce, et que s'il s'agit bien de densifier, quitte à ce que certains légumes soient plus petits que la norme, il y a évidemment un juste milieu à trouver. Il s'agit aussi de remettre en question l'idée que les légumes auraient toujours besoin du plein soleil, et, plus compliqué, de prendre en compte les différences parfois considérables entre les nombreuses variétés d'une même plante. Les associations sont un facteur important dans l'efficacité au mètre carré de la ferme du Bec-Hellouin (mais pour les amateurs, ne pas oublier l'avantage considérable que représente leur grande serre).
Quelques avantages de cette pratique des associations :
- Feuillages variés et donc optimisation de la captation des rayons du soleil
- Plus de protection du sol contre le soleil, qui stérilise les premiers centimètres du sol
- Optimisation de l'espace : un légume qui pousse en hauteur accompagne d'autres qui couvrent le sol
- De même pour les systèmes racinaires : un système profond et un système superficiel ne sont guère en concurrence pour l'eau et les nutriments
- La densité favorise un microclimat moins venteux et plus humide, où les écarts de températures sont moins élevés
- Les différents végétaux créent des barrières physique et chimiques pour les ravageurs
- Les fixateurs d'azote peuvent être utiles aux autres plantes
- L’augmentation de la biomasse produite par mètre carré donne de quoi faire plus de much
- Plus de masse racinaire signifie plus de fertilité après décomposition
- La richesse des micro-organismes est favorisée
- La variété augmente la résilience
- Bien menées, les associations offrent un plus fort rendement par unité de surface
- Et c'est plus agréables pour les humains
Notons aussi les inconvénients : essentiellement une complexification du système qui laisse la place à plus d'erreurs possibles (compétition, manque d'espace..). Les auteurs ne manquent pas de préciser que certaines tentatives ont été des catastrophes. Des tableaux offrent un classement des plantes par famille, taille des systèmes foliaires et racinaires, et durée du cycle de culture. Une bonne idée est aussi de définir dans chaque association une culture prioritaire, au profit de laquelle les autres peuvent être récoltées en avance si besoin. Le repiquage facilite les choses, en donnant de l'avance à un légume particulier, et il s'agit aussi de semer de façon décalée. De nombreux exemples d'association viennent ensuite illustrer ces principes, mais gardons en tête que si ce n'est pas une science exacte, loin de là, il s'agit pourtant de ne pas faire les choses à la légère et de bien songer à tous les facteurs. Un exemple simple : ail et mâche. C'est comme une simple culture d'ail, sauf qu'on plante de la mâche entre les pieds d'ail. La mâche est récoltée à la moitié du cycle de l'ail, ce qui libère l'espace pour la croissance de l'ail.
Je prends le temps de commenter l'association peut-être la plus connue : la milpa (courge-maïs-haricot). Plutôt que de semer les 3 ensemble en terre, comme j'ai eu l'occasion de le faire, voici le procédé pratiqué par les auteurs : repiquage de plants de maïs, un mois plus tard désherbage et semi des haricots (alors que les maïs font déjà 40 cm), et deux semaines plus tard repiquage des courges, qui vont couvrir le sol. Encore deux semaines plus tard, désherbage et paillage, et le tout en aidant les haricots à grimper sur le maïs avec l'aide de piquets de palissage. Par la suite, la biomasse est utilisée en paillage. On voit donc comment un système complexe doit être géré bien plus finement qu'en semant simplement 3 graines ensemble. Je note aussi le compagnonnage facile de la courgette et du maïs : comme une simple plantation de courgette, mais avec du maïs en bonus.
Sur la culture en toutes saisons : il s'agit de planter assez tôt ses légumes d'hiver pour réaliser l'essentiel de leur croissance quand il y a encore assez de soleil. Par ailleurs, les légumes supportent mieux le gel à l'état de jeune pousse qu'adulte. Et, encore fois, choisir les variétés pertinentes à la saison et la localisation de culture. Si les serres non chauffées n'offrent qu'une protection marginale face au gel (en fin de nuit la température n'est supérieure que de 1 ou 2 degrés à la température extérieure), ce qui compte pour la croissance des végétaux, c'est la température moyenne, qui elle est bien plus élevée. Les serres facilitent aussi le palissage, qui peut multiplier les rendements par 3 pour les tomates et les concombres. Les végétaux souffrent plus du dégel que du gel, il faut donc éviter les montées de température rapide après un gel. Donc, ventiler la serre tôt dans ce cas. Les eaux de pluie récupérées du toit de la serre peuvent y servir de batterie thermique. D'ailleurs, les auteurs ont même installé des petites marre dans leur serre. La présence du poulailler dans la serre contribue sensiblement à la réchauffer. Par exemple, les vignes de la serre qui poussent près du poulailler sont plus précoce d'une dizaine de jour que celles plus éloignées.
Les couches chaudes, faites avec une quarantaine de centimètres de fumier, réchauffent les jeunes plants posés dessus et toute la serre avec. Cette technique est aussi un héritage des maraichers parisiens, elle a été abandonnée avec le déclin de la traction animale et la raréfaction du fumier, puis par l'abondance d'énergie fossile à bas coût. Les couches chaudes peuvent aussi fonctionner dehors, surtout avec un voile de forçage. Attention : l'abondance de jus de fumier peut tuer les arbres à proximité. La couche chaude n'offre pas que de la chaleur, mais aussi, selon son niveau de décomposition par la suite, du paillis et un riche compost.
Les pommes et poires sont les légumes les plus évidents à conserver sans transformation, et quand on on cultive à la fois variétés précoces et tardives, il est possible de longuement étaler la récolte. La sélection variétale est une fois de plus capitale. Je note aussi la présence d'un petit chapitre sur un sujet particulièrement intéressant pour l'amateur : les légumes vivaces. Concernant les aromatiques (sauge, menthe...), je note quelles sont tout à fait utilisables et même bénéfiques en mulch, ce que j'aurais pas eu le réflexe de faire.
Ensuite, on arrive au dernier gros morceau : les forêts-jardin et leurs variantes. C'est l'un des axes majeurs de leur recherche, mais, évidemment, ça prend du temps pour obtenir des données. Concernant l'agroforesterie, rappelons que par exemple une production de blé + noyer offre 36% de gain de productivité par rapport à une production en parcelles séparées. Pour les fruitiers, une attention encore plus aiguisée est à donner aux variétés à cause de la complication des greffes. Les fruitiers basse-tige ne sont pas à privilégier dans une perspective long-terme (ils s'épuisent plus vite), et les haute-tige permettent plus aisément d'intégrer des animaux. Les auteurs soulignent aussi l'importance du paillage au pied des fruitiers, surtout quand ils sont jeunes, pour augmenter les chances de reprise, limiter les arrosages et globalement augmenter la vitesse de croissance d'un facteur de 1,5. Ne pas oublier non plus que pour maintenir une productivité optimale, un fruitier, ça se taille.
Il y a aussi un chapitre sur les haies, détruites pour la plupart au cours des dernières décennies, et je ne vais pas lister ici leurs très nombreux avantages. D'ailleurs les haies peuvent aussi servir de fourrage animal, ou être des haies fruitières. L’agroforesterie est une vielle tradition européenne (oliveraies, châtaignerais...).
- Les prés-vergers sont la combinaison d'arbres et d’animaux, qui bénéficient de l’abri des arbres et pour lesquels les fruits tombés constituent une source supplémentaire de nourriture. Les animaux détruisent ainsi les parasites au passage. Pour l'arbre, la concurrence de l'herbe est réduite et les excréments fertilisent. Cependant, il vaut mieux protéger les arbres des gros animaux.
- Les vergers maraîchers combinent arbres et légumes, et permettent ainsi une optimisation de l'énergie solaire. C'est particulièrement valables pour les légumes qui tolèrent l'ombre.
Les forêts-jardin sont quand à elles divisées en deux versions :
- La forêt-jardin intensive a une forte productivité mais demande beaucoup d'entretien. C'est la forêt-jardin "idéale" de Martin Crawford, avec différentes strates, de nombreux arbustes et couvre-sols. Les études réalisées au Bec-Hellouin pointent vers une viabilité économique de ce système, viabilité essentiellement portée par les baies et les plantes couvre-sols. Les baies sont souvent greffées sur de petits troncs pour faciliter les récoltes et libérer l'espace au sol. Une bâche biodégradable est utilisée pour maitriser les plantes au sol. Les allées sont paillées et décaissées. Les auteurs voient dans ce système, encore balbutiant en occident, une piste d'avenir.
- La forêt comestible produit moins mais nécessite peu d'entretien. Elle est probablement à plus grande échelle, la strate herbacée est donc, à moins de beaucoup de main d’œuvre, incontrôlable, et si les plantes naturelles (orties, fougères...) peuvent néanmoins service de mulch, des animaux peuvent être utilisés pour garder le contrôle. On peut aussi semer des légumes à basse maintenance, comme des courges, ou introduire des pérennes.