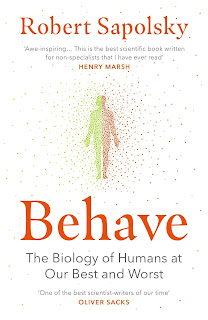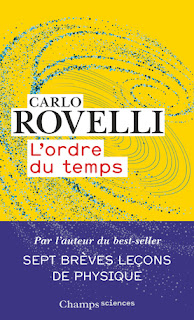Malgré ses imposantes 700 pages, Behave (2017) ne cherche pas vraiment à défendre une thèse. Son propos central, c'est que les choses sont compliquées, que les sciences ne sont pas miraculeuses, qu'il faut prendre du recul et manier le doute. Du coup, ce pavé a une structure un peu étrange, qui manque, si j'ose dire, de feu narratif. Le premier tiers est ardu : neurologie, endocrinologie, et autres sciences bien dures. Puis on passe à une approche évolutionnaire, qui me parle beaucoup plus. Et enfin, dans le troisième tiers, Robert Sapolsky se penche sur les société : hiérarchie, violence, moralité... J'ai trouvé ces passages beaucoup plus faibles, ayant l'impression des les avoir déjà lu ailleurs, en plus dense (La Conquête sociale de la Terre, Wired for Culture, Le Troisième chimpanzé, Thinking, Fast & Slow...). Et Sapolsky conclut longuement sur de l' « espoir » et de l' « optimisme » pour l'espèce humaine. Un peu hors de propos, voire banal. Ceci dit, Behave, en plus de très bien se lire, est sacrément dense. J'en extrais quelques points.
Idée centrale : toutes les disciplines s’entrecroisent. Un comportement est causé à la fois par des substances chimiques dans le cerveau, des secrétions d'hormones, des stimuli environnementaux, un certain code génétique, tout le processus évolutionnaire...
Vision schématique, mais très pratique, du cerveau :
- Couche 1. Partie ancienne, fonctions automatiques.
- Couche 2. Apparait surtout chez les mammifères, gère les émotions, qui envoient des commandes vers la couche 1.
- Couche 3. Le néocortex. Particulièrement important chez les primates : mémoire et abstraction. Mais n'est pas vraiment séparé de la couche 2. Fonctionnent ensemble.
Le cerveau n'a pas vraiment fini de se construire avant l'âge d'environ 25 ans. (Ouf, le mien est terminé depuis deux ans !) D'ailleurs, le chapitre sur l'adolescence serait à faire lire à tous les adolescents. Les adolescents sont beaucoup plus sensibles à la dopamine que les enfants ou les adultes. Pour eux, les « récompenses plus importantes qu'espérées » produisent donc une stimulation très importante, mais une récompense plus faible qu'espérée produit, de façon unique, une stimulation négative. Pour eux, les hauts sont plus hauts, et les bas plus bas. Chez les ados, la perception de soi est, à un niveau cognitif, bien plus intimement liée à la perception que les autres ont de soi.
Neuroplasticité : génération et changement des circuits synaptiques. Épigénétique : modification des gènes, transmissible, au cours de la vie, sous des influences environnementales. Ceci dit, importance capitale de l'héritage génétique : exemples nombreux de jumeaux séparés à la naissance. Les traits communs vont jusqu'à des choses aussi précises que tirer la chasse d'eau avant d'utiliser les toilettes. Au-delà des anecdotes, l’influence de la génétique sur la personnalité est indéniable. (p235+) Mais ces influences peuvent prendre des routes tortueuses : par exemple, une haute confiance en soi peut-être partiellement causée non pas (ou pas que) par un éventuel gène de la confiance en soi, mais par les gènes qui déterminent une haute taille dans une société qui valorise les gens grands. Bien des gènes ne sont « activés » que par des stimuli environnementaux. Exemple : un éventuel gène qui prédispose à l’addiction au sucre... n'a un rôle néfaste que dans un cadre ou le sucre est aisément accessible.
Hypothèse pour expliquer l'individualisme américain : les colons susceptibles de migrer vers le Nouveau Monde devaient avoir des prédispositions à l'indépendance, l'optimisme, le goût du changement, l'insatisfaction, l'hyperactivité, l'avidité... Hypothèse pour expliquer le collectivisme asiatique : la culture du riz exige bien plus de travail de groupe que celle du blé, favorisant ainsi les gens au comportement collectiviste. Par exemple, on ne retrouve pas ce collectivisme dans les rares région de la Chine qui cultivent du blé. Et le fait est qu'il y a des différences génétiques corrélées avec ces comportements. (p.280+)
Quelques chiffres qui éclaircissent la sélection de parentèle : se reproduire une fois et mourir est l'équivalent évolutionnaire de mourir sans enfants mais en permettant à un frère ou une sœur d'en avoir deux, ou à un demi-frère/sœur d'en avoir quatre.
De la même manière que chez des rats pavloviens le signal qui précède la nourriture peut devenir source de plaisir à la place de la nourriture, un processus similaire arrive quand un être humain s'attache à un symbole : le signifiant fusionne avec le signifié.
Une grille de lecture efficace pour la façon dont on juge autrui :
- chaleureux + compétent : un ami estimé.
- chaleureux + non compétent : un proche qui sombre dans Alzheimer.
- non chaleureux + compétent : un rival économique.
- non chaleureux + non compétent : un punk à chien bourré.
Pour résumer le rapport à double sens entre biologie/contexte : certaines régions du cerveau se développent face à certains stimuli répétés / le développement inné de certaines régions du cerveau prédispose très fortement à certains traits de personnalité. Et pour conclure, une citation de Marvin Minsky : il définit le libre arbitre comme étant « les forces internes que je ne comprends pas ».