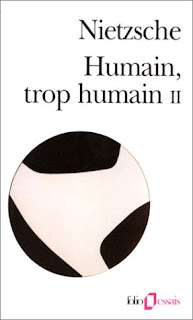|
| Monument de Kadinjaka. Voir journée du 15 aout. |
Contexte
Mon amie autrichienne Bernadette me propose d'aller faire de la rando au Kossovo. Mais je n'ai pas de passeport, et pas le temps d'en faire un, sans compter que je serais plus partant pour quelque chose de moins sportif. Elle a rendez-vous fin aout avec des amis à elle pour marcher dans les montagnes slovènes, et je lui propose de se balader un peu dans Balkans avant. Cette fois, je ne prends pas de billet de retour : j'ai un peu de temps, et je décide de me laisser le champ libre. On verra que, finalement, je rentrerai plus tôt que prévu. J'ai rendez-vous avec Bernadette à Split, simplement pour des raisons pratiques.
7 aout : Split
Split est ce à quoi je m'attendais : un monstre touristique que j'ai honte de contribuer à nourrir. Desservi par de gigantesques paquebots, aussi beau que soit le centre sous toute cette crasse, il n'est qu'un entassement de touristes et de façons de leur soutirer des kunas, la monnaie locale. J'étais partant pour ne rester ici qu'une nuit, mais Bernadette, cherchant (illusoirement) du repos, en voulait deux. Arrivé très tôt après une courte nuit, j'écris ceci en terrasse d'un café avec à côté de moi une rabatteuse en mini-robe moulante. Je suis envahi d'un dégoût triste, qui n'est pas arrangé par ma demi-nuit.
Alors que je lis, la confusion autour de moi se mue en un bruit de fond presque agréable. A ma droite, un jeune couple attablé. L'homme part aux toilettes. La femme, l'air absorbé, presque peiné, fixe le dos de la rabatteuse, ou alors regarde à travers elle. Son copain revient, elle sort de sa rêverie, et reprend son masque social.
Je vais retrouver Bernadette à la gare routière, et on va manger un falafel. On est assis devant l'un de ces innombrables stands qui vendent des trucs et des machins aux touristes. Celui-ci est spécialisé dans les objets en pierre blanche, et on voit avec étonnement des touristes acheter des crucifix et des horloges en forme d'arobase.
Direction l'auberge, difficile à trouver. Pas le moindre signe, pas l'ombre d'une indication. Finalement, ce sont deux filles qui y dorment qui nous ouvrent. Personne à la réception. La photo en gros plan d'une araignée, encadrée et posée sur une commode, nous étonne. On appelle plusieurs fois le numéro indiqué, sans succès. Finalement, on laisse nos sacs dans un casier et juste à ce moment une femme de ménage arrive. Elle est étrange. Une fille se plaint de s'être fait piquer par on ne sait quoi pendant la nuit, elle a plein de plaques rouges sur le corps. La femme de ménage décide de tous nous asperger de vinaigre, sans nous demander notre avis sur la question, en affirmant que tout va bien se passer, c'est un remède ancestral. Là, si j'étais seul, j'aurais certainement dit adieu à mon argent pour les lits réservés, et je serais allé ailleurs. Mais Bernadette est incertaine, et on décide de tenter notre chance ici pour une nuit.
Bernadette veut aller se baigner, alors direction une plage, à l'ouest. On passe longuement par les collines boisées, qui ne sont pas désagréables. Je laisse Bernadette barboter pendant que je lis à l'ombre.
Sur le retour, en voulant retirer de l'argent, Bernadette se fait manger sa carte par le distributeur. Apparemment, c'est une procédure normale si on ne retire pas sa carte en quelques secondes, ce qui me semble être une très, très mauvaise idée. On appelle plusieurs fois le numéro indiqué, sans succès. On passe à la banque, mais ils nous disent d'appeler le numéro. Bon, on retentera demain. On passe la soirée devant la mer. Fatigué, mon esprit s'égare, je disserte longuement sur l'intolérable position nihiliste d'une cousine qui pense que l'humanité mérite de mourir pour laisser place à la nature, comme si l'humanité
n'était pas la nature, alors que j'argumente qu'à long terme, l'intelligence est au contraire la seule chance pour le maintien et l'évolution de toute vie face à la destruction prévue de la Terre par le soleil ou autre chose, et plus globalement face à l'entropie générale de l'univers, puis pendant que Bernadette me parle, je me retrouve soudain, à peine consciemment, à faire des grimaces à un bébé.
Sommeil. Vers 3h30, je me réveille. Je constate qu'on est désormais trois dans le dortoir. Un peu plus tard, j'entends à travers mes boules quies grognements et gémissements. Je retire mon masque de nuit et, surprise : le type s'est levé et est en train de tituber comme un zombi dans le dortoir. Je me redresse. Il entrouvre la porte. Il se penche vers moi, et touche mes draps. Il titube encore. Et il retourne se coucher. Je ne sais pas s'il est ivre mort ou somnambule.
8 aout : Split
Quand je me réveille, je sens que cette journée ne sera pas très passionnante. Pas encore totalement récupéré de la nuit dernière, chaleur, et Split pas très engageante. Bernadette passe quelques coups de téléphone, et on obtient une adresse où aller chercher sa carte perdue en fin d'aprèm. En attendant, on se ballade, je lis sur un banc. Elle va se baigner, je lis à l'ombre pendant qu'un chien abruti multiplie les aboiements stridents contre les vagues. On repasse à l'auberge, où je fais une sieste, puis direction le siège de la banque pour la carte de Bernadette. Au retour, on passe à la gare routière prendre des billets pour Mostar, en Bosnie, puis on mange et lit sur un banc jusqu'à la tombée de la nuit. Je termine
The Cellist of Sarajevo.
9 aout : Split (Croatie) → Mostar (Bosnie)
Je me lève tôt et vais prendre un café à côté de l'auberge. Le café est tout petit, très différent de celui d'hier : pas de touristes, juste deux croates à côté de moi qui prennent leur alcool du matin. Une fois Bernadette réveillée, on se ballade un peu. Elle s'aventure sans moi dans la cathédrale bondée, et on s'approche de la statue de je ne sais plus quel religieux, héros local, vu comme un défenseur de la culture serbe. Du coup, logiquement, embrasser l'orteil de sa statue porte chance.
On abandonne Split sans regret. Mais le voyage en bus, censé commencer à 11h pour finir vers 15h, prendra le double du temps prévu : retard initial, passage de la frontière inhabituellement long, et problèmes mécaniques qui font que le bus s'arrête en pleine route et peine à redémarrer. On arrive à 19h.
Mostar porte encore clairement les cicatrices de la guerre. Certains bâtiments ne sont pas débarrassés de leurs impacts de balles, d'autres, abandonnés, portent encore les cicatrices infligées pas obus et roquettes. Le vieux centre, près du pont reconstruit en 2004, est très touristique. C'est même l'endroit le plus touristique de tout le pays, mais on reste très loin de Split. On se trouve un coin où manger, et je me laisse un peu prendre au piège des verres de vin des Balkans : 20cl pour 1€50.
 |
| Vue classique depuis le pont. |
10 aout : Mostar
Je me réveille vers 4h30 et ne me rendors pas. Dans l'accueil de l'auberge, des photos du gérant en tenue militaire avec un AK dans les mains, le sourire aux lèvres. A côté, un coran. Un peu plus loin, un petit poster de Tito.
Bernadette levée, on part pour la Sniper Tower, ou Old Bank. C'était une banque basée à Ljubjana qui, je crois, a fermé peu avant la guerre. Mais au cours du conflit elle a trouvé un nouveau rôle : un point de vue pour snipers croates (il me semble, les guerres de Yougoslavie sont complexes) visant les bosniaques musulmans de l'autre côté de la ville. Aujourd'hui, l'extérieur est recouvert de graffitis dont certains utilisent les impacts de balles. On trouve un point d'entrée et on pénètre à l'intérieur. Tout est dévasté, les fenêtres et portes murées. Il ne reste que le squelette en béton et les graffs qui le recouvrent. On prend le temps d'explorer et de s'imprégner de l'atmosphère. J'imagine que cet endroit joue un rôle important pour le rapport à la guerre des jeunes générations. Mais je suppose qu'à la longue, pour la plupart des gens, ce n'est plus qu'un morceau de paysage comme un autre. La force de l'habitude. On monte à l'étage. Les puits des ascenseurs ne sont plus que des trous béants donnant sur le vide. J'aimerais explorer les hauteurs, mais les escaliers ont perdu leur cage, ils ne sont plus encadrés que par le vide, et le vertige vient naturellement frapper. Bernadette ne le ressent pas, mais on laisse les étages en paix.

Après avoir croisé une statue de Bruce Lee dans un parc, on se dirige vers le monument des Partisans, terminé en 1965. Il est difficile à trouver, et se révèle complètement désert. Construit sur une colline, il nous accueille avec un étrange portail de béton et une toute aussi étrange cour vide entourée de chemins de béton surélevés. On continue l'ascension jusqu'à arriver à la partie principale : le cimetière en espaliers, où se trouvent environ 600 plaques nominatives. Sur la gauche, un sentier entouré de parois de béton aux formes surréalistes mène au point culminant, où trônent une fontaine asséchée et une large sculpture circulaire très ésotérique, symbolisant je ne sais quoi. On sent que l'endroit a été successivement délaissé et rénové. En ce moment il est assez propre, mais l'herbe fait petit à petit éclater le sol.
J'aime ce genre de créations, ces monuments des Balkans. Quelle que soit l'idéologie qui l'a élevé, il n'y est pas enchaîné. Il peut se faire le symbole de n'importe quoi. C'est une entité presque autonome qui habite l'espace, qui
est l'espace.
On revient vers le centre, en croisant toujours de nombreux impacts de balles. Bernadette veut aller voir une église et visiter le musée du pont, mais je sens la fatigue me rattraper, et je ne suis pas particulièrement tenté par ces activités. On se sépare. Je fais quelques courses, me trouve un coin tranquille pour manger au bout d'une ruelle qui donne sur la rivière, et rentre à l'auberge pour écrire ces lignes en subissant les goûts musicaux discutables de la personne qui fait le ménage. Aujourd'hui, jusqu'à 38° : je pense laisser couler l'après-midi à l'ombre.
Je parviens à faire une sieste, et quand Bernadette revient, on repart se balader, en regrettant un peu de ne pas pourvoir grimper sur les collines qui, n'offrant pas d'ombre, sont comme hors d'atteinte. On retourne dans le centre ultra touristique, et on voit un type sauter du pont, tradition locale.
11 aout : Mostar → Sarajevo
On se lève à 6h pour prendre le train : ici, il est moins cher que le bus. Il est aussi étonnamment confortable, loin des standards habituels des Balkans, on y est plus à l'aise que dans bien des trains français. On passe dans de charmants canyons coupés par des barrages, avant d'atteindre Konjic, où je songeais à faire étape, avait d'y renoncer à cause des obligations de Bernadette qui nous imposent des contraintes temporelles.
Devant la gare de Sarajevo, la Twisted Tower nous accueille. Sa modernité trône, solitaire, dans un paysage qui semble des décennies en arrière. Ce contraste est étrangement plaisant. On passe déposer nos sacs à l'auberge avant d'aller marcher un peu au hasard. Le vieux quartier arabe m'est désagréable, particulièrement bondé et bruyant, et la vision de nombreux touristes du moyen-orient suivis de leurs femmes en burka éveille en moi des impressions dont je me passerais volontiers. On retourne se poser en terrasse d'un café pour s'organiser un peu. Je lis
Watership Down, qui m'enthousiasme.
Bernadette propose d'aller à la Twisted Tower (137m, construite de 2006 à 2008), d'où on peut avoir une vue panoramique sur toute la ville. On revient donc par le même chemin pris depuis la gare routière, mais cette fois, à chaque intersection, je regarde s'il y a une vue sur les collines, et donc si pendant la guerre les civils qui passaient par là savaient qu'ils avaient une certaine probabilité de se faire tuer par un sniper serbe, ou bosniaque-serbe. Et toujours, des impacts de balles.
La tour trône juste à côté d'une vieille maison presque en ruine. On monte au sommet, ou en effet la vue est large. On remarque bien que la ville est encaissée entre les collines de tous les côtés, collines occupées par les forces serbes au plus fort du siège. J'aperçois le parlement, dont la photo est une des plus célèbres de la guerre. Il a été reconstruit à l'identique.
Un panneau indicatif, dans la tour, me fait sourire :
Winter Olympics in Sarajevo were held from 8th until 19th February 1984. The general view was that these 14th Winter Olympics were the best organized until then in the history of the games.
On revient vers le centre, on mange un falafel infâme (« Le pire falafel que j'ai jamais mangé » d'après un allemand à côté de nous), on passe voir la flamme olympique éternelle (pas si éternelle que ça, vu qu'elle est éteinte) et on va s'installer à l'auberge, où on se retrouve dans des dortoirs différents.
Bernadette veut aller visiter le musée de la guerre, une expo consacrée à Sebrinka, et je l'attends en terrasse d'un café. Je reviens hélas au même que ce matin, malgré la musique sirupeuse omniprésente, pour avoir un point de rendez-vous clair. Quand elle revient, on marche vers le vieux cimetière juif, et elle me parle de l'expo : essentiellement des photos et vidéos. On grimpe dans collines au nord, l'ambiance est calme, parfois verdoyante, et toujours de nombreux impacts de balles sur les murs. Le cimetière juif est étonnant : en hauteur, il offre une large vue sur la ville, et les tombes sont d'énormes rocs lissés. Il n'a été que récemment déminé, le parcourir a donc quelque chose d'inquiétant. Un monument de la seconde guerre mondiale s'est pris un obus ou une balle de sniper, qui a manqué de peu le mot FASIZMA. Il n'y a personne.

On redescend, en passant par le parlement et d'autres bâtiments d'allure officielle. On croise aussi une étrange sculpture de deux larges chevaux en fil de fer, sur rail. Fabriquée dans un garage pendant la guerre, elle n'est là que temporairement, à l'occasion d'une célébration, mais elle devrait trouver sa place dans la ville de façon plus durable. Je crois qu'elle est dans l'avenue qui, pendant la guerre, portait le nom de Sniper Alley.
12 aout : Sarajevo
Aujourd'hui, un peu de marche : on va à pied voir les ruines de la piste de bobsleigh des J.O. de 84. La plupart des gens y vont par téléphérique. J'ai repéré un petit chemin qui devrait être agréable. On monte dans les collines, où les rues deviennent rapidement labyrinthiques. On a l'impression de remonter dans le temps. On atteint le chemin, et instantanément on se croirait en montagne : ça monte dur, c'est caillouteux, on croise chèvres et moutons, il n'y a plus aucun bâtiment, si ce n'est de temps en temps une vue plongeante sur Sarajevo. On débouche sur un plat où se trouvent plusieurs maisons en ruine. Un peu plus loin, on tombe enfin sur la piste de bobsleigh, accompagnée d'autres ruines. On marche dedans, sans trop savoir dans quel sens s'élancer. D'après les toiles d'araignées, on est les premiers du jour. On monte par la piste, mais je réalise que le chemin pour l'observatoire devait être en dessous, on redescend un peu jusqu'à trouver la bonne ouverture entre les arbres.

Ce bâtiment a été dans l'ordre une forteresse, puis un observatoire détruit pendant la guerre, en 1992. Encore de nombreux impacts de balles et d'obus, et une jolie vue sur la ville. On retourne faire l'ascension de la piste en béton décorée de graffs, notamment quelques reproduction de Klimt très réussies. J'aime cet amas de béton courbe qui s'est transformé avec le temps en chemin, en moyen d'expression et en témoin de la temporalité humaine si brève, si instantanée, alors que la forêt tout autour est toujours aussi luxuriante, invariablement vivante. Infrastructure à usage unique, civilisation à usage unique.
Un peu plus loin, d'autres humains commencent à apparaitre. Certains font de la trottinette sur la piste. Les oiseaux s'égosillent. On rejoint l'arrivée du téléphérique, ou trône un panneau des J.O., avec cet infâme logo de la ville utilisant la police coca-cola. Quelques touristes errent, indécis, intimidés par l'inclinaison de la montagne. Il est encore tôt et on décide de se faire un sommet : il semble y avoir des chemins. Petite descente jusqu'à un hôtel, puis l'ascension commence. La route se mue petit à petit en sentier, la forêt nous offre de l'ombre, le corps est heureux de se voir opposé un peu de résistance, et le sommet est atteint. Belle vue tout autour de nous, et une étrange tour de télécommunication s'élève non loin. Je n'ai encore rien mangé de la journée, si ce n'est quelques noisettes, et on redescend un peu jusqu'à une baraque en ruine flanquée de bancs dont certains sont encore utilisables. Les raisins secs viennent agrémenter les noisettes. On improvise une petite boucle avant de reprendre le même chemin qu'à l'aller. Quelques voitures tentent de se rapprocher de la piste de bobsleigh, où titubent deux américains obèses, non loin du téléphérique. Plus bas, le petit chemin qui mène au labyrinthe des rues des collines se révèle traitre en descente.
On passe se doucher à l'auberge, où quelques indiens diffusent dans la salle commune leur musique qui fait mal à l'âme. On passe au musée de Franz Ferdinand, sur les lieux de l'étincelle qui a fait exploser la première guerre mondiale. Le musée n'est qu'une pièce unique, on s'en passe. Ensuite, face à la chaleur, on se résout à aller se poser dans un café. On ne parvient pas à en trouver sans musique abyssale, à moins de prendre en échange chichas ou matchs de foot.
Plus tard, on va manger un falafel, bien meilleur que celui d'hier, et on s'achemine lentement vers le bastion jaune. Le timing n'est pas volontaire, mais il semble que ce soit un bon endroit pour le coucher du soleil. En chemin, on croise un immense graff représentant les monuments communistes de Bosnie dans leur état d'origine et actuel. Mon cœur se serre à l'idée que nous n'irons pas les voir. J'ai toujours en tête un grand Tour de l'ex-Yougoslavie centré sur ces monuments. Et depuis le bastion jaune, on peut voir toutes les collines de Sarajevo ou s'étalent des centaines de petites maisons. Difficile de dire que la ville est belle, mais elle dégage un vrai charme. Retour par un cimetière musulman, où une large proportion des tombes portent la date de décès 1995.
13 aout : Sarajevo
Je me lève à 7h, et suis le premier dans la salle commune, ce qui est plaisant. On prend le tram pour aller à l'ouest de la ville, où se trouve la station de bus qui mène vers la Serbie. Contrairement au train qui reluisait, le tram est un peu minable, et terriblement lent. On traverse Sarajevo dans la longueur.
Première étape : la vieille maison des vieux. Pendant le siège, les soldats/miliciens serbes qui ne voulaient pas tuer de civils utilisaient leurs munitions sur ce bâtiment qu'ils savaient être vide. Du coup, il est particulièrement détruit, ce qui contraste avec les murs encore colorés. On entre facilement. Le sol est jonché de déchets. Une fontaine vide se dresse au milieu des décombres, et la végétation reprend ses droits à partir de la cour intérieure. Des bruits étranges, et dans les couloirs sombres, les formes fugaces de chiens errants. L'un d'entre eux se faufile derrière nous, et même si habituellement je n'aime guère les chiens, je m'apaise en les devinant inoffensifs, mais l'endroit invite l'imagination à glisser sur certaines pentes, et Bernadette veut détaler. Dehors, la ruine magnifique fait contraste avec les immeubles modernes. D'autres, le long de l'avenue, on dû connaitre la guerre : on devine les réparations approximatives à la brique de trous d'obus ou de roquettes.

On s'enfonce pour rejoindre la gare routière. Rapidement, la frénésie de l'avenue est oubliée, et on avance entre de nombreuses petites maisons calmes. On rejoint ensuite ensuite des quartiers d'immeubles plus modernes, mais il y a toujours de l'espace et de la verdure. A la station de bus, je n'ai pas assez de liquide, il faut aller en chercher.
Puis direction le musée du tunnel qui passait sous l'aéroport pendant la guerre. Les musées ne m’excitent pas particulièrement, mais bon, on est dans le coin. Il faut encore marcher, on passe au sud de l'aéroport, et on se croirait presque à la campagne. Le musée est une petite chose ridicule et bondée par des groupes qui viennent jusque là en bus et en taxi. Quelques jolies photos de la guerre cependant, si le mot est adapté.
Après un long voyage à pied puis en tram, retour dans le centre. La température est intenable, et je vais passer le reste de la journée à l'auberge, alors que Bernadette va vadrouiller un peu. Les volontaires de l'auberge sont excessivement sociables. L'orage éclate, et je vais utiliser nos dernier roubles sous la pluie pour faire quelques provisions.
14 aout : Sarajevo (Bosnie) → Užice (Serbie)
Je me lève vers 6h30 et attends Bernadette dans la salle commune. On part à 7h. Une fois dans le tram, Bernadette est persuadée qu'on est pas dans le bon. On descend, et on constate quand le tram repart que si, on était dans le bon. Bernadette est confuse. J'ai quelques doutes sur la validité des tickets dans un autre tram : le validateur n'inscrit ni date ni heure, la validité doit donc être établie autrement. Et mes doutes sont confirmés : un contrôleur blasé nous fait signe que ça ne va pas, il demande ma carte d'identité, et nous fait signe de descendre. Amende à payer : un peu plus de 10€ chacun. Je ne perds pas plus de quelques secondes à protester et demande où trouver un distributeur. Je retire du liquide, paie l'amende, et on reprend la route. On marche sous la pluie jusqu'à la gare routière, où une vieille femme fait remarquer à Bernadette que ses lacets sont défaits.
C'est agréable de prendre le bus sous la pluie : de toute façon on ne ferait rien de plus que rester assis et lire. A la frontière, le chauffeur commence à distribuer les passeports après le premier contrôle, mais un garde frontière vient les réclamer avant qu'il n'ait bien avancé, ce qui fait rire tout le monde.
On est les seuls à descendre à Užice. Il pleut. Grands immeubles dans un creux entre les montagnes. On va à l'auberge, puis dehors quand la pluie cesse. Tours de béton verticales et pas mal de ruines. Centre plus véhiculé que celui de Nis, d'après mes souvenirs. On marche un peu près de la rivière, où une ancienne voie de chemin de fer a été convertie en chemin, tunnels compris. On continue un peu sur les collines, et la pluie revient.
15 aout : Užice → Zlatibor
Je me réveille à 5h30, la fatigue ne manquera pas de s'installer dans la journée. Au moins, j'ai la salle commune pour moi seul pendant un moment.
A 8h on part vers la station de bus pour rejoindre le monument de Kadinjaka et faire le retour à pied. On entre dans la gare routière par l'entrée des véhicules, et un type se met à courir vers nous en hurlant, l'air méchant. Après quelques secondes de confusion des deux côtés, il comprend qu'on est étrangers et qu'on essaie pas de frauder : il s'adoucit instantanément et nous donne toutes les indications nécessaires.
On se retrouve dans un minibus qui est rapidement plein à ras bord quand le chauffeur, comme d'habitude dans les Balkans, ramasse tous les gens qui lui font signe au bord de la route. On commence par voir le monument de béton au loin, il se découpe devant le ciel, posé sur un sommet. On descend. Commémorant un combat de 1941 entre le Bataillon des Travailleurs d'Užice et l'armée allemande, il a été construit entre 77 et 79, puis inauguré par Tito, « en présence de 100000 citoyens », si l'on en croit le panneau explicatif. Il n'y a strictement personne, et le temps nuageux donne à l'endroit une luminosité crépusculaire. Encore une fois, j'aime ces formes de béton bizarres, qui se dressent, solitaires, au milieu de nulle part. J'aime leur mélange d'abstraction et de radicalité, d'incertitude et de puissance. Ici, contrairement à bien d'autres, c'est entretenu : pas de graffs et herbe bien tondue. Sur une stèle gravée où se trouve le nom de Tito, quelques fleurs fraiches.

Pour revenir, on passe par les collines, sur de petites routes. Le temps s'éclaircit, on mange des mûres sauvages, on marche entre les cultures de framboisiers, on croise moutons et chèvres. On débouche sur un petit sommet, avec vue sur la vallée et le monument au loin. Pour rejoindre Užice, on descend longuement jusqu'à retrouver les maisons qui grimpent sur les pentes. Passage à l'auberge, pour récupérer nos sacs, puis retour à la gare routière, cette fois pour rejoindre Zlatibor.
 |
| On peut voir le monument dominer la vallée, au loin. |
Quand j'ai sélectionné Zaltibor, la veille, c'était essentiellement parce qu'il y avait une auberge, des montagnes et pas mal de bus. Je ne savais pas que c'est en fait une station touristique. En hiver, il y a le ski, et en été la ville se transforme en... je ne sais pas trop quoi. Il y a un lac artificiel au centre, des gens qui tournent autour, plein d'attrape-touristes, un coin à restos, et une effroyable quantité de bâtiments en construction. J'ai du mal à saisir l'intérêt du lieu, mais on verra demain en marchant dans les environs.
Le type de l'auberge est fan de rap français, et il est déçu que je ne partage pas sa passion.
16 aout : Zlatibor
On part marcher dans la montagne. A Zlatibor même, tout comme dans la campagne alentour, une frénésie de construction. Première remarque : contrairement à hier, où les collines étaient verdoyantes, ici, tout resplendit d'un jaune doré. Les courbes s'étalent à l'horizon et, de l'autre côté, on voit les pistes de ski qui se découpent dans la forêt sur les flancs des montagnes. On progresse en passant dans quelques bois. A un moment, un chiot qui vient nous renifler les pieds manque de se faire écraser par un tracteur. On atteint le lac, et des chevaux se baladent tranquillement sur la route. Malheureusement, les sentiers sont quasi inexistants, ce qui ne nous motive pas à continuer vers la montagne. Il y a aussi une certaine lassitude plus générale qui s'installe en moi. On trouve une table de bois où manger et paresser, et on fait demi-tour. Pour ne pas avoir à repasser par la route avant de regagner la piste, je tente une percée improvisée. On finit par se frayer un passage sous une ligne électrique. Le sol est débarrassé des gros arbres, mais c'est loin d'être un chemin. Finalement, cette stimulation inattendue fait plaisir. On continue un peu à flan de montagne avant de retrouver la piste, où des chiens nous accompagnent.

17 aout : Zlatibor → Belgrade
Matinée dans le bus pour Belgrade. Grande ville, trop grande ville, dont on explore essentiellement le centre piéton. Fatigués, on ne fait pas grand chose d'autre que trainer dans la vieille citadelle, devenue un large parc. Mention spéciale à la petite église dont les chandeliers sont faits d'armes blanches et de centaines de balles, douilles et obus. Dans une autre, juste en dessous, sous de magnifiques mosaïques, les orthodoxes embrassent croix et icônes. Une peinture, dans une alcôve au fond de l'église, accessible après quelques marches qui descendent, semble avoir un succès particulier. Je comprends le réconfort que ces gens trouvent dans la vénération. Je comprends. Sur un banc dans le parc, je termine
Watership Down.
Le soir, à l'auberge, un canadien très sociable, les cheveux longs et blancs, s'active adroitement pour rassembler tous les gens présents, chinois, espagnols, australiens, autour d'un verre sur la grande table.
 |
| Photos de mariage dans le seul coin calme du cœur de Belgrade. |
18 aout : Belgrade
Je me réveille à 5h30. Fatigué toute la journée. On va se poser à un café de bon matin, puis, sous mon impulsion désespérée, direction le musée de la guerre. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris, le désœuvrement sans doute, mais je n'attends normalement plus rien des musées, au contraire, je les évite (exception pour les musées d'art). Comme prévu, c'est terriblement ennuyeux, juste des plans et des armes sous verre, on aurait appris dix fois plus en continuant à lire Wikipédia au café. Mais au moins on rigole bien devant l'insanité de ce mode de transmission du savoir, qui parvient à être encore pire qu'un cours de lycée.
Ensuite, on se sépare pour l'aprèm. Je tombe sur un tournage, sur la longue place devant le musée d'anthropologie. Je m'incruste discrètement dans l'équipe, très nombreuse, pendant un moment, l'air de rien, mais je finis par laisser la place à un groupe de pompiers. Je reste à observer. C'est une scène de la série Navy Seals pour CBS. Beaucoup d'agitation pour un résultat sans doute assez peu digne d'intérêt. Je me lasse. Fatigué, j'erre vainement, et je suis frappé par la vanité du voyage. Je veux dire, j'en suis frappé encore plus que d'habitude. C'est un fait : je m'emmerde. Il y aurait bien quelques trucs sympas à faire dans les environs, comme le monument Rosnaj, ou le bosquet de Salinac, mais c'est loin, il faut prendre le bus pendant longtemps et affronter la chaleur. Je sais que derrière cette lassitude, c'est la fatigue physique qui m'assaille. Mais seulement partiellement. Vraiment, je suis chroniquement las. Ce que j'ai écrit ensuite dans mon carnet de voyage, j'hésite à le reproduire ici. C'est peut-être un peu trop personnel. Mais le fait est que je ressens un intense besoin de travail constructif sur le long terme, plutôt que d'errance au jour le jour. Je ne veux pas être comme un animal qui avance au hasard de ses sensations du moment, je veux une force directrice, une volonté intense. Quand je suis avec Bernadette, je peux passer mon temps à faire des blagues nihilistes, mais tout seul, ce n'est plus possible. Ce n'est plus drôle. Je suppose que la solution, à court terme du moins, c'est le sommeil. A long terme, c'est de continuer à façonner cette force directrice.
Bernadette, de son côté, est allée au mausolée de Tito et dans quelques églises orthodoxes. On va voir les ruines du Q.G. de l'armée serbe, bombardé par l'OTAN en 1999, mais le cœur n'y est plus, et le chaos urbain m'assomme. Bernadette court dans le parc pendant que je lis et que le soleil se couche.
 |
| Hummm... |
19 aout : Belgrade
Petite journée. Le matin, on s'aventure un peu vers Novi Beograd, de l'autre côté du Danube. Ici, chaque quartier est un carré dont le nom est BLOK suivi d'un numéro, jusqu'à au moins 70. Pour y accéder, on passe par un pont très fréquenté par les voitures. Quitter le centre piéton est difficile : on est assailli par le bruit et la laideur, et on fait rapidement demi-tour. Au contraire, le quartier directement au nord-est du centre piéton est agréable, ombragé, calme, agrémenté de jolis restos et cafés, on devine que l'endroit est réservé aux gens les plus aisés.
Après le déjeuner on se sépare. Je ne fais pas grand chose de constructif, je fuis la chaleur, je lis
Man's Search for Meaning, dont le côté religieux non assumé me hérisse les poils, et je fais un tour à la bibliothèque locale, qui se révèle minuscule.
Le soir, particulièrement désespérés, on picole un peu dans le parc. Puis, dans notre dortoir, on papote longuement avec un local, 27 ans, comme moi, venu de Bosnie du nord, Banja Luka. Il a quitté le pays à 18 ans pour aller bosser sur un paquebot de croisière. Il dit avoir fui la misère financière locale, et être devenu instantanément populaire dans sa ville une fois devenu expatrié. Il parle de la haine encore très présente entre les peuples des Balkans, de la guerre qui, selon lui, peut ressurgir à tout moment. Il affirme être en dehors de cette haine, la rejeter, mais apparemment, il n'aime pas les slovènes, ni les macédoniens (mais les slovènes restent les pires). Amère ironie. Il nous montre sa carte d'identité, et nous dit que son origine peut à tout moment causer des tensions, des rejets, des haines. Je l'interroge sur Tito, et il me confirme ce que je présumais : Tito est encore très populaire, car il avait su unir la Yougoslavie, empêcher les guerres civiles, et le niveau de vie était, selon lui, bien plus élevé. Il y avait du travail pour tous et le pain de coûtait rien.
Sur les croisières, les américains lui demandent si son pays est toujours en guerre. Il en est arrivé à répondre
oui, et qu'il est sur le paquebot pour la fuir.
20 aout : Belgrade → Novi Sad
On va à la gare routière pour prendre le bus vers Novi Sad, deuxième ville du pays, et il part 10 secondes après qu'on se soit installés. En chemin, on croise le commandement des forces aériennes, orné d'une statue d'Icare, ou équivalent, en style brutaliste. Le bâtiment ne semble pas dans une forme resplendissante. Je termine
Man's Search for Meaning.
On ne fait pas grand chose, mais Novi Sad se révèle être une ville relativement charmante, quelque part entre le côté passéiste de Nis et le cancer urbain de Belgrade. Le centre est beau, large et vivant, et les environs résidentiels semblent relativement vivables. Toujours un certain nombre de petits vendeurs de rue près des supermarchés. L'auberge est plaisante, petite et mignonne, dans un immeuble ancien qui donne en plein sur la place centrale. Un chinois passe l'aprèm dans le dortoir à parler très fort au téléphone et à s'allonger sur tous les lits.
En fin de journée, Bernadette a une attaque de dépression aigüe, qui convoque beaucoup de larmes et d'auto-apitoiement. Je réponds par un mélange d'indifférence, de compassion, de blagues nihilistes et de philosophie antique sans doute malmenée.
21 aout : Novi Sad
Je me réveille à 5h30. Aujourd'hui, on part dans les montagnes locales. On prend un bus qui nous dépose dans la forêt. Le principal obstacle, ce sont les toiles d'araignées intempestives. Au moins on est en sous-bois presque tout le temps, ce qui est appréciable vu la chaleur. Au premier monastère orthodoxe, on s'infiltre avec un groupe de touristes venus directement en bus. L'église est littéralement transformée en magasin, je me demande ce que Jésus en penserait. Sinon les murs sont recouverts de jolies peintures anciennes, et les tristes dévots embrassent les idoles, achètent des gadgets religieux, distribuent des billets aux hommes en noir, et je ressens l'habituelle fascination mêlée de dégoût.
Vers la fin de la boucle, un monument communiste célèbre je ne sais plus quoi en rapport avec la seconde guerre mondiale. Celui-ci est bien au milieu de nulle part, mais contrairement aux précédents, il est très classique : une haute colonne, des prolétaires de métal unis contre le fascisme, et des fresques. Je préfère les insaisissables formes de béton brutalistes. Pour le retour, il faut faire signe aux cars qui passent, mais on ne doit pas avoir les codes, le premier nous ignore.
Mon carnet de voyage s'arrête ici.
Le soir, on se sépare. Bernadette va courir, et je vais à la gare routière acheter les billets de bus pour le lendemain. puis j'erre un peu dans la ville, et je m'installe sur la place centrale, à côté d'un type qui joue du violon de façon à peu près acceptable : je suis en manque de musique, en grand manque. La prise jack de mon portable est morte, et c'est un drame. Je n'ai pas écouté de musique depuis le début du voyage. Une fois à l'auberge, Bernadette me passe son portable et ses écouteurs, et je m'assoie dans un coin pendant une heure sans bouger, avec de la musique.
22 aout : Novi Sad (Serbie) → Zagreb (Croatie)
Avant de rejoindre ses potes pour marcher en Slovénie le 26, Bernadette veut passer en Autriche, à Klagenfurt, pour laisser une bonne partie de ses affaires chez d'autres amis. (Elle a littéralement deux fois plus d'affaires que moi, voire plus.) J'ai comme projet d'aller à Karlovac, au sud-ouest de Zagreb, pour découvrir cette petite ville et passer au monument de Petrova Gora, mais ce serait trop juste niveau temps, alors on passe la nuit à Zagreb.
J'étais déjà passé dans la capitale de la Croatie il y a quatre ans, et la ville est beaucoup plus vivante que dans mes souvenirs. Je suppose que c'est simplement mon esprit qui me joue des tours, mais comment savoir ? On se ballade un peu, sans aller bien loin, et l'étrange poids de l'insatisfaction revient m'assaillir avec force, je me rapproche d'un état de passivité flottante.
23 aout : Zagreb (Croatie) → Ljubjana (Slovénie)
Bouger autant n'est pas une bonne façon de voyager, mais il s'agit de rejoindre Klagenfurt. J'avais prévu d'accompagner Bernadette et de rencontrer ses potes, qui ont l'air intéressants : ils vivent dans une cabane dans les bois, pensent que les animaux peuvent communiquer avec les humains par télépathie et font des stages de communication avec des poules. Mais je suis plus désespéré que jamais, et de retour à Ljubjana qui, tout comme Zagreb, est bien plus bondée que dans mes souvenirs, je me demande pourquoi cette ville m'avait tant marqué. J'ai l'impression d'être dans un coma éveillé, je peine à prononcer quelques paroles, et je ressens encore ce besoin de force directrice, d'impulsion vitale projetée vers l'avenir. Je pense étrangement à cette citation d'
Ayn Rand (écrivaine que j'aime beaucoup tout me demandant si je devrais en avoir un peu honte) dans
Atlas Shrugged, qui fait l'apologie d'une activité où le travail de chaque jour contribue à la construction d'une œuvre totale, en opposition avec une activité qui ne trouve guère de sens ailleurs que dans l'instant. Et là, dans ce type de voyage, j'ai l'impression de ne faire que passer d'instant en instant, comme un chat qui court après ses croquettes dès qu'il entend le bruit du distributeur automatique qui rythme sa vie. L'attrait d'un nouvel endroit, d'une nouvelle ville, d'un nouveau monument brutaliste, est comme le bruit du distributeur à croquettes. La comparaison est abusive, je sais qu'il y a de la valeur dans ce type de voyage, mais je l'ai perdue de vue, j'ai dû l'user jusqu'à la corde, cette valeur.
Je fais mes adieux à Bernadette, et me prends des billets de bus pour ce soir, à 23h : 16h de voyage jusqu'à Grenoble, avec une pause à Bologne à 4h du matin. Je vais errer dans Ljubjana avec mon sac à dos, je passe beaucoup de temps à marcher, ou assis sans rien faire d'autre que penser. Je vais dans des librairies, je feuillette longuement un gros livre sur l'architecture brutaliste, soupire encore une fois en pensant à tous ces monstrueux monuments communistes que je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir en vrai, et je grimpe la colline centrale. J'aime l'architecture de l'intérieure de la forteresse : la roche brute est intégrée entre des murs de béton, des piliers de métal nu et quelques petites étendues de végétation laissée à elle-même. J'aimerais vivre dans un cadre comme celui-ci. J'aime cette nudité presque aride, où l'ingéniosité humaine, tout en resplendissant, se fait modeste.