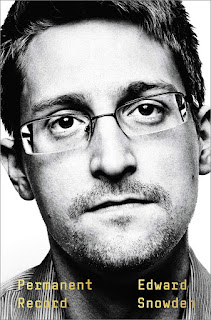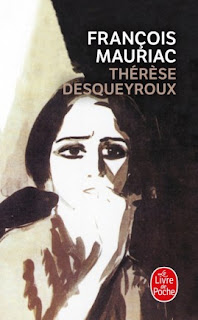jeudi 30 avril 2020
Grendel - John Gardner
Grendel (1971) de John Gardner est une sorte de réécriture de Beowulf, vieux poème anglais considéré comme un classique parmi les classiques. N'ayant pas lu Beowulf, je ne suis pas en mesure de juger Grendel par rapport à son mentor. Peut-être que si j'avais pu saisir je ne sais quelles subtiles allusions, j'aurais pu plus l’apprécier. Grendel, c'est le méchant de l'histoire, le vilain monstre mangeur d'hommes, et ce petit roman est écrit de son point de vue : du début à la fin, il s'agit du monologue intérieur de Grendel. C'est un monstre puissant, terrifiant, presque invincible, mais surtout un monstre triste et solitaire. N'ayant personne de son espèce avec qui partager sa vie, si ce n'est sa vieille mère qui a depuis longtemps oublié tout langage, il a besoin des humains pour se sentir exister, pour avoir d'autres créatures conscientes comme points de référence. Ainsi il passe l'essentiel de son temps à observer le royaume voisin et, à l'occasion, il fait irruption dans la salle du trône pour dévorer quelques barons. Finalement, on passe presque autant de temps avec le roi, sa reine et ses champions qu'avec Grendel. D'ailleurs, narrativement, c'est assez étrange : on a l'impression que Grendel est omniscient tant il disserte avec moult détails sur les tribulations humaines. On obtient une sorte de chronique de royaume, qui m'a vaguement fait penser à Kalpa Impérial d'Angélica Gorodischer ou Des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Eschbach.
John Gardner parvient à trouver le ton juste avec son Grendel : le monstre n'est clairement pas aimable, il mange un peu trop d'humains pour ça, mais le lecteur a le temps de comprendre sa détresse psychologique, sa solitude, et les tragiques limites de son libre arbitre. C'est un monstre, il mange des humains, c'est ainsi, il n'y peut rien. Et après tout, s'il se définit par rapport aux humains, eux se définissent par rapport à lui, il leur offre une altérité, un obstacle contre lequel lutter. C'est sur le plan de la construction que Grendel ne convainc pas. Les passages narratifs sont souvent réussis, j'ai particulièrement aimé celui qui oppose Grendel à un guerrier fier mais trop faible pour vaincre : Grendel se prend d'une sorte d'affection pour son absurde courage et ses prétentions à l’héroïsme, et décide de le laisser vivre. Tout le roman est parsemé de ce genre de relations ambivalentes entre Grendel et certains humains qui éveillent en lui des sentiments complexes et contradictoires, jusqu'à l'arrivée de celui que je suppose être Beowulf (il n'est pas nommé) dont la froide surpuissance est habilement rendue.
Malgré ses qualités, Grendel a globalement l'air, disons... prétentieux. Je suppose que John Gardner essaie de disserter sur la condition humaine, mais souvent ses tentatives, sans être vraiment mauvaises, tombent un peu à plat, la faute notamment à une forme qui sans doute se veut recherchée mais fait surtout soupirer. Parfois, surtout vers la fin, l'auteur passe aux vers, le monologue intérieur devient haché, confus, difficile à suivre, sans offrir de compensation en échange de ces obstacles arbitraires. On a juste l'impression que Gardner s’efforce de faire du style au détriment d'une narration efficace. Et la fin m'a littéralement surprise par son manque d'ampleur : il y a dans cette édition une postface, alors je n'ai pas vu venir les dernières pages du roman lui-même, et cette conclusion abrupte n'est guère satisfaisante. Au final, j'ai envie d'aimer Grendel, sombre aperçu de l'existence vue par un œil monstrueux, l’œil d'une créature de Frankenstein livrée à elle-même, mais je ne peux pas m'y résoudre tant le ton m'a semblé s'écarter trop souvent de l'essentiel pour aller vers l’esbroufe.
mardi 28 avril 2020
Lazarus - Leonid Andreïev
Je n'ai appris qu'après l'avoir lue que la nouvelle Lazarus (1906) de Leonid Andreïev aurait été publiée dans Weird Tales, le magazine pulp américain dont on se souvient surtout grâce à Lovecraft. D'ailleurs, Lovecraft aurait lu et apprécié Leonid Andreïev. Quoi qu'il en soit, Lazarus est un petit chef-d’œuvre. Lazare revient d'entre les morts, mais pas la moindre trace d'une divinité chrétienne dans ce texte, ni de quelque autre divinité d'ailleurs. Lazare est de retour, et il a changé : toute la joie qui était en lui s'est envolée, il est devenu taciturne et contemplatif. Il refuse de raconter ce qu'il a vécu, mais il a ramené avec lui un savoir qu'il partage grâce à son regard. Avec ses yeux, il dévore la vie autour de lui, tel un trou noir, il absorbe définitivement la lumière et la vie. Alors il devient un anachorète du désert, un être quasi mythique que des curieux viennent voir, avant de revenir changés pour toujours, ou tout simplement de se laisser mourir. L’empereur Auguste s'intéresse à lui, voilà donc Lazare transporté à Rome, et tel Jésus il laisse sur son passage un profond sillage, mais un sillage noir ; il n'apporte pas la parole divine mais le silence éternel. Son face-à-face avec Auguste évoque celui entre Jésus et Pilate ; Auguste, partisan de la vie, parvient difficilement à résister à l'assaut entropique du regard de Lazare.
On ne saura jamais ce que Lazare a découvert, et c'est tant mieux : s'il est impossible de décrire le néant, il est possible d'explorer son effet sur ceux qui l'entrevoient. Cette nouvelle est brillante de bout en bout, à la fois complexe, lyrique, exigeante, frappante et débordante d'une richesse intemporelle. Elle aurait pu être écrite aujourd'hui ou sans doute dans cent ans. Si les pleurnicheries surécrites d'un Cioran me font rapidement soupirer d'ennui, si les explorations nihilistes de modernes comme Eugene Thacker, Matt Cardin ou Thomas Ligotti sont loin de toujours me faire acquiescer, j'approuve pleinement la vision magnifiquement aiguisée de Leonid Andreïev. C'est le mystère implacable de la mort qui, non pas sous une forme divine, spectrale ou monstrueuse, mais sous les traits d'un homme, vient littéralement jeter un froid dans les réjouissances et l'insouciance des vivants. Mais qui sait : l'expérience du contraste n'est pas sans valeur.
Libellés :
Andreïev Leonid,
Fantastique,
Littérature,
Univers réaliste
dimanche 26 avril 2020
Proximité
Une nouvelle écrite en décembre 2019. J'ai voulu retrouver le ton de ce
fantastique du début du vingtième siècle qui était indistinct de la
science-fiction. En conséquence, le résultat est peut-être un peu
convenu, mais je n'en suis pas mécontent.
 |
| Mikalojus Konstantinas Ciurlionis - 1909 |
Mon ami Somers avait toujours été un homme peu ordinaire. Quand nous étions jeunes et passions de longues heures sur les bancs de l’université, il ne participait pas à la vie étudiante. La plupart des gens que je fréquentais aimaient chaque semaine occuper de nombreuses soirées à se détendre, de façon parfois répréhensible, mais pas lui. Je ne crois pas l’avoir jamais vu boire un verre d’alcool ni fumer la moindre cigarette. Il vivait en ascète. Pendant que d’autres s’amusaient, il conservait son habituel masque d’austérité et restait dans sa mansarde, occupé le plus souvent à lire ou à écrire.
Notre amitié s’explique certainement par ma curiosité. Ayant deviné en lui un caractère inhabituel, je décidai un jour, entre deux cours, de l’aborder. Il fut tout d’abord surpris, puis méfiant, avant de se détendre. Il remarqua rapidement que, si je n’avais pas son érudition, j’étais néanmoins un polymathe né. Plus important encore, j’avais une forte capacité d’écoute. Avec moi il pouvait disserter pendant des heures entières sur les sujets les plus divers. J’y prenais un plaisir sincère tant son esprit m’émerveillait. Quand je le quittais et me retrouvais en compagnie de gens ordinaires, il me fallait toujours un certain temps pour me réhabituer. Car passer une soirée à discuter avec Somers, c’était comme partir en voyage vers de lointains pays qui recelaient des merveilles insoupçonnées. Mais parfois ces merveilles étaient inquiétantes, à la façon d’une jungle inexplorée, et je me couchai plus d’une fois avec des remords à me laisser si facilement prendre dans sa toile. Mais après une nuit réparatrice, mes doutes étaient oubliés, remplacés par de nouveaux élans de curiosité et de fascination envers cet homme étrange.
S’il avait d’autres amis que moi, je ne les ai jamais rencontrés.
Les années passèrent et nos vies prirent des chemins différents. Je me mariai et trouvai un emploi stable, bien rémunéré mais fort peu excitant. Somers, lui, choisit une autre voie. Celle de la marginalité.
Malgré sa vie monastique, ou peut-être à cause d’elle, il devait avoir une certaine indépendance financière. Il continua ses lectures et voyagea dans les endroits les plus invraisemblables. Inévitablement, nous nous éloignâmes. Malgré la distance, je pensais souvent à lui. Ma vie était confortable mais banale et il représentait pour moi une sorte d’idéal lointain et romantique : un homme qui vivait selon ses propres termes, qui n’avait peur ni de la solitude ni de la radicalité. J’avoue que je ressentais une certaine envie. J’étais persuadé qu’il m’avait oublié.
Je fus donc surpris quand, le 8 mai 1937, je reçus une lettre qui portait son nom. Nous ne nous étions pas vus depuis trois ans. J’ouvris l’enveloppe et lus son message avec curiosité. Dès les premières lignes, je ne pus m’empêcher de sourire. Somers n’avait jamais aimé respecter les codes de la politesse. Il me saluait à peine et ne me posait pas la moindre question. Il se contentait de m’expliquer qu’il vivait désormais à la campagne, dans une maison isolée, pour s’adonner à certaines activités qui nécessitaient un environnement calme et une absence de voisins curieux. Il m’invitait à venir lui rendre visite. J’en fus très heureux et décidai instantanément d’accepter. Mais l’une des dernières phrases me fit froncer les sourcils. « C’est sans doute la dernière occasion de renouveler nos discussions, car les conséquences de mes projets nous éloigneront définitivement. » Que voulait-il dire par « éloigner » ? Et par « définitivement » ? S’apprêtait-il à déménager à l’autre bout du monde ?
Je pris mes dispositions pour le rejoindre sous peu. Ma femme avait déjà rencontré Somers et elle voyait mon affection pour lui comme une extravagance douteuse. Elle me laissa partir comme on accorde un tour de manège à un enfant. Le voyage en train dura trois heures, que je passai essentiellement à rêvasser en regardant la campagne verdoyante défiler par la fenêtre. Je descendis à la gare où Somers devait me rejoindre. Les quelques autres voyageurs se dispersèrent rapidement et je m’installai sur le parvis, bien en évidence. La petite ville sous mes yeux n’était pas très vivante. Je ne voyais devant moi pas d’autre commerce qu’une unique boulangerie et le calme ambiant me fit un effet étrange. Je n’avais pas quitté la ville où j’avais creusé mon terrier depuis longtemps déjà, sauf pour aller dans d’autres villes du même genre, et je remerciai intérieurement Somers de m’offrir l’occasion de changer d’air. J’attendis une bonne demi-heure et commençai à frissonner malgré le soleil printanier quand une voiture crasseuse vint s’arrêter non loin. Quelqu’un en sortit et se dirigea dans ma direction. Je ne reconnus pas Somers avant qu’il soit à cinquante centimètres de moi. En effet, il avait drastiquement changé. Jusque-là je croyais que les années avaient été sévères envers moi, mais mon embonpoint n’était rien par rapport aux décennies qui semblaient s’être précipitées sur Somers en trois ans seulement. Il était devenu chauve. Sa tignasse noire s’était tout simplement évaporée. Son corps accusait une maigreur qui m’inquiéta. Peut-être avait-il des problèmes de santé. Mais le pire, c’était son visage.
Somers prit la parole à sa façon habituelle, sans prendre la peine de me saluer.
— Eh oui, Gilbert. C’est bien moi.
Ma stupéfaction devait être évidente. Je ne pus pas lui répondre tant j’étais fasciné par son visage. Il avait les rides d’un vieillard, ce qui était déjà invraisemblable, mais ce furent les cicatrices qui me choquèrent le plus. À vrai dire, il était difficile de faire la différence entre les rides et les cicatrices. On aurait dit qu’il avait dormi sur un oreiller de barbelés.
— Somers, parvins-je enfin à bafouiller, mais qu’est-ce qui t’est arrivé ?
Il ne répondit à ma question que par un sourire énigmatique avant de se courber pour ramasser ma valise et la rentrer dans la voiture.
— Nous aurons le temps de parler, dit-il.
Je montai à ses côtés et nous ne tardâmes pas à sortir de la ville. Somers parut soulagé quand nous ne fûmes plus entourés que de bois et de champs.
— Gilbert, dit-il soudain, parle-moi de ta vie.
Je me tournai vers lui avec surprise. La relation entre Somers et moi avait toujours été asymétrique. Pour dire les choses plus simplement, il parlait et je l’écoutais. N’allez pas croire que je m’en plaignais, bien au contraire. Avoir un ami comme Somers était une chance et je ne pouvais pas lui en vouloir de se laisser emporter par son enthousiasme passionné, d’autant plus que je savais avec quasi-certitude qu’il n’avait personne d’autre à qui ouvrir son âme. Je me contentais habituellement de remarques, de questions et de calembours — nous avions le même humour. Jamais il ne m’avait interrogé aussi explicitement sur mon existence. Je lui répondis tant bien que mal et lui parlai de mon quotidien, de mes fréquentations, de mon travail et de mes lectures. Au bout d’un moment je ne sus plus quoi raconter, mais Somers restait silencieux, comme s’il attendait que je lui en dise plus. Je ne pus résister plus longtemps et lui demandai :
— Somers, tes cheveux, ton visage, que t’est-il arrivé ?
— Es-tu satisfait de ta vie, Gilbert ? Je ne parle pas de bonheur, mais de satisfaction.
Je soupirai de frustration.
— Je ne sais pas, dis-je. Je crois que je suis satisfait, oui. Mais, pour être parfaitement honnête, je suis à la fois satisfait et insatisfait. Disons que tout va bien, je vis confortablement, j’ai des amis, mais vraiment, est-ce qu’un homme satisfait irait poser un congé sans solde pour rendre visite à un inadapté farfelu comme toi ?
Somers rit doucement et alors que je me tournai pour observer son visage, une impression vague me glaça le sang. Tout d’abord, je ne sus pas pourquoi. Je voyais son visage de profil et il se découpait contre la verdure qui défilait au bord de la route. C’était difficile à saisir, mais je finis par comprendre : son rire n’était pas en harmonie avec ses mouvements. Je pouvais voir son corps presque squelettique s’agiter au rythme de ses ricanements, mais les sons qui sortaient de sa bouche ne semblaient pas coordonnés avec les soubresauts de son torse.
Il quitta un instant la route des yeux et se tourna vers moi.
— Je suis content de te revoir, dit-il.
Il esquissa un hochement de tête et m’accorda un demi-sourire avant de se préoccuper à nouveau de la route. J’aurais dû être heureux des quelques mots qu’il venait de prononcer : je ne crois pas me souvenir qu’il ait déjà évoqué notre amitié. Je suppose que c’était un grand pas en avant dans notre relation. J’aurais aussi pu m’étonner de le voir faire preuve d’autant de chaleur humaine. Mais ces considérations étaient enfouies sous une seule et unique pensée : il y avait un décalage entre les mouvements de ses lèvres et le son de sa voix. Un décalage suffisamment léger pour ne pas m’avoir sauté aux yeux instantanément, alors que j’étais encore sous le choc de son visage ravagé. Mais ici, dans le calme de la voiture, après m’être habitué à ses nouveaux traits, c’était immanquable.
J’en avais le souffle coupé. Je continuai à le fixer pendant que mon esprit cherchait frénétiquement une explication rationnelle. En vain.
Je sortis de ma stupeur quand Somers fit tourner la voiture dans un chemin de terre battue.
— On y est presque, dit-il.
Je m’efforçai de ne pas le regarder et de me concentrer sur le paysage. Nous arrivâmes quelques instants plus tard devant une petite maison. Elle était presque exactement telle que je l’avais imaginée : isolée, peu entretenue, recouverte de lierre, mais dégageant un charme certain. Le soir commençait à tomber et la campagne prenait des teintes presque inquiétantes pour moi qui étais depuis trop longtemps un citadin. Somers me fit visiter et me montra ma chambre. Il alluma un feu dans le salon, déboucha une bouteille de bon rouge et partit en cuisine préparer une collation qui servirait de dîner. Pendant ce temps j’examinai les lieux. La pièce était spartiate. Une vingtaine de livres de science et de philosophie étaient posés sur la table basse. C’était bien trop peu pour Somers. Il devait avoir une véritable bibliothèque quelque part. Les flammes grandissaient dans la cheminée et je remarquai pour la première fois une porte en bois sombre, sous l’escalier qui menait à l’étage. Le sous-sol, certainement. Voilà qui expliquait peut-être le dénuement du reste de la maison. Somers revint bientôt avec de quoi nous sustenter. En mangeant et en buvant nous discutâmes de choses et d’autres. Ce fut une conversation étonnamment normale — deux vieilles connaissances réunies au coin du feu — mais Somers avait l’air malicieux d’un enfant qui a volé quelque breloque et qui se réjouit de la connaissance secrète qu’il a de son méfait. Et à chaque fois qu’il parlait, cet étrange décalage était toujours présent. Cependant, après plusieurs verres, j’en vins à me demander si mon imagination ne me jouait pas des tours. Au bout de quelques heures un silence tomba entre nous. Nous passâmes cinq minutes à observer les flammes frémissantes et à siroter la fin de la bouteille. Puis Somers se leva soudain.
— Il est temps que je réponde à tes questions. À propos de mon visage.
Il avait perdu son sourire et ses traits étaient l’incarnation même du sérieux. Mais je crus y déceler une touche de mélancolie. Comme je m’y attendais, il se dirigea vers la porte du sous-sol et je le suivis. Il l’ouvrit et révéla un puits noir devant lequel je me sentis soudain pris de vertige, mais il actionna un interrupteur et un simple escalier de pierre apparut sous la lumière orangée des ampoules accrochées au plafond. Somers ouvrit la voie. Je fus frappé par un autre détail inexplicable. Je voyais Somers de dos et quelque chose dans ses mouvements me parut anormal. Ses pas étaient, comment dire ? Saccadés ? Discontinus ? Il me semblait que, d’après la position de ses jambes, il n’aurait pas dû tenir en équilibre. Puis, pendant une fraction de seconde, j’eus une vision impossible : Somers venait de lever sa jambe gauche avant que l’autre ne se soit posée au sol. Ses deux pieds étaient à quelques centimètres au-dessus des marches. Je me frottai les yeux et tout redevint normal. Je mis mon trouble sur le compte du vin.
Nous arrivâmes dans la cave. Elle était plongée dans les ténèbres et Somers se tenait à côté d’un interrupteur. Je m’étais attendu à une atmosphère froide et humide, mais l’air semblait sain et je devinai que mon ami devait passer beaucoup de temps ici. Somers me regarda, sourit et actionna l’interrupteur. La cave s’illumina. Elle était voûtée, large d’environ six mètres et longue d’une dizaine. Le côté droit était recouvert de bibliothèques qui débordaient de livres. Sur le côté gauche, une vingtaine de caisses en bois servaient de pépinières à de nombreuses variétés de champignons aux formes et aux couleurs variées. Juste devant nous se dressait un épais bureau en bois massif, submergé de documents et d’ouvrages ouverts. Mais le clou du spectacle, la grande œuvre de Somers, trônait plus loin, au fond de la cave. C’était un fauteuil de métal surplombé de centaines de tubes métalliques, apparemment ordonnés selon des règles géométriques strictes, qui naissaient du plafond et menaient tous au fauteuil. Mais une chose en particulier m’étonna : sur le côté du fauteuil, relié à lui par des attaches articulées, se trouvait une sorte de cage en métal. Elle avait grossièrement la forme d’un corps humain. Je devinai que celui qui s’asseyait dans cet invraisemblable trône devait faire basculer la cage sur lui.
— Magnifique, dit Somers, n’est-ce pas ?
Je me tournai vers lui, consterné.
— Mais qu’est-ce que c’est ?
— La porte vers une existence supérieure.
Je le regardai en silence. Toujours ce décalage entre ses mots et ses lèvres.
— Tu me connais, reprit-il. Je suis un insatisfait invétéré. J’ai passé toute ma vie dans une quête radicale de connaissance. Mais au fil des années le monde est devenu trop étroit pour moi. Alors j’ai tourné mon regard vers un autre monde, un monde plus vaste. Oh, je ne suis pas le premier à m’y être intéressé. Laisse-moi te donner une analogie. Une souris est une géante pour un cafard et même un monstre inimaginable par rapport à une bactérie. Mais quand une souris croise un homme, que voit-elle ? Une montagne en mouvement. Et la souris peut-elle imaginer ce qu’est une planète ? Ce qu’est l’univers ? Certainement pas. Gilbert, comprends-le bien : nous sommes cette souris. Nous sommes aveugles à la plus grande partie de la réalité. Nous sommes incapables de percevoir les montagnes qui marchent au-dessus de nous. Quand j’ai commencé à être las des livres, las des peuples et de leurs superstitions, je me suis tourné vers mes propres sens. J’ai essayé la mescaline et d’autres substances artificielles. Pas mal, pas mal, un bon début. Mais rien ne vaut les champignons, Gilbert. Les champignons sont des guides, ils ouvrent des fenêtres. Non, même pas des fenêtres : des fissures, des meurtrières. Moi, je veux ouvrir une porte. Tu comprends ? Je veux ouvrir une porte pour rejoindre le monde que j’ai aperçu par les meurtrières. Pour rejoindre ceux à qui j’ai parlé à travers les meurtrières.
Il se tut un instant pour laisser à ses paroles le temps de se frayer un chemin jusqu’à ma conscience réticente. Son regard était inflexible.
— Ils m’ont expliqué comment construire une porte, continua-t-il. Ce que tu vois au fond de la cave, c’est la porte. Elle tire son énergie des éclairs qui viennent frapper le paratonnerre. C’est de là que viennent mes cicatrices. Ce sont des brûlures subies au cours des essais. C’est comme ça que j’ai perdu mes cheveux.
J’étais stupéfait. Était-il devenu fou ?
— Cette histoire d’éclairs, dis-je bêtement, c’est comme dans Frankenstein ?
— Non ! éclata Somers. Je n’ai rien à voir avec ce stupide film. Et d’ailleurs, dans le roman, il n’est pas question d’éclairs. Je n’ai rien à voir non plus avec ce roman. Chercher l’origine du principe de la vie, hein ? Créer un être humain ? Des bêtises ! Qui se soucie de la vie humaine, de nos jours ? La vie est une banalité qu’on donne ou qu’on prend en claquant des doigts. Non, Gilbert, je veux bien plus que la vie. Mais viens, remontons. C’est assez pour ce soir.
Je le suivis à l’étage. Ne sachant pas comment réagir, je restai muet et essayai de ne pas regarder ses jambes dans l’escalier.
— Je sais que tu as des doutes, dit-il devant la porte de ma chambre. C’est normal. Mais, ce soir, avant de t’endormir, songe à ceci : pourquoi y a-t-il, depuis trois mois, des orages riches en éclairs, juste au-dessus de ma propriété, plusieurs fois par semaine ? Est-ce que tu peux expliquer ça ?
— Un microclimat, sans doute, dis-je mollement.
— Non, Gilbert. Je t’ai dit que j’ai réussi à contacter des êtres au-delà du voile de notre aveuglement. Ces orages, ces éclairs, ce sont eux qui me tendent la main. Bonne nuit.
Et il s’éclipsa.
Je m’assis sur le lit et réfléchis à tout ce que je venais d’apprendre. Somers était certainement fou. Mais peut-être sa machine fonctionnait-elle à moitié, peut-être captait-elle véritablement l’énergie des éclairs ? Je l’imaginai assis dans son trône de métal, électrocuté et brûlé par la force des orages. Je frissonnai. Il avait dû brûler plus que sa peau. Mais comment expliquer les bizarreries de sa parole et de ses mouvements ?
Pour essayer de me changer les idées, je pris dans ma valise l’un des livres que j’avais amenés avec moi : Alastor, ou le génie de la solitude, de Shelley, en édition bilingue. Étonnamment approprié. Je m’installai sous mes draps et commençai ma lecture. Dans le poème, Alastor est un poète insatisfait qui parcourt le monde à la recherche de « vérités inconnues en des terres inexplorées » jusqu’à ce qu’une vision lui fasse désirer un idéal plus vaste encore. Alastor devient ensuite un homme errant, égaré, amaigri, consumé par sa souffrance. Ce soir-là, je quittai le génie de la solitude alors qu’il s’élançait à bord d’une barque sur un océan impétueux et malmené par les tempêtes.
Je posai le livre sur la table de nuit. Oui, une lecture appropriée.
Le lendemain matin, après une nuit agréable, je descendis dans le salon et me préparai mon petit-déjeuner. Somers n’émergea qu’un peu plus tard et je devinai qu’il avait dû passer une partie de la nuit à travailler. Néanmoins, il était rayonnant et il me proposa de passer la journée à marcher dans la campagne. Il connaissait un petit lac à côté duquel nous pourrions pique-niquer et je m’empressai d’accepter. Nous sortîmes. Le temps était resplendissant et j’observai le paratonnerre qui surplombait le toit. Je ne l’avais pas remarqué la veille, dans la pénombre du soir.
Je ne peux repenser à cette journée sans ressentir un certain regret. La campagne était idyllique et malgré les regards hostiles de quelques paysans (« à cause des éclairs », m’expliqua Somers) nos pérégrinations me procurèrent un grand plaisir. Nous marchâmes dans les bois et les prairies et longeâmes une rivière agréablement paisible. Nous vîmes des lapins, des écureuils et même une biche. Mais, plus que tout, je jouissais de la compagnie d’un ami. Somers était plus ouvert que jamais et s’il ne manquait pas de me parler de ses aventures — physiques et intellectuelles — j’étais moi aussi bavard. J’évoquais longuement les petits drames de la vie quotidienne avec ma femme et les mondanités de la ville. Il riait beaucoup, car je crois que pour lui ces choses banales étaient du plus grand exotisme. Pendant les moments où nous restions silencieux, je me reprochai notre trop longue séparation et me promis de ne pas la laisser se renouveler. Somers avait certainement ses fantaisies, mais je tenais à lui. Et en effet, je n’ai jamais retrouvé une amitié aussi candide.
Le soir approchait et après toute une journée passée ensemble, je ne voyais plus la discordance entre ses paroles et les mouvements de ses lèvres ni les aberrations de ses mouvements qui m’avaient tant frappées. J’étais convaincu que ces choses n’étaient que des illusions psychologiques de ma part et je décidai de lui en parler, sur le ton de l’humour.
— Tu n’as pas eu d’illusions, dit-il avec calme. Ce sont simplement les symptômes de mes expériences. Pour être plus clair : j’ai déjà un pied dans l’embrasure de la porte.
Mon sourire s’effaça.
— Je ne suis pas sûr que ce soit plus clair, dis-je.
— Une partie de moi est déjà dans cet ailleurs. Le reste ne va tarder à la rejoindre.
Ce fut la fin de notre belle journée. Je ne savais plus quoi penser et une certaine gêne s’installa entre nous pendant le dîner. Mais avec le recul, je me rends compte que la gêne n’était que de mon côté : Somers était simplement plongé dans ses pensées. Aujourd’hui, je regrette ma réaction. Si j’avais su ce qui allait suivre, si j’avais accepté le fait que ses propos avaient peut-être un fond de vérité, j’aurais pu en parler avec lui en détails. J’aurais pu essayer de comprendre et lui témoigner mon amitié une dernière fois. Mais j’étais sceptique et troublé. Je me retirai dans ma chambre de bonne heure et Somers me salua avec une solennité inhabituelle.
Je n’étais pas d’humeur à me replonger dans Alastor. J’avais, au contraire, une puissante envie de normalité. Je m’assis à la petite table et passai plusieurs heures à écrire des lettres à ma femme et à quelques autres proches. Je ne rentrais pas dans les détails concernant Somers et me contentais de décrire avec grandiloquence les charmes de la campagne. Au bout d’un moment, un orage éclata. Étonné, j’allai voir à la fenêtre. Il tombait une pluie battante et je ne vis aucune étoile. La nuit était noire comme du charbon. Il ne m’avait pas semblé que le temps s’apprêtait à changer mais, après tout, je n’étais pas météorologue. Je retournai à mon écriture. Un quart d’heure plus tard environ, trois choses arrivèrent exactement au même instant : un éclair illumina la nuit, un coup de tonnerre colossal retentit et ma lampe de bureau s’éteignit. Je tâtonnai quelques instants dans le noir en poussant des jurons jusqu’à trouver ma boite d’allumettes. J’en allumai une et dénichai une bougie dans un tiroir. Je sortis dans le couloir, ma torche improvisée à la main, en appelant Somers. J’allai frapper à la porte de sa chambre, sans réponse. Je l’entrouvris et constatai qu’elle était vide. Il n’était pas non plus dans le salon ou dans la cuisine et j’imaginai qu’il devait certainement travailler au sous-sol. Jusque-là, je ne soupçonnais rien d’inquiétant. Après tout, ce n’était qu’une coupure d’électricité. Ce fut un détail à priori insignifiant qui m’alarma. Il ne s’était pas écoulé cinq minutes depuis l’éclair et je remarquai soudain qu’il ne pleuvait plus. Je m’approchai d’une des fenêtres du salon et regardai dehors. Les étoiles brillaient tranquillement au-dessus d’une nuit claire. Il n’y avait plus le moindre nuage.
Encore aujourd’hui je ne sais pas quoi penser. J’ai consulté de nombreux ouvrages de météorologie, sans trouver de réponse satisfaisante. Je suppose que les orages peuvent en effet apparaître et disparaître soudainement. J’ai aussi parlé avec quelques paysans des environs qui ont confirmé ce que Somers m’avait dit : depuis trois mois, une quantité invraisemblable d’orages frappait les environs. Des orages qui naissaient et s’évanouissaient comme s’ils obéissaient aux claquements des doigts d’un dieu inconnu. Ces orages étranges cessèrent de se manifester après cette nuit-là.
Ma bougie à la main, je faisais face à la porte du sous-sol. J’inspirai profondément et descendis. Je savais plus ou moins consciemment ce que j’allais trouver. Je manquai plusieurs fois de trébucher et j’allumai plusieurs bougies à moitié consumées posées un peu partout, comme s’il était habituel que l’électricité soit coupée. Au-delà du bureau, des caisses à champignons et des bibliothèques, se trouvait l’étrange machine de Somers. Il était assis dans le trône et la cage de métal épousait les formes de son corps. Le souffle coupé, je m’approchai et vérifiai son pouls. Mort, bien sûr. Le métal était encore chaud.
Peut-être aurai-je dû m’élancer dans la nuit pour chercher une maison équipée d’un téléphone et appeler une ambulance ou la police. Mais je me contentai d’allumer un grand feu dans le salon. La police pourrait bien attendre le matin. Je restai longtemps à fixer l’âtre avant d’aller chercher Alastor. Je terminai le poème à la lueur des flammes. Le solitaire Alastor survit à la traversée de l’océan agité par les tempêtes et continue son exploration des terres vierges. La mort s’empare de lui, mais son sort reste incertain. J'aime imaginer qu'il parvient à dépasser les frontières de la réalité commune et ainsi à trouver ce qu’il cherchait avec tant d’avidité.
jeudi 23 avril 2020
Sur l'anarcho-primitivisme - Theodore Kaczynski
Ce texte, dont le titre complet est The truth about primitive life : a critique of anarcho-primitivism, a été écrit par Theodore Kaczynski en prison. (Voir le passionnant La société industrielle et son avenir pour plus de détails sur ses idées.) Ce qui est intéressant, c'est qu'en connaissant les opinions anti-modernité et anti-industrie de Kaczynski, on pourrait à première vue s'attendre à le voir défendre l'anarcho-primitivisme. Mais non : c'est une attaque ! Il s'en prend à cette position qu'il juge dramatiquement détachée du réel, et encore une fois c'est un plaisir à lire : à la fois sobre, mesuré, dense, sérieux (300 notes pour ce petit texte) et radical.
Notons déjà que le mythe du bon sauvage existe encore et a souvent une place étonnamment importante : l'idée que les bandes nomades, avant l'arrivée de l'agriculture et de la sédentarisation, menaient une vie idyllique riche en loisirs. Kaczynski commence par là. Je ne vais pas recopier ses arguments, qu'il serait difficile de densifier encore plus, mais il remet en cause ces estimations et pointe vers une vie non dénuée de labeur, loin de là. Il ne se contente pas d'étaler ses propres opinions : il cite énormément d'ouvrages spécialisés. Il mentionne également le caractère répétitif et laborieux de ce travail (tanner des peaux, ramasser et nettoyer des racines...). Kaczynski a aussi l'avantage de l'expérience personnelle, pour avoir tenté de vivre de la terre. De plus, si ces sociétés vivaient en bandes nomades, ce n'était pas par choix : c'était par nécessité. Ainsi l’absence de larges sociétés hiérarchiques (jusqu'à leur naissance dans le croissant fertile) n'était que le symptôme de conditions de vie précaires, la terre ne pouvant nourrir que des petites bandes mobiles. Ceci dit, l'idée moderne de loisir n'existait pas, et Kaczynski reproche aux anarcho-primitivistes de chercher à l'insérer dans ce contexte de nomadisme forcé. Le travail du chasseur cueilleur était riche en sens intrinsèque (se nourrir, se protéger des éléments, le tout en communauté), en conséquence, il n'avait pas besoin de l'idée moderne de loisir pour compenser un travail abstrait voire absurde. Le chasseur-cueilleur, peut-être paradoxalement (car il est particulièrement asservi à ses besoins naturels essentiels), selon Kaczynski, est un travailleur libre : il n'est pas exploité, il n'a pas de patron, il s'organise comme il veut, et la communauté est si petite que l'individu peut encore l'influencer.
Ensuite, Kaczynski s'attaque à l'idée que les bandes nomades de chasseurs-cueilleurs jouissaient d'une certaine égalité des sexes, d'une absence de violence, étaient empathiques avec les animaux ou encore égalitaristes. Autant dire que c'est clairement une idéalisation irrationnelle du passé, cependant le dernier point est partiellement vrai (encore une fois, il aligne les exemples tirés d'ouvrages spécialisés). Il y a aussi le fantasme suivant : l'humain primitif aurait été généreux et égalitaire volontairement, par bonté innée. Ces sociétés étaient bien sûr, tout comme les nôtres, régies par des tas de règles explicites et implicites. Le partage, quand il existait, n'était pas un choix, mais une nécessité, souvent accomplie avec réticence et occasion de jeux de pouvoir.
Kaczynski souligne que, paradoxalement, il n'a jamais existé de société autant régie par la coopération que le mondialisme moderne. L'idéologie de la compétition, du libre marché, a pour objectif théorique d'optimiser la coopération entre les humains. La compétition pour un meilleur poste, par exemple, est une motivation pour coopérer avec l'entreprise qui offre ce poste et, théoriquement, avec la société totale dans laquelle s'inscrit cette entreprise. Ainsi peut-être vivons-nous dans une gigantesque toile de coopération, toile dans laquelle il devient difficile de différencier coopération et individualisme, ces deux notions se mélangeant monstrueusement, l'individualisme total étant valorisé comme la meilleure façon de coopérer. (C'est moi qui parle, dans la seconde partie de ce paragraphe.)
Il me semble que l'idée principale est la suivante : pas d'idéalisation. La réalité est grise, et les êtres humains primitifs ne sont pas intrinsèquement meilleurs : comme tous les humains de toutes les époques, ils ont en eux les graines pour adopter une immensité de comportements différents selon les hasards environnementaux, culturels et individuels. La pensée réconfortante que c'est la modernité qui corrompt l'humain est encore dramatiquement répandue : mais ni la modernité ni même l'occident n'ont inventé le viol, la guerre, le racisme, l'écocide ou encore la toute simple pente glissante de la haine et de la violence. Ainsi si Kaczynski veut en finir avec la société industrielle, il veut le faire sans illusions, sans fantasmes édéniques. Position honorable.
Libellés :
Environnement,
Essais,
Kaczynski Theodore,
Philosophie,
Société
lundi 20 avril 2020
To Rouse Leviathan - Matt Cardin
To Rouse Leviathan (2019) de Matt Cardin est un long recueil qui s'inscrit profondément dans l'héritage lovecraftien, mais avec une vision très personnelle : c'est comme si la nature ultime de la réalité était un chaos aveugle, un trou noir, ou la mort thermique de l'univers, et que cette réalité se frayait de façon claire et directe un passage dans le monde des protagonistes. J'aime cette approche. Le recueil est divisé en trois parties, et s'il n'y avait eu que la première, j'aurais été très satisfait : c'est bien écrit, original, et les connaissances théologiques de l'auteur donnent à l'ensemble un ton unique. Notes of a Mad Copyist est particulièrement excellente. Dommage que la suite, en plus d'offrir des histoires globalement inférieures sur le plan de la puissance narrative, lasse en rabâchant les mêmes thèmes avec les mêmes effets.
La première nouvelle, An Abhorrence to All Flesh, commence commence tout à fait dans cette veine religieuse. Un narrateur classique pour ce type de littérature (un écrivain cultivé et prétentieux) rend visite à un vieil ami. Avec quelques autres connaissances, ils vont discuter d'un culte méconnu qui prétend connaitre la véritable nature de Dieu. La narration fonctionne parfaitement et il y a quelques très jolis morceaux d'horreur cosmique, jusqu'à une conclusion où le chaos et l'entropie se fraient littéralement un passage dans le monde de narrateur. Ce sera un thème récurrent. On continue avec Notes of a Mad Copyist et, vraiment, c'est encore meilleur. Dans le monastère du Mont-Saint-Michel, à une époque indéterminée, un moine copiste vit une révélation. Une révélation non pas divine, mais de ce qui se cache derrière le divin. L'écriture est superbe, encore une fois emprunte d'un puissant héritage théologique, et à nouveau le chaos, le néant, s'infiltrent dans le réel. C'est presque comme une crise nihiliste poussée à l’extrême, sauf le néant a quelque chose de tangible, d'expérienciel, et peut-être même de vivant. On passe à un format plus court avec The Basement Theater, où le narrateur se retrouve régulièrement projeté dans un théâtre où un auteur écrit la pièce de sa vie. Même chose, c'est l'analogie d'une intense crise psychologique, de la dépression, pourrait-on dire, l'existence devenant une chose distante qui se déroule d'elle-même, sans lien avec un potentiel soi. If It Had Eyes revient sur le thème de la révélation, cette fois d'un artiste, un peintre. Il veut peintre le brouillard, et il y parvient, jusqu'à devenir le brouillard. Dans Judas of the Infinite, le narrateur n'est rien moins que Dieu. En voulant venir en aide à un ancien moine devenu clochard à la suite d'une sombre révélation (encore), Dieu se rend compte que cette sombre révélation est réelle et, malgré sa divinité, il se fait dévorer par un néant plus grand que lui.
Dans Teeth, on trouve la première mention explicite de Lovecraft. Est d'ailleurs citée la fameuse introduction de L'Appel de Cthulhu. C'est une erreur à mon sens, parce que malgré le génie de cet incipit, il est devenu aujourd'hui un lieu commun de la littérature fantastique. Sinon, la nouvelle, qui brasse assez large en allant piocher aussi chez Nietzsche ou Schopenhauer, reste sur les mêmes thèmes : il existe une réalité cachée qui, si la curiosité humaine s'y aventure, détruit la raison. Pas mauvais, mais un peu en deçà du reste à cause d'une exécution moins originale : professeur d'université, livre dangereux et plongée dans la folie. Ceci dit, on y trouve toujours de beaux passages nihilistes. The Stars Shine without Me parvient a bien retranscrire le ton général du recueil dans le monde du travail de bureau et peut se lire comme une vision de l'aliénation infligée par un travail quotidien absurde. Dommage que l'ensemble reste flou et manque d'impact. Même problème pour Desert Places : le narrateur est replongé dans un triangle amoureux et spirituel qu'il avait fui trois ans auparavant, et la très bonne écriture de Matt Cardin, qui offre toujours quelques passages forts, ne parvient pas à camoufler une certaine absence de densité narrative. Blackbrain Dwarf s'attaque de nouveau à la vie quotidienne, à l'american way of life. Un jeune avocat prometteur a des sortes de crises de schizophrénie, ou peut-être de contact avec un ailleurs, qui le poussent foutre en l'air sa belle vie. Ça fonctionne plutôt bien, et Nightmares, Imported and Domestic, continue dans cette veine en se rapprochant plus encore de la partie onirique de l’œuvre de Lovecraft. On ne sait trop ce qui est réel entre la vie de ce peintre d'un monde parallèle et cet homme banal de notre monde qui hante ses rêves. Dommage que ça s'éternise un peu trop et que le propos reste flou. On passe avec The Devil and One Lump dans du pur méta. Le narrateur est un avatar de l'auteur, un écrivain de littérature horrifique à tendance religieuse, et un beau matin, après une cuite, il trouve Satan dans son salon. L'entité Miltonienne lui reproche d'avoir dans son œuvre mis les pieds là où il ne fallait pas et d'avoir peiné les sentiments de Dieu. Les pas de côté méta sont un classique de cette littérature post-lovecraftienne, et celui-là fonctionne très bien et apporte un peu de légèreté et d'humour dans un recueil assez, disons, pesant. The God of Foulness commence bien : un étrange culte semble se répandre, un culte qui vénère les maladies, et en particulier le cancer. Le narrateur, journaliste, enquête. On plonge rapidement dans une cosmologie lovecraftienne, mais l'auteur a le bon goût de ne pas citer de noms. Dommage qu'on sombre finalement dans un schéma classique : rituel et retournement du narrateur. C'est d'autant plus discutable que sous la plume de Matt Cardin les entités lovecraftiennes, notamment Azathoth (dont le nom n'est pas cité), semblent s'intéresser de près aux humains, ce qui contredit tout leur symbolisme.
Chimeras & Grotesqueries est sans doute le moins bon texte jusqu'à présent : un clochard commente les phénomènes bizarres qui prennent place dans la ville autour de lui. Assez soporifique, d'autant plus que le procédé du manuscrit trouvé, avec fausse préface, est ici parfaitement inutile. Prometheus Possessed secoue un peu tout ça en nous projetant dans un futur dystopique, changement bienvenu. Dans un monde d'hypercontrôle aux normes très strictes de santé mentale, la corruption de l'esprit se répand proportionnellement aux efforts accomplis pour l'annihiler. Dommage : si la forme semble fraiche au début, le propos est finalement identique. Je n'ai pas lu The New Pauline Corpus. Dès les premières pages, j'ai été écœuré par cette purée théologico-nihiliste embourbée dans l'héritage lovecraftien. A Cherished Place at the Center of His Plans conclut le recueil. C'est une nouvelle assez longue, qui évoque encore un peintre, hélas sans mener à grand chose d'intéressant.
mercredi 15 avril 2020
Sous la glace
Une toute petite nouvelle écrite aujourd'hui. C'est une histoire qui trotte dans ma tête depuis des années et j'ai déjà fait plusieurs tentatives pour l'écrire, il y a longtemps. Cette version est extrêmement courte, mais au moins, elle est terminée.
 |
| Samuel Birmann - Source de l'Arveron |
C’est un rêve que j’ai fait des centaines de fois à présent. Je me tiens dans un paysage noir et désolé, il semble faire jour, mais le soleil est hors de vue. Un peu plus loin, après une plaine de roche noire, se dresse un immense glacier, pâle et immobile. Ce glacier m’attire. Je fais un pas vers lui, puis un autre, et je ressens soudain une sorte de tremblement de terre qui résonne rythmiquement, boum, boum, boum. Ensuite, je me retrouve devant le glacier, devant un trou dans la glace où s’agitent des lueurs indescriptibles. C’est à ce moment que je me réveille.
Après une semaine, je connaissais ce rêve par cœur et j’ai décidé de faire des recherches. Sans que je puisse expliquer pourquoi, il me semblait évident qu’il s’agissait d’un endroit réel. De la roche volcanique noire à perte de vue, un glacier, le soleil de minuit… J’ai mis plusieurs mois, mais à force d’éplucher des images satellites, j’ai enfin trouvé.
Quand le bus m’a emmené vers Reykjavík depuis l’aéroport, j’ai souri devant la noirceur volcanique du panorama qui emplissait mon champ de vision de l’autre côté des vitres. J’étais au bon endroit. Je n’ai passé qu’une seule nuit dans la ville aux maisons multicolores, juste le temps de récupérer le matériel qu’il me manquait et quelques provisions. Puis je suis parti de bon matin.
J’ai commencé par faire du stop le long de la route qui serpente autour de l’île. Les locaux sont sympathiques et parlent pour la plupart un anglais plus que correct. Certains se sont inquiétés de me voir partir seul : la météo est particulièrement capricieuse en Islande, sans compter la violence de la géographie. Je me contentais de balayer leurs remarques en leur disant que j'allais être très prudent.
Au bout d’un moment, j’ai dû quitter la route pour m’enfoncer dans les terres. Je n’avançais pas très vite et mes chaussures s’abîmaient à un rythme alarmant : parfois, j’avais l’impression de marcher sur des lames de rasoir tant le roc noir qui fait office de sol par ici est agressif, presque vivant et prédateur. Je peinais à trouver un recoin plat pour installer ma petite tente et chaque nuit je faisais le rêve. Il était plus net, plus lumineux, comme s’il me confirmait que j’étais sur la bonne piste et m’encourageait à poursuivre. Le cinquième jour, j’ai atteint une piste. Elle allait dans la bonne direction, alors je l’ai suivie. Le sixième, j’ai croisé deux personnes qui marchaient en sens inverse, un homme et une femme. Bizarrement, ils n’avaient pas de sac à dos, bien qu’il n’y eût pas le moindre hameau dans un rayon de trente kilomètres au moins. Ils se sont contentés de me faire un signe de tête accompagné d’un sourire ambigu. Peut-être savaient-ils ce que je cherchais.
Le huitième jour, je suis arrivé.
J’ai immédiatement reconnu la vaste plaine noire et le colossal glacier bleuté qui s’étalait à l’horizon. La réalité était encore plus belle que le rêve. Il y avait une différence, cependant : une petite maison, visiblement construite très récemment. Je suis tout naturellement allé frapper à la porte et un vieil homme m’a ouvert. Il n’était pas surpris de me voir là et il m’a invité à entrer. Il marmonnait parfois quelques mots en islandais, mais nous n’avions pas besoin de parler pour nous comprendre. Il m’a montré ma chambre et m’a servi un repas chaud et réconfortant. Nous sommes sortis dans la clarté de la nuit d’été et nous avons regardé le glacier. Il semblait bouger, ramper, palpiter, comme si une aurore boréale se déployait dans ses entrailles et lui insufflait une vie nouvelle. Le vieil homme m’a regardé en souriant et je lui ai rendu son sourire.
Dans ma chambre, sous la fenêtre avec vue sur le glacier, il y a un petit bureau. J’y écris cette lettre, mais il me semble à présent que c’est une erreur. Mes mots maladroits paraissent si inappropriés face à la majesté de ce qui attend dehors. Le sol tremble doucement sous mes pieds, boum, boum, boum, et après quelques heures de repos j’irai marcher vers le glacier. De toutes façons, si je donnais cette lettre au vieil homme, dans une enveloppe avec ton adresse, je suis persuadé qu’il n’irait jamais la poster. Mon instinct me dit qu’il y a de nombreuses lettres comme celle-ci dans un tiroir secret, quelque part dans cette maison. Mon instinct me dit aussi que c’est un adieu. Je n’ai jamais été très bon pour les adieux. Tant pis. Je vais rêver une dernière fois et j’irai voir ce qui se cache sous la glace, sous les lueurs, sous ce rêve. Je crois que je commence à comprendre pourquoi je suis là.
jeudi 9 avril 2020
Permanent record (Mémoires vives) - Edward Snowden
Snowden est né dans un cadre qui allait favoriser son avenir : des parents employés de l’État, une maison près du siège du FBI dans un cadre ou presque tout le monde bossait au FBI et un père féru d'informatique qui, grâce à son travail, puis grâce à des achats de matériel, offre à son fils un accès rare au top du top de l'informatique de l'époque. Snowden est un geek particulièrement futé, mais aussi un américain classique : après le 11 septembre il s'engage dans l'armée, et plus tard il offre une arme à feu à sa copine pour la saint Valentin... Typique. Fortement curieux, il a de toute évidence acquis une culture dense et variée en passant tout son temps sur internet quand c'était encore une jungle réservée à une sorte d'élite. Ce que je veux dire, c'est que tout ce livre me pousse m’interroger sur des questions d'éthique, sur l'origine de l'éthique. La plupart des collègues de Snowden n'étaient guère choqués par ce qu'ils voyaient : alors pourquoi Snowden a-t-il fait ce qu'il a fait ? Un sens aigu de la justice et un certain idéalisme, bien sûr, mais d'où viennent ces traits ? Ce n'est pas comme s'il avait passé sa jeunesse à dévorer de la philosophie morale. Qu'est-ce qui fait qu'un humain agit contre ses intérêts immédiats au profit d'un idéal relativement distant ? Pourquoi lui était-il insupportable de faire comme si de rien n'était, comme tout le monde ? Bien sûr, ces questions ne sont pas du tout le propos du livre.
Ceci dit, la première moitié ne manque pas de questionnements divers et variés. J'ai bien aimé ce raisonnement sur la toute puissance de la technique : sachant qu'il est souvent bien plus avantageux financièrement de remplacer totalement une machine défectueuse plutôt que de chercher à la réparer et donc à comprendre son fonctionnement, il est inévitable que les dessous de la technique soient ignorés par le grand public, et donc que la technique se fasse tyrannie. Ainsi l'origine de cette tyrannie serait l'aisance économique, le coup trop léger de la technique qui pousse à surutiliser sans s'y intéresser. Aussi, cette idée sur le proto-internet de la jeunesse de Snowden : le virtuel et le réel ne s'étaient pas encore mélangés. Internet n'était pas encore mêlé à tout un tas d'actions quotidiennes, il fallait vraiment aller sur internet.
Sur le mélange public/privé : même dans le milieu du renseignement, il y a une majorité de "prestataires". C'est pratique pour maintenir une certaine concurrence et pour contourner les régulations du budget. Mais surtout, comme partout, il s'agit de corruption à grande échelle : les cadres du public, quand ils choisissent vers quelle boîte privée faire couler des centaines de millions de dollars, se réservent du même coup des postes lucratifs dans ces mêmes boîtes pour un peu plus tard. Échange de service. Comme en France, on privatise les profits tout en nationalisant les pertes.
Il y a quelques passages à l'ambassade de Genève qui semblent sortis d'un film d'espionnage, et Snowden en profite pour rappeler que que la première fonction d'une ambassade dans un monde de communication à longue distance est de servir de plate-forme pour l'espionnage. Il évoque la richesse à Genève quand, pendant la crise économique de 2008, les saoudiens viennent y dépenser les millions du pétrole.
Snowden change plusieurs fois de poste et s'intéresse petit à petit aux méthodes secrètes des agences de renseignement, auxquelles il a plus ou moins accès grâce à son job d'administrateur système (ou quelque chose d'approchant). Une pirouette linguistique tout à fait étonnante : le changement de sens du mot obtenir, par exemple. La NSA stocke absolument toutes les infos de tout le monde, mais, légalement, ne prétend les obtenir que quand elle les extrait de ses bases de données. Ainsi toutes les données dormantes pour l'éternité dans les serveurs de la NSA ne sont pas considérées comme existantes, comme obtenues.
Quand on pense aux données récupérées par les services de renseignement, on pense souvent aux donnée tangibles : texte, messages, vidéos... Mais plus intéressantes encore sont les métadonnées : les petites données qui documentent les moindres actions effectuées sur les machines et sur les réseaux. Les métadonnées sont pas directement produites par les utilisateurs, elles sont produites automatiquement par les machines. Et les lois s'intéressent beaucoup moins à la protection des métadonnées, en raison de leur quasi invisibilité, alors qu'elles intéressent beaucoup les agences.
Pour ce qui est des technologies elles-mêmes, eh bien, c'est simple : en 2013 du moins, la NSA avait à sa disposition un moteur de recherche qui servait à accéder aux données privées des gens. On y tape un nom, une adresse mail, un numéro de téléphone, et toutes les données privées de la personne s'affichent dans les résultats. En somme, tout, absolument tout ce qui est fait sur des machines connectées, par absolument tout le monde, est accessible à ces agences (sauf en cas de cryptage). Et comme l'agence ne reconnait pas l'existence de ce genre de programmes, elle ne peut poursuivre personne en cas d'abus du système, car ce serait reconnaitre son existence. De plus, le but ultime est de stocker toutes ces données pour autant de temps que possible. Au moins des années aujourd'hui, des décennies demain, et bientôt, qui sait, l'éternité.
Mentionnons aussi les comportements de tous les pays occidentaux qui refusent d’accueillir Snowden et bien d'autres lanceurs d'alerte. Les USA ont fait révoquer son passeport alors qu'il fuyait Hong Kong pour l’Équateur en 2013, car il n'y était plus en sécurité. Il est toujours bloqué en Russie, qui était censé n'être qu'une étape pour changer d'avion. Les USA allaient jusqu'à faire pression sur les gouvernements européens, notamment la France, pour qu'ils refusent leur espace aérien à l'avion d'Evo Morales, président de Bolivie, avion suspecté d'avoir accueilli Snowden. L'avion a été forcé d’atterrir à Vienne avant d'être fouillé. N'oublions pas, pour conclure, que si on parle ici des USA, tous les gros gouvernements du monde suivent probablement la même voie, et les autocraties qui ne s’embarrassent pas de la moindre prétention démocratique font certainement bien pire que les USA. Après tout, en Chine, un pays qui qui a un usage incroyablement dystopique des réseaux, la notion même de lanceur d'alerte est probablement absurde tant le moindre pas de côté est instantanément réprimé.
lundi 6 avril 2020
La société industrielle et son avenir - Theodore Kaczynski
Theodore Kaczynski est aussi connu sous le nom d'Unabomber. Entre 1978 et sa capture en 1996, il a fabriqué un certain nombre de bombes artisanales et tué trois personnes. Son activité terroriste était une attaque contre la société industrielle. En 1995, il parvient à faire publier Industrial society and its future (La société industrielle et son avenir) dans plusieurs journaux, notamment le New York Times, et c'est ce qui mènera à sa capture, son frère ayant reconnu son style et ses idées.
Commençons par citer trois défauts que j'ai pu repérer dans ce texte. Déjà, l'obsession de Kaczynski envers la gauche. Ses critiques virulentes de la gauche sont souvent pertinentes, mais en commençant et concluant son manifeste sur ce sujet, il prend le risque d'avoir l'air un peu, disons, hors-sujet, voire complètement obsédé, et ainsi soit de faire décrocher un lecteur intéressé par ses autres idées, soit d'attirer ceux qui ne cherchent rien d'autre que taper bêtement sur la gauche. De toute évidence, son passage à l'université (bastion de la gauche américaine) en tant qu'enseignant l'a beaucoup marqué. Ensuite, un défaut que l'on retrouve souvent dans ce type de littérature : une certaine idéalisation de la vie primitive, couplée à une pensée utopique, c'est-à-dire de reprocher à la modernité son imperfection. Et pour finir, le plus important sans doute : l'objectif révolutionnaire final de son rejet de la technique, que je développerai plus loin. Ceci dit, malgré ces points noirs, je suis surpris de constater à quel point le discours de Kaczynski me parle. Il a un regard radical mais extrêmement lucide sur la modernité : car en effet comment être lucide sans être radical ? De plus, et c'est étonnant, il est pas aussi absolutiste qu'on pourrait croire, il prend souvent la peine de nuancer ses opinions et de souligner les potentielles failles de son raisonnement. Son style est clair, son propos organisé et ses idées forment rapidement un système cohérent. En fait, si ses conclusions révolutionnaires sont discutables, de même que certaines opinions de détail, l'ensemble me semble diablement pertinent.
Résumons rapidement l'idée globale : le développement de la société industrielle ne peut être dompté ou contrôlé ; il ne peut mener qu'à une déshumanisation et une aliénation progressive des individus ; c'est la technique qui régit la société et non l'inverse ; seul l’effondrement de la société industrielle peut éviter des maux bien supérieurs à ceux que causeraient ce même effondrement.
Commençons par là où il commence : sa critique de la gauche. Cette critique a pour objet, je crois, de le dissocier de ceux qu'on pourrait à première vue voir comme ses alliés potentiels. Selon lui, la gauche, incapable de modifier le système en profondeur, se concentre sur des "détails", c'est-à-dire la protection des "minorités", quelles qu'elles soient, pour la simple raison qu'elles sont des minorités. Je crois que pour comprendre Kaczynski et sa critique de la gauche il faut songer au contexte universitaire. J'ai récemment eu l'occasion de replonger dans le milieu universitaire, brièvement certes, mais suffisamment pour apprendre qu’apparemment il n'existe pas de problème sociétal plus urgent et important que l'écriture inclusive (tout en sachant que ces mêmes universités sont par excellence des lieux d'abus de pouvoir masculin, abus habituellement couverts par l'entre-soi et pour éviter la mauvaise pub). Mais passons : je pourrais disserter longtemps là-dessus. Kaczynski évoque cette tendance incarnée aujourd'hui par la notion d'écriture inclusive : une hypersensibilité à l'offense, une hypersensibilité qui crée l’offense. De même, la tendance à critiquer les caractères oppresseurs de l'occident et en même temps à nier ces mêmes caractères chez d'autres cultures jugées minoritaires (par exemple, aujourd'hui, en Europe, l'islam). Et, bien sûr, étant donné ses sensibilités anarchistes, l'auteur critique le caractère collectiviste de la gauche, la notion d'état-providence, qui entre en conflit avec ce qu'il voit comme l'indépendance individuelle nécessaire à un épanouissement réel. Il critique ce que j'appelle le constructivisme absolu d'une partie de la gauche : ce rejet de la rationalité et de la science, parce qu'elles pointent vers le fait que certaines croyances sont vraies et d'autres fausses, parce qu'elles pointent vers l'existence d'une inéluctabilité génétique, d'une gênante nature humaine qui contredit la pensée réconfortante que tous les problèmes seraient uniquement sociétaux et que donc il suffirait de créer une bonne société.
Ensuite, une théorie psychologique simple mais parfaitement sensée (quoique son application à l'ensemble de la population puisse être discutable) qui forme la base des opinions exprimées par la suite. Kaczynski l’appelle le power process, que je suis tenté de traduire par la nietzschéenne volonté de puissance. Déjà, on peut comprendre comment les sociétés massives privent l'individu de sa part de puissance, de sa possibilité d'interagir directement avec le monde pour subvenir à ses besoins naturels essentiels par son activité. Ainsi il y a une différence fondamentale entre par exemple les changements causés par les colons de l'Amérique, qui cherchaient et façonnaient eux-mêmes ce changement, et les changements contemporains, dans lesquels l'individu n'a pas la moindre once de pouvoir, et qui donc poussent à chercher du pouvoir en s'associant à des idéaux et mouvements de masse.
Une exploration plus poussée de cette volonté de puissance qui me fait fortement penser aux catégories du désir d’Épicure. En fait, il me semble que c'est exactement ça :
- Les désirs qui peuvent être satisfaits avec peu d'effort.
- Les désirs qui peuvent être satisfaits avec beaucoup d'efforts.
- Les désirs impossibles à satisfaire.
Point suivant : l’impossibilité de réformer la société industrielle. La liberté, selon Kaczynski, est la liberté d'accomplir la volonté de puissance, c'est-à-dire d'accomplir des objectifs réels qui ne soient pas des substituts, le pouvoir de contrôler non pas autrui mais sa propre vie. Cette liberté n'est possible que dans des petits groupes. Or, la technique moderne ne peut exister que dans des systèmes immenses et, si elle semble souvent donner plus de liberté, elle en soustrait tout autant : exemple de la voiture qui, en devenant normalité, rend quasi-impossible la vie sans elle et les obligations qui vont avec elle ; elle n'est donc plus une liberté nouvelle, mais une quasi-nécessité pour obtenir un degré basique de liberté. Il est donc impossible de faire un compromis entre technique et liberté, car la technique est bien plus puissante, elle grignote du terrain par les bénéfices qu'elle offre et ensuite ce terrain lui appartient définitivement. Kaczynski va plus loin dans le détail des maux de la civilisation industrielle.
Les sociétés humaines étant irrémédiablement complexes, il est impossible d'en concevoir une idéale et de s'attendre à pouvoir la réaliser ; les sociétés se développent organiquement. Ainsi, si Kaczynski est révolutionnaire, il n'est pas assez naïf pour croire en l'institution d'un modèle social parfait, ni même meilleur. Il sait que les révolutions échouent dans leurs ambitions utopiques ; en revanche, elle peuvent avoir du succès dans la destruction du modèle précédent. Et c'est qu'il veut : la destruction de la société industrielle et un retour à des micro-sociétés sans industrie. Il essaie de se défendre contre l'idée que le progrès est inévitable, et si j'ai été agréablement surpris par ses arguments, ils ne sont pas assez convaincants. Il me semble que toute tentative pour figer la société est nécessairement vouée à l'échec. Première raison : si on ne fige qu'une partie du monde, c'est livrer cette partie en pâture à ceux qui ne renonceront pas au progrès. Deuxième raison : si l'on fige le monde entier, je ne doute pas que la curiosité et l'ambition d'une minorité ne pourraient que relancer l'humanité dans globalement la même course en avant. Il me semble que cette course en avant est inévitable et amorale, que le primitivisme volontaire n'est qu'une illusion. Une illusion que je comprends : l'esprit humain n'est pas adapté à la modernité, l'évolution n'a tout simplement pas le temps de nous adapter ; l'humanité s'est dissociée du processus évolutionnaire classique. Pour citer je ne sais lequel des innombrables bouquins qui examinent ce problème : nous sommes des singes avec les pouvoirs de dieux. A mon sens, il est vain d'essayer de rejeter le pouvoir divin, il y aura toujours quelqu'un pour vouloir jouer avec, alors autant essayer de ne plus être des singes ; point de vue qui sans doute n'est pas moins utopique.
Comme ce mur de texte le montre, j'ai été plus qu'enthousiasmé par la lecture d'Industrial society and its future de Theodore Kaczynski. Il y a beaucoup de failles là-dedans, mais aussi beaucoup de lucidité, une lucidité radicale et stimulante. Je lirais sans doute d'autres écrits de Kaczynski.
Une version française par là.
Libellés :
Environnement,
Essais,
Kaczynski Theodore,
Philosophie,
Société
samedi 4 avril 2020
Thérèse Desqueyroux - François Mauriac
La Thérèse Desqueyroux (1927) qui donne son nom au roman de François Mauriac est la victime d'un mariage raté. Victime, mais aussi bourreau, puisqu'elle tente d'assassiner son mari avec qui elle est malheureuse. La forme, déjà : c'est court et construit d'une façon inhabituelle, avec une un emploi partiel du présent, des va-et-vient temporels permanents, des points de vue fragmentaires et une intégration sans frontière des monologues intérieurs de Thérèse. Au début, ça m'a semblé un peu inutilement grandiloquent, mais on s'y fait vite, et finalement ce style contribue à donner une épaisseur étonnante à un petit roman.
La trame est simple, vue et revue : le mariage raté. Cependant l’exécution est assez irréprochable. Thérèse est un personnage ambigu, à la fois trop imaginative pour survivre dans un milieu de gens on ne peut plus terre-à-terre, et trop peu éduquée pour savoir quoi faire d'elle-même. Son mari, accaparé par le goût de la chasse et le devoir familial, n'est jamais effleuré par la moindre abstraction, ce qui donne d'autant plus de force à la fin, quand enfin il semble se poser une question. Le jeune homme parisien qui vient rappeler à Thérèse le potentiel réel de la vie est de son côté l'incarnation d'une élite intellectuelle, au sens large, face à laquelle Thérèse ne peut que se sentir emmuré dans un cadre familial écrasant, étouffant. Le thème de l'étouffement est récurrent, et au final le lecteur ne peut guère blâmer Thérèse pour son égoïsme : elle a envie d'exister, elle s'y prend simplement mal. J'ai apprécié Thérèse Desqueyroux, petit roman psychologiquement habile. Il m'a donné envie de relire Anna Karénine. C'est un compliment.
Libellés :
Littérature,
Mauriac François,
Univers réaliste
mercredi 1 avril 2020
Bienvenue à Sturkeyville - Bob Leman
Sous le titre Bienvenue à Sturkeyville sont réunies six nouvelles datant des années 70 et 80 de cet auteur méconnu qu'est Bob Leman. Il paraît que c'est de l'horreur de qualité. Après lecture, je confirme. Bien que l'écriture soit plutôt banale, le style global de Bob Leman parvient à avoir une forte personnalité, notamment parce qu'il joue avec les codes du genre en mettant de côté une partie du suspens. C'est-à-dire que dès les premières lignes il admet tranquillement, par exemple, que oui, il y a bel et bien un monstre. Pas de longues phrases grandiloquentes à la Lovecraft, pas de tentatives artificielles de mystère, on reste sobre et concis. C'est presque un ton anthropologique, où les horreurs sont étudiées avec une froide curiosité. Les thèmes sont récurrents : il y a toujours une sorte de corruption familiale, très lovecraftienne pour le coup, une pourriture qui soit s'infiltre par le sang depuis le passé, soit se force un passage depuis l'extérieur pour pénétrer dans l'intime, pour remplacer l'être ou la vie aimée. Et toujours pour rester dans le lovecraftien, les histoires s'étalent souvent sur des années, des décennies, et sont narrées partiellement sous la forme de récits rapportés. Bref, sous l'apparente simplicité de Bob Leman, il y a vraiment une forte unité thématique et une efficacité narrative indéniable.
Ainsi la première nouvelle, La saison du ver, évoque une horrible créature parasitique qui prend le contrôle d'une famille. Il y a presque un côté cruel dans la description des tortures que subissent le mari et le fils. On reste dans la corruption familiale avec La quête de Clifford M. : c'est une excellente variation sur le thème plus que ressassé du vampire. Bob Leman parvient à être original en développant la biologie de ses vampires, et son protagoniste, torturé entre ses penchants humains et son irrévocable identité vampirique, est touchant. Je sais que j'ai tendance à voir Lovecraft partout, mais Les créatures du lac fait indéniablement penser au Cauchemar d'Insmouth : une malédiction venue d'outre-mer transforme une lignée en créatures marines. Ceci dit, Bob Leman ne fait pas du tout du pastiche, son récit se tient très bien par lui-même. On se rapproche aussi d'un ton psychologique : plus que dans les autres nouvelles, il reste la possibilité que l'horreur ne soit rien d'autre que le fruit de la démence humaine. Mais je n'y crois pas : ce serait nettement moins amusant.
Jusqu'ici c'est un sans faute. Odila me fait encore penser à Lovecraft : une lignée de péquenauds montagnards incestueux cherche à nourrir et protéger l'entité qui est leur ancêtre à tous. Ma foi, il y a là un peu de L'abomination de Dunwich. Cette nouvelle pèche par une narration légèrement confuse, mais le niveau reste haut. Loob s'aventure ensuite sur un terrain dangereux : celui des voyages et paradoxes temporels. Difficile de se dépatouiller de ce sujet, mais pourtant, Bob Leman réussit le pari en ne cherchant pas à trop en faire. Il écrit avant tout l'histoire d'une ville et d'une famille, touchante encore une fois. C'est l'autre nouvelle du recueil où l'hypothèse de la folie est en option. On conclut avec Viens là où mon amour repose et rêve, une variation sur un autre thème classique : la maison hantée. C'est le texte le moins intéressant du recueil : non pas qu'il soit mauvais, il est simplement moins long et moins développé que les autres, il n'accumule pas suffisamment d'inertie et ne fait pas autant d'effet.
En somme, Bienvenue à Sturkeyville est un recueil extrêmement homogène, aussi bien thématiquement que qualitativement, ce qui est rare. De la littérature d'horreur de qualité : un plaisir délicat.
L'avis de TmbM.
Inscription à :
Articles (Atom)