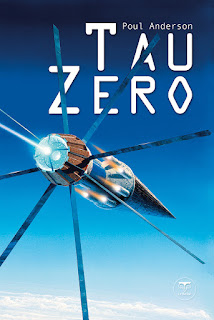|
The Little Girl with Red Headscarf
Nicolae Grigorescu
|
Il
était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept
enfants, tous garçons ; sauf la cadette, une petite fille de
sept ans. Comme elle était la plus jeune, elle était la plus petite
et la plus frêle, et c'est pour cela qu'on l’appelait la petite
Auriculaire, car c'est le plus frêle doigt de la main. Le père et
la mère travaillaient du matin au soir mais cela ne suffisait pas à
remplir les assiettes. Souvent les enfants devaient se contenter de
quelques racines, baies ou fruits sauvages. Mais l'hiver arrivait et
les parents ne pouvaient songer un instant à leur situation sans
sombrer dans le désespoir.
Les
enfants faisaient ce qu'ils pouvaient pour ramener de la nourriture à
la maison. L’aîné, débordant de fierté, a même rapporté une
fois un gros lapin. La petite Auriculaire avait pris le petit
mammifère en affection, et avait versé quelques larmes quand l’aîné
eut le privilège de l'égorger. Mais il y avait maintenant des mois que
la famille n'avait pas mangé de viande. Les enfants, débordant
d'une colère causée par la faim, reportaient leur mauvaise humeur
sur leur petite sœur. Ils se moquaient d'elle, parfois même ils la
frappaient. La petite Auriculaire, de nature calme et discrète,
voyait ces traits renforcés par le comportement de ses frères, et
elle n'ouvrait quasiment jamais la bouche. Un soir, jetée hors de la
chambre commune des enfants par ses frères, comme cela arrivait
souvent, elle se réfugia sous une couverture élimée dans le coin
sombre de la pièce principale qu'elle connaissait bien. Comme elle
était si frêle et si discrète, ses parents, restés prêt du feu
faiblissant, ne l'avaient pas vue et, sans le vouloir, elle entendit
leur conversation. Les flammes tremblantes du feu donnaient aux
traits du père une expression de chagrin profond. Il regardait
fixement les braises quand il dit à sa femme : « C'est
fini. On ne peut plus les nourrir. » « C'est bien vrai, mais
que faire ? Il faut essayer. Essayer de faire tout ce qu'on
peut. » « Non. Tu sais bien que ce n'est plus possible.
Tu le sais. » Le père fit une longue pause, avant de
continuer : « Tu te souviens de ces gens dont je t'ai
parlé ? Ils paient bien. De l'argent bien propre, bien net.
C'est la seule chose à faire. La seule chose à faire. » La
mère resta immobile un moment, puis se mit à sangloter doucement.
Essuyant ses larmes d'un revers de main, elle dit, la voix
vacillante : « Oui, la seule chose à faire. On a plus
d'autre choix, sinon crever de faim. » « Demain soir, dit
le père. Je leur dirai qu'on ne peut plus les nourrir, c'est la
vérité, et qu'ils faut qu'ils aillent un moment chez un cousin. Je
reviendrai seul, avec l'argent. » La petite Auriculaire, qui
parlait peu mais savait écouter, était immobile dans son coin
sombre, invisible. Plus tard, quand elle entendit le ronflement de
ses parents, elle sortit. Dans la clairière qu’occupait la petite
maison, à l'aide de la lumière de la lune, elle ramassa beaucoup de
petits cailloux blancs, qu'elle nettoya dans une flaque d'eau, pour
qu'ils soient bien brillants. Puis elle retourna se blottir dans sa
couverture, et eut beaucoup de mal à s'endormir.
Le
lendemain, le père rentra à la maison beaucoup plus tôt que
d'habitude. Il dit à ses enfants : « Mes petits, vous
savez que depuis trop longtemps nos assiettes sont presque vides à
chaque repas. Cela ne peut continuer ainsi. Ce soir, je vous amène
chez un cousin. Il s'occupera de vous le temps que notre situation
s'améliore. » Tous furent très tristes, la petite Auriculaire
en particulier, mais pour d'autres raisons que ses frères. La mère
pleura beaucoup, alors son aîné lui dit : « Ne
t'inquiète pas maman, non reviendrons bientôt ! » Elle
pleura encore plus.
Le
père guida ses enfants dans la forêt, dans des endroits qu'ils ne
connaissaient pas. Pendant tout ce temps, la petite Auriculaire
laissa derrière elle une file de petits cailloux blancs, discrets
mais clairement visibles. Le soir était presque venu quand la petite
troupe atteignit une clairière. « C'est ici que l'on doit
retrouver mon cousin », dit le père. En effet, quelqu'un
sortit de forêt tout près d'eux, mais ce n'était pas le cousin du
père, c'était un ogre. Il était gigantesque et contemplait les
enfants avec un grand sourire. Ceux-ci étaient tellement paralysés
par la peur qu'ils ne firent pas un geste pendant que l'ogre les
enfourna un par un dans un sac énorme qu'il passa par dessus son
épaule. L'ogre fit retentir un puissant rire gras, et par un trou
dans la toile du sac, la petite Auriculaire le vit donner à son père
une bourse bien pleine. Sans un regard en arrière, le père s'enfuit
d'un pas pressé. La petite Auriculaire vit aussi le reflet blanc de
ses petits cailloux, désormais inutiles.
L'ogre
marcha longtemps avec son fardeau puis arriva à la maison qu'il
partageait avec ses deux frères. Ensemble, les trois ogres
enfermèrent les enfants dans la cave, non sans en avoir gardé un
pour le dîner. Les survivants se lamentèrent : « Oh non,
les ogres vont manger notre frère ! Et puis ce sera notre
tour ! Ils vont tous nous manger ! Nous allons mourir
dévorés, découpés en morceaux ! » Ils pleurèrent pendant fort
longtemps, puis l’aîné eut une idée : « Auriculaire,
tu vois ce soupirail là-haut ? Tu es si mince et si frêle que
si l'on t'aide à l'atteindre, tu pourras passer entre les
barreaux ! » Et tous reprirent en cœur : « Oui,
cela fonctionnera ! Aide nous, Auriculaire, aide nous ! Tu
dois nous sauver ! Tu dois trouver la clé de la cave et nous
sortir de là ! » Et ce fut fait, la petite Auriculaire
passa entre les barreaux en se tortillant et se retrouva dehors,
seule dans la nuit.
S'approchant
d'une fenêtre, elle vit les trois ogres s’affairer dans la
cuisine. Ils tenaient son frère malchanceux, mais ne l'avaient pas
encore tué. Ils avaient arraché ses vêtements et s'amusaient avec
lui comme un chat avec une souris. La petite Auriculaire détourna
rapidement le regard, mais elle avait eu le temps d'apercevoir la clé
de la cave, accrochée au cou de l'un des ogres. Elle fut envahie par
la terreur. Que pouvait faire une petite fille seule et terrifiée
contre trois ogres ? Il lui semblait absolument impossible de
mettre la main sur cette clé sans se faire attraper. Et que
devait-elle à ses frères ? Depuis toujours ils la traitaient
en paria, ils se moquaient d'elle, l'obligeaient à dormir par terre,
et la frappaient. Et soudain, quand ils avaient besoin d'elle, ils la
suppliaient et l'imploraient ? D'un coup, la petite Auriculaire
se mit à courir dans la forêt. Elle espérait retrouver ses
cailloux blancs, et rentrer à la maison, loin des ogres. Elle
courut, courut et courut encore. Elle ne retrouva pas ses cailloux
et, accablée par la fatigue, elle s'endormit contre un arbre.
Le
froid la réveilla. La petite fille, seule dans la forêt, était
terrifiée. Une partie de la lumière de la lune traversait les
branchages, mais cela ne faisait que donner vie à la végétation.
Chaque buisson agité par le vent et chaque rongeur furtif semblaient
pour la petite Auriculaire révéler la présence d'un loup affamé
ou d'un ogre en furie, avide de retrouver sa proie… Elle avait
entendu dire que les ogres possédaient des pouvoirs magiques leur
permettant d'attraper facilement les enfants insouciants. Soudain,
elle entendit des bruissements qui ne pouvaient être ceux du vent.
C'était certainement une grosse créature. Un ogre ! La petite
Auriculaire se roula en boule contre son arbre, comme elle le faisait
dans son petit coin dans la maison de ses parents, souvenir qui
semblait déjà très ancien. Mais les bruits de mouvement se
rapprochaient, de plus en plus près, jusqu'à s’arrêter juste à
coté d'elle. Une main se posa sur son épaule et une voix douce
dit : « N'aie pas peur, petite fille. » La petite
Auriculaire ouvrit les yeux et distingua une silhouette féminine
accroupie à coté d'elle, un sourire calme sur les lèvres. « Une
fée ! Vous êtes une fée ! » La femme rit.
« Vraiment, quelle imagination ont les enfants ! Mais
dis-moi petite fille, n'as tu pas faim et soif ? »
Maintenant que l'idée lui traversait l'esprit, la petite Auriculaire
sentit sa gorge la brûler. « Oui c'est vrai, j'ai très faim
et très soif ! » Et tout d'un coup, elle sentit quelque
chose de mou lui tomber sur la tête. Une grosse grappe de raisin
bien juteux ! Commençant à les croquer un par un, elle dit à
l'inconnue : « Je savais bien que vous êtes une
fée ! Vous avez fait apparaître des raisins pour moi. C'est
très gentil. Merci ! » « Ces raisins ont du tomber
d'une vigne sauvage, dit la femme en riant. Un fée ! Quelle
drôle d'idée. Mais que fait une petite fille comme toi seule la
forêt ? » La petite Auriculaire lui raconta toutes ses
aventures. Soudain submergée par l'émotion, elle dit en
sanglotant : « Mes parents nous ont vendu à des ogres…
Je voudrais qu'ils meurent pour ce qu'ils ont fait ! »
L'inconnue la prit dans ses bras, et elles restèrent un moment
toutes les deux enlacées, jusqu'à ce que l'enfant épuise ses
larmes. « Viens avec moi, dit la femme, je t'apprendrai à
vivre. » La petite Auriculaire se leva. Le chagrin commençait
doucement à disparaître. « D'accord madame la fée ! »
Plus
personne ne revit jamais la petite Auriculaire, mais nos lecteurs
auront raison s'ils supposent qu'elle ne fut point malheureuse. En
revanche, ses parents connurent un destin différent. Après la
disparition de leurs enfants, des rumeurs commencèrent à circuler
dans le voisinage. On disait que le père n'avait aucun cousin, alors
à qui avait-il confié les petits ? Leur rythme de vie aussi
suscitait de vives discussions. Comment pouvaient-ils tout d'un coup
se permettre d'acheter tant de viande et d'alcool ? Il est vrai
que le père et la mère tentaient de noyer leur culpabilité dans le
vin, mais cela ne leur réussit pas. Un matin, ayant jeté un regard
curieux par une fenêtre de leur petite maison, un passant lâcha un
cri et courut chercher le plus de monde possible. La foule ainsi
rassemblée découvrit dans la maison, au milieu de restes de côtes
de porcs et de bouteilles vides, les corps sans vie du couple. Ils
avaient été égorgés, probablement pendant leur ivresse. Et l'on
eut beau fouiller, on ne retrouva pas une seule pièce dans la
maison. Voilà ce qui arrive quand on vit en mauvais chrétien, dit
la foule, voilà ce qui arrive quand on vend ses enfants au diable.
Chacun se régala du spectacle de la mort puis retourna à ses
occupations et pensa à autre chose. Mais pas le fossoyeur qui, on le
comprend, pesta et jura plus longtemps que les autres.
MORALITÉ
On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,
Tant que l'on a du pain à se mettre sous la dent.
Il se peut même que par inadvertance,
On pense que l'un d'eux soit sans importance.
Mais quand viennent la disette et la famine,
Et que soudain sont dans l'air crime et rapine,
Il ne faut pas s'attendre à se faire aider
Par celui qui fut longtemps rejeté et maltraité.