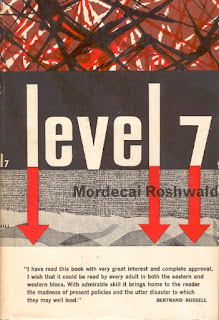|
| Kandinsky - Small Worlds IV |
Than n'en pouvait plus. Il y avait des heures qu'il traversait ainsi la nuit, allongé sur le toit du camion autonome, subissant le vent, se stabilisant avec les électroaimants de ses gants d’escalade. Il s’efforçait de bouger son corps autant qu'il le pouvait, il remuait ses épaules, étirait son cou, mais c'était inutile.
Il avait eu peur, souvent, quand les phares d'un véhicule contenant des passagers l'éclairaient brièvement. Mais ce qui avait été le plus terrifiant, c'était la traversée de la nouvelle frontière avec l’Espagne. Le camion était passé dans le scanner, et Than, à plat ventre, s'était figé, espérant que la combinaison militaire fournie par les passeurs fonctionnerait. Il avait entendu les voix des douaniers, le bourdonnement des drones, et le camion avait repris son chemin.
Il était entré en France.
Soudain, il se rendit compte qu'il était sur un pont. En contrebas, ce qui ressemblait à un immense torrent de boue. Son rythme cardiaque augmenta brusquement. C'était l'endroit décrit par les passeurs, il fallait qu'il se signale, vite. Il dégagea une de ses mains et appuya sur le bouton du petit boîtier noir qui pendait autour de son cou. Le camion continuait de rouler, et il arrivait presque au bout du pont. Than retint son souffle. Si rien ne se passait maintenant, il était foutu.
Il eut soudain l'impression que le camion ralentissait. Oui, c'était bien ça. Les autres véhicules aussi allaient moins vite. Il inspira profondément, soulagé. Il se déporta vers le bord du toit en attendant le moment convenu, se laissa pendre pour diminuer la hauteur, et, juste avant l'embranchement qui partait vers la droite, à côté d'un bosquet d'arbres, il se jeta sur le bitume. Il amortit tant bien que mal son atterrissage, mais il s’érafla les avant-bras. Si le camion n'avait pas été ralenti, il n'aurait sûrement pas survécu à un tel saut. Il se releva rapidement, réajusta son sac, boitilla maladroitement le long de la rambarde et l'enjamba dès que possible. Il se retrouva sur de l'herbe fraîche, sous des arbres, dans l'obscurité. Il cligna plusieurs fois des yeux pour essayer d'y voir quelque chose, mais sa vue n'eut pas le temps de s'habituer aux ténèbres : quelqu'un braqua une lampe torche vers son visage, et une voix agressive se fit entendre.
— Ton nom.
— Than.
L'homme pointa la torche dans une autre direction.
— Retire la combinaison et les gants, vite.
Than se frotta les yeux. Après un instant, il put voir ce qui l'entourait. L'homme qui lui parlait était debout, il le regardait avec un mélange d'indifférence et d'impatience. Plus loin, il y avait une vieille camionnette au coffre ouvert. A l'intérieur, le brouilleur qui permettait de ralentir les véhicules autonomes était tourné en direction de la route. Enfin, assis sur une chaise en plastique, un autre passeur fumait une cigarette. Il avait sur les genoux un large marteau, qui semblait plus fait pour réparer les hommes que les machines.
Il obéit, et sortit de son sac ses propres vêtements.
L'homme examina la combinaison militaire. Apparemment satisfait, il reprit la parole.
— OK, c'est bon. Écoute-moi bien, je vais pas répéter. Le fleuve, c'est la Garonne. On est sur la rive gauche. Ce pont-là, c'est le pont Mitterrand. Pour atteindre Bordeaux, t'as juste à longer la Garonne. Tu vas passer pas loin de la gare, et une fois que tu es au vieux pont en pierre, tu peux considérer que tu es en plein centre. Compris ?
— Oui, oui.
— Ben alors, qu'est-ce que t'attends ? T'as l'intention de passer la nuit ici ?
— C'est-à-dire que vos collègues, à Barcelone, ils m'ont dit que vous me rendriez la caution, pour la combinaison.
— Je suis pas au courant. Dégage.
N'ayant guère d'autres options, Than se mit en marche. Il n'avait jamais vraiment espéré revoir son argent, mais il fallait bien tenter. Il quitta l'abri des arbres et se retrouva entre la digue et la route. Toutes les villes proches de l'océan et traversées par un fleuve avaient des digues, désormais, pour éviter les inondations pendant les fortes marées. Il marchait, obstinément, ignorant de son mieux les phares qui passaient à côté de lui et l’éblouissaient périodiquement. Des bâtiments émergèrent à gauche de la route. Mais c'étaient des entrepôts commerciaux ou de petites industries, et il y aurait sûrement des vigiles. Il valait mieux continuer. Et il était encore poussé par une véritable curiosité. Malgré tous les échecs, toutes les déceptions, il espérait à chaque fois que la nouvelle étape de son odyssée serait la bonne. Après Barcelone, après les camps de Naples, après les horreurs d'Athènes, toujours il conservait de l'espoir. Mais l’espoir était une ressource intimement liée à une autre, qui se faisait de plus en plus rare : l'argent. Than était à sec.
Chassant ces tristes pensées, il accéléra son allure.
Il dépassa un pont ferroviaire, qui passait au-dessus de la digue, puis un deuxième pont juste après. A présent, les immeubles étaient faits de pierre, et possédaient une majesté typiquement européenne, que Than avait appris à apprécier. Il atteignit finalement le vieux pont dont le passeur lui avait parlé. Il était temps de s'aventurer dans la ville même.
Les avenues les plus larges étaient vides, à part quelques passants bourrés qui finissaient leur soirée. Mais, comme il s'y attendait, les rues transversales étaient presque toutes barrées par des grilles. Il progressa plus avant, jusqu'à une longue rue piétonne pleine de boutiques fermées pour la nuit. A chaque fois qu'il voulait s'enfoncer dans les ombres, il voyait une grille, un interphone, un panneau qui indiquait un nom moelleux comme Passage des Lilas, Commerces du Parlement ou encore Promenade Sainte-Catherine. Et parfois, le regard menaçant d'un vigile. Comme partout dans les grandes villes d'Europe, les rues étaient privatisées. Il fut tenté de s'installer tout simplement dans cette artère piétonne, où dormaient déjà de nombreux sans-abris. Mais Than avait appris par l'expérience que, en tant que réfugié, il avait intérêt à redoubler de prudence. Il déboucha sur une vaste place, et s'accorda un instant pour contempler un bâtiment majestueux aux hautes colonnes, surplombé par douze statues. Une enseigne indiquait : Centre commercial du Grand Théâtre. Il alla s’asseoir un instant sur les marches qui menaient à l'édifice, pour se reposer. Mais à peine avait-il posé ses fesses qu'un vigile sortit de l'ombre d'une colonnade.
— Propriété privée, dit-il d'une voix fatiguée.
Than se releva et réajusta son sac.
— Si tu cherches un coin où dormir, reprit le vigile, prends à droite par ici, continue le long des quais, et tu pourras t'installer sous les platanes.
Il montra la direction avec sa matraque.
Than murmura un vague remerciement, et alla dans la direction indiquée.
Il aperçut rapidement le rectangle qui abritait quelques arbres, au bord de la digue. Mais, s'il y avait de l'herbe, elle n'était plus visible : tout l'espace était recouvert de tentes, des dizaines et des dizaines de tentes. Il soupira. Il était habitué à de tels spectacles, mais l'habitude ne le rendait pas insensible. Quelques personnes étaient encore éveillées, autour d'un feu. Than put apercevoir des visages las dans la lumière tremblotante des flammes. D'où venaient tous ceux-là ? Peu importait. Ils étaient tous comme lui. Des réfugiés climatiques.
Il se trouva un petit coin de libre, installa son matelas, puis il se glissa dans son sac de couchage, gardant contre sa peau son portefeuille désespérément vide et son portable déchargé. Le sommeil ne se fit pas attendre.
Au réveil, son premier réflexe fut de vérifier la présence de son sac, puis de son portable et de son portefeuille. Tout était toujours là. Il se redressa et rangea ses affaires. La matinée était déjà bien avancée et l'agitation régnait dans le campement de fortune. Un peu plus loin, il vit un détail qu'il n'avait pas remarqué dans l'obscurité nocturne : deux camionnettes de police. Classique. Than alla à la pêche aux informations. La plupart des réfugiés de l'endroit venaient d'Afrique, et il trouva des gens qui pouvaient parler anglais ou français. Il apprit que ce campement était plus ou moins toléré par la ville, tant qu'il n'y avait pas de débordements. Parfois, la police venait faire quelques rafles, pour maintenir la pression. De l'autre côté du fleuve, il y avait un véritable camp de réfugiés, le camp de la Bastide. Mais les gens ici en avaient peur, ils craignaient, s'ils y allaient, de perdre leur liberté, ou pire, de se faire expulser. Than avait l'habitude des camps. Mais ici, en France, il parlait la langue. Il espérait pouvoir devenir traducteur. Il savait que les craintes des migrants n'étaient pas sans fondement. En allant dans ces camps, on pouvait aussi bien en ressortir après quelques mois avec des papiers qu'y croupir des années pour ensuite se faire expulser. Et difficile de savoir à l'avance ce qui arriverait : les voies de l'administration sont impénétrables.
Il décida d'aller tenter sa chance au camp de réfugiés. Il devrait pouvoir s'en sortir quelques semaines en faisant de la traduction, le temps d'accumuler un peu d'argent. Il suivit à nouveau la Garonne, et passa par le vieux pont de pierre. Il s'arrêta un instant pour contempler le fleuve. C'était un torrent boueux qui, encadré par les digues de chaque côté, ressemblait à une gigantesque canalisation d'égout à ciel ouvert. Il reprit son chemin, tourna à gauche à la fin du pont et passa devant une étrange statue de lion. Là, entre la digue et les bâtiments des banques, des gens faisaient leur footing. Un peu plus loin, sur des pelouses, à nouveau des tentes. A présent le camp était indiqué par des panneaux officiels. Than aperçut soudain, sur un banc, une femme qui lui sembla familière. Il regarda son visage, et il reconnut les traits de son pays. Il alla la voir et lui parla prudemment en français. Comme elle baragouina qu'elle ne parlait pas la langue, il passa au birman. Le visage de la femme s'illumina. Elle aussi était heureuse de croiser un frère loin du foyer. Than s'assit et ils parlèrent du pays et de leurs parcours. Puis, quand la conversation se calma, il réalisa que le banc faisait face à la digue. Autrefois, il devait y avoir une vue sur le fleuve et l'autre rive, mais désormais, la vue n'offrait rien d'autre qu'un mur de béton. Un bon symbole de leur situation.
— Ne va pas au camp, dit la femme. Dans le sud, c'est plus facile de s'en sortir, ils sont débordés, alors souvent ils ne vous empêchent même pas de partir. Mais ici, ils ne veulent pas que l'on aille plus au nord. Alors ils sont plus durs... Mon mari y est, au camp. Lui, ils ne le laisseront pas sortir, mais moi, ils me laisseront rentrer. Il y a des jours que je ne pense qu'à ça : que dois-je faire ? Mais je sais à présent. Je vais aller rejoindre mon mari. Même si c'est pour qu'on se fasse expulser, je dois être avec lui. Toi, n'y va pas, n'y va pas. Je connais un endroit. Un squat. Ça s’appelle le Submersible. Je te donne l'adresse, mais si tu dois demander des indications, mentionne juste le nom de la rue, pas le nom de l'endroit. On ne sait jamais. Ils prennent soin des gens comme nous, là-bas.
Than se laissa tenter. Il n'avait pas envie de se retrouver bloqué au camp, et il n'avait jamais été dans un squat. Peut-être que ces gens pourraient l'aider. Ils se levèrent tous les deux, et il serra dans ses bras sa compatriote. Puis ils se séparèrent, lui, rebroussant chemin, et elle, se dirigeant vers le camp.
Il trouva facilement le bâtiment dont elle lui avait parlé. Situé dans une rue résidentielle comme tant d'autres, c'était un immeuble de pierre classique. Rien ne le différenciait, à part un graff de sous-marin fait au pochoir, à côté de l'entrée. Than s'approcha et frappa à la porte.
Pendant une vingtaine de secondes, rien ne se passa. Puis une femme à l'air fatigué vint lui ouvrir. La première chose qu'il remarqua, ce fut ses cernes. Elle le regardait en silence.
— Bonjour, dit Than. Je cherche le Submersible.
Elle l'observa avec plus d'attention.
— Tu viens d'où ?
— De Birmanie.
— Ton français est parfait.
— Ma mère a passé quelques années en France, il y a longtemps. Elle enseignait le français, en Birmanie. C'est pour ça que je suis venu ici. Parce que je parle la langue. Je peux aider, s'il y a besoin de traductions. Ou pour n'importe quoi, d'ailleurs.
La femme lui sourit.
— Allez, entre. Moi, c'est Anne.
Elle lui fit visiter les parties communes du bâtiment. Il y avait une vaste salle à manger, pleine de grandes tables, une cuisine où quelques personnes étaient affairées, et un salon qui semblait aussi faire office de salle de réunion. Dans la salle de bains, deux hommes réparaient les canalisations en parlant un langage que Than n'identifia pas. Anne lui montra un matelas libre, dans un dortoir. Elle ne lui demanda pas quelle était sa situation, ni s'il comptait rester longtemps.
— Installe-toi, dit-elle. Essaie d'aider comme tu peux, il y a toujours besoin de gens motivés ici. On ne manque jamais de travail à faire.
Elle s'éclipsa et Than fut livré à lui-même. Il s'allongea un instant et ferma les yeux. Il s'endormit involontairement. Quand il se réveilla, le repas était servi dans la salle commune. Quelqu'un lui donna une assiette pleine sans rien lui demander en échange. Il laissa son regard errer sur tous les visages autour de lui. Le monde entier semblait représenté. Les langages s’entremêlaient dans une cacophonie réconfortante.
Les jours s'écoulaient et Than prenait part à la vie du Submersible. Il faisait occasionnellement de la traduction, il aidait à la cuisine, il faisait sa part de ménage. Il respectait les gens qui essayaient de maintenir l'endroit à flot. Du matin au soir, il fallait lutter âprement pour éviter l’effondrement d'une structure aussi précaire. Parmi les réfugiés qui habitaient le Submersible, certains, comme Than, s'impliquaient, mais d'autres restaient désespérément passifs, ou même devenaient activement nuisibles. Et comme l'endroit était auto-géré, il n'y avait pas de structure pour veiller à l'application des règles. Il admirait cette micro-société, cette petite utopie chancelante qui essayait de se construire dans une diversité sans cesse renouvelée. Il voyait Anne qui courait du matin au soir, résolvant des problèmes insolubles, tenant le coup à la seule force de sa volonté. Les autres volontaires étaient comme elle épuisés, surmenés. Than se sentait coupable de profiter de leur bonté, et il décida de ne pas rester plus longtemps.
Alors qu'il était sur le point de partir, ayant fait ses adieux, une dispute éclata entre Anne et Marc, un autre bénévole. Than ne comprenait pas quel était le sujet du désaccord, mais les mots qui volaient étaient violents. Il sortit, pour ne plus voir ce triste spectacle. Mais alors qu'il était encore devant le Submersible, Marc passa la porte, son visage reflétant sa colère. Remarquant Than, il s'adressa à lui.
— Toi aussi, tu te barres de ce trou à rats ? Bonne idée. Allez, viens avec moi, tu vas assister à quelque chose de grandiose, pour changer.
Than, curieux, lui emboîta le pas.
— Tu sais pourquoi on a appelé cet endroit le Submersible ? continuait Marc en marchant. Pour symboliser notre désir de résister à l'effondrement ambiant. Un coin de paix, solide, stable. Des conneries, tout ça. Je n'y crois plus. Dis-moi, tu as lu Histoire de l'abolition de l'Histoire, de Lewis ?
— Non. En ce moment, je relis Lao Tseu.
— Tu devrais, tu devrais. La seule solution, Than, c'est la destruction. Le retour en arrière. Le primitivisme. Le tribalisme. C'est ainsi que l'homme est censé vivre. On a essayé la civilisation, et on a vu ce que ça donnait. J'en peux plus, Than. J'en peux plus. Je supporte plus ce que je vois au quotidien. Alors, avec quelques amis, on a décidé d'agir. De la même façon qu'en créant le Submersible on mettait nos actions en accord avec nos convictions, cette fois, on ne va pas créer, on va détruire.
— Détruire quoi ?
— Tu verras.
Ils se rapprochaient de la Garonne. Than suivit Marc jusqu'au pont de pierre. Mais ils ne traversèrent pas le pont. Marc s'arrêta au niveau de la digue, et il désigna le fleuve du bras.
— Regarde. Aujourd'hui, c'est une grande marée.
L'eau, toujours aussi boueuse, était particulièrement haute et tumultueuse. Sans les digues, la ville aurait eu les pieds dans l'eau. Mais le plus étonnant, ce qui frappa Than, c'était que le courant du fleuve s'était inversé. La puissance irrésistible de la marée faisait couler l'eau de l'aval vers l'amont. La vision était presque apocalyptique, un retournement de la plus banale des lois : la gravité.
— Normalement, reprit Marc, on ne fait ça que de nuit, mais maintenant, peu importe.
Il enjamba la rambarde du pont et atterrit à quatre pattes sur le haut de la digue, juste en dessous. Than, qui sentait quelque chose d'horrible se préparer, l’imita. Ils marchèrent rapidement, attirant les regards de la foule qui flânait sur les quais.
Than, tendu, essayait de comprendre.
— Qu'est-ce que tu comptes faire ?
Marc continuait d'avancer sans répondre.
Il s'arrêta au niveau d'une trappe, la souleva, et s'engouffra dans les profondeurs de la digue. Than, à son tour, descendit l'échelle. Il y avait à peine assez d'espace pour une seule personne, entre tous les conduits, tuyaux et canalisations. Il faisait chaud et humide. Il cligna des yeux, s'habitua à l’obscurité, et accéléra le pas pour suivre Marc.
Ils arrivèrent rapidement dans un espace un peu plus large. Là, il y avait un homme qui, à la lumière d'une lampe, travaillait à quelque chose que Than n'était pas certain de vouloir comprendre.
L'inconnu se tourna vers eux.
— C'est qui, lui ?
— T'inquiète, Ernesto, répondit Marc. C'est un type du Submersible.
— Il est fiable ?
— Peu importe. C'est le moment. Je crois qu'Anne est sur le point de nous dénoncer. Elle est trop tendre, aveuglée par la compassion. Elle refuse d'accepter qu'il n'y a plus rien à sauver. C'est maintenant ou jamais.
— Alors, dit Ernesto en inspirant profondément, c'est parti.
Marc se tourna vers Than.
— Tu devrais partir.
Than ne pouvait plus se voiler la face : ils allaient faire sauter la digue.
— Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça.
— On fait ce qu'on croit nécessaire. On veut simplement, à notre petite échelle, contribuer à l'inévitable annihilation de la civilisation. Pour le bien de l'humanité. Pars.
Than fit demi-tour et, aussi vite que possible, il remonta au sommet de la digue. Le miroir d'eau était tout proche, des centaines de personnes s'y trouvaient, et bien d'autres marchaient sur les quais, profitant du soleil.
Than se mit à hurler et à gesticuler. Il faisait de grands signes, il criait à la foule que la digue allait céder, qu'il fallait qu'ils s'enfuient, qu'ils aillent se réfugier en hauteur. Il attirait bien l'attention de quelques passants, qui le regardaient d'un air interloqué, avant de l'ignorer. Il savait lui-même à quel point le contexte urbain rend insensible aux comportements bizarres. Il n'était qu'un pauvre fou parmi tant d'autres.
Marc et Ernesto ressortirent par la trappe, à côté de lui.
— Ça ne sert à rien, dit Marc qui observait les efforts de Than. Tu ne changeras pas l'inertie de toute une existence.
Et soudain la digue explosa, projetant Than au sol. Il releva les yeux. A trente mètres d'eux, juste devant le miroir d'eau, un torrent opaque et boueux submergeait tout l'espace, emportant avec lui des centaines de corps. L'eau envahissait la place de la bourse et s'engouffrait dans toutes les rues. Than s'attendait à entendre des cris, mais il n'y avait rien d'autre qu'un grondement assourdissant. Le flux ne semblait pas devoir se calmer, pénétrant toujours plus loin les entrailles de la ville.
A sa droite, Marc et Ernesto contemplaient leur œuvre d'un air grave.
Than soupira.
Il lui faudrait aller plus au nord.
Toujours plus au nord, pour fuir la marée montante.