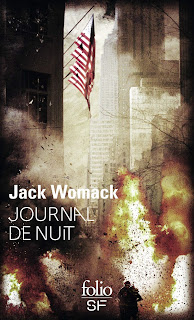|
Vue du terrain depuis la baraque (cliquer pour agrandir)
|
|
Contexte
Plus les années passent, plus je suis tenté par la vie rurale en communauté et une certaine autonomie alimentaire. Quand je dis communauté, c’est relatif : je cherche avant tout à ne pas vivre seul, ni même vivre en couple, du moins pas juste en couple. Alors une sorte de coopération à trois, quatre, cinq personnes, qui savent qu’elles ont des atomes crochus, ça me semble à la fois très sain et assez réaliste. De même pour la question d’autonomie : je ne tiens pas particulièrement à me couper totalement de la société, cependant il me semble qu’une activité comme l’obtention de sa nourriture par ses propres mains est à la fois hautement satisfaisante, intrinsèquement saine et plus que sensée d’un point de vue environnemental. De même, les humains valent mieux que les écrans. Donc, je commence à tendre sérieusement vers ces choses-là.
C’est, ironiquement, l’algorithme de Facebook qui m’a mis sous le nez ce projet d’autonomie, par l’intermédiaire involontaire de D., une connaissance commune. Cette tentative d'incrustation a réussi étonnamment facilement. J’envoie au groupe un long message très typé CV, et la réponse est toute simple : "Azy viens." Bon, eh bien je viens.
6 mars
Après un mélange de train et de covoiturage, j’arrive à la gare, légèrement excentrée par rapport au village. J’ai une heure de marche devant moi. Je parviens à harnacher mon petit sac à dos (plein de vivres) sur mon gros sac à dos, je jette mon épais manteau par-dessus le tout, et en route. La région est agréablement vallonnée et le village accueille quelques commerces : un Proxy, une boulangerie, un salon de coiffure…
J’arrive à la propriété. Je m’efforce de mémoriser les quatre noms inscrits sur la boite aux lettres (je suis mauvais avec les noms) et je prends avec moi le courrier qui s’y trouve. J’avance sur le chemin qui mène a un classique portail campagnard ponctué par des panneaux délavés : "propriété privée" et "attention pièges". Je rentre. À ma droite, des châtaigniers sous lesquels paressent les fougères fanées par l’hiver. À ma gauche, une digue en cours de démolition et un étang en grande partie asséché. Plus loin, l’espace où se trouvait l’eau est à présent le domaine des joncs et autres plantes amatrices d’humidité. Je progresse. Les premières poules se montrent, déplumées au niveau du cou par le coq. Après une légère montée, une nouvelle digue à ma gauche, et, devant moi, le deuxième étang, partiellement vidé. Derrière l’étang, au bout du chemin, la baraque : un petit triangle vert au toit en tôle. Devant, dans la zone de vie ponctuée par des troncs abattus, des poulaillers, des abris et une table faits maison, les habitants du lieu. Je compte plus de quatre personnes : en effet, aujourd’hui, ils ont de la visite. Ils viennent vers moi, m’accueillent chaleureusement et me demandent comment j’ai trouvé l’endroit et pourquoi je ne leur ai pas fait signe pour qu’ils viennent me chercher à la gare. Je savais exactement où ils étaient en réunissant les informations trouvables sur leur page Facebook et je suis plus qu’habitué à la marche. En somme, de leur perspective, je gagne des points de motivation.
Deux pêcheurs sont de passage : comme l’étang est en cours de vidage, autant manger les poissons qui s’y trouvent. Je pose mes affaires dans la baraque : une grande pièce unique avec table au centre, cuisine à gauche et coin couchage à droite, avec trois lits. Au-dessus de la porte d’entrée sont affichés les douze mois d’un calendrier érotique datant de 2003. C’est le genre de chose que, dans les films, on voit dans les salles de gardes ou les cabines de camionneurs : des femmes à la peau uniformément dorée allongées dans des positions lascives étonnantes d’inventivité. Un escalier en colimaçon mène à une mezzanine où se trouve un vrai lit. C’est là que je dormirai, sur la moquette et mon fidèle matelas en mousse.
 |
La scierie mobile
|
Tour de la propriété, qui fait 4 hectares. Ils n’ont ni électricité ni eau courante. Ils se débrouillent avec de petits panneaux solaires ; cuisine au gaz ; chauffage occasionnel au fioul. Dehors, toilettes sèches avec la sciure des pins et douche bricolée. Depuis trois semaines ils boivent l’eau d’une source découverte sur la propriété, sans traitement. Ils ont une scierie mobile à 5 000 € avec laquelle ils débitent les pins de plantation qu’ils ont auparavant abattus. Ils assèchent les étangs en partie par obligation légale (l’ancienne propriétaire ne voulait pas le faire, d’où la cession du terrain) et en partie pour dégager des terres agricoles. Là où se trouvaient les pins ils commencent à installer des carrés de maraîchage, surélevés pour notamment esquiver la terre polluée par les pins. Ils ont une serre bricolée avec une bâche, où grandissent des jeunes pousses. Sur l’étang, proche de la maison, une île où ils prévoient de bâtir un kiosque. Également prévu au niveau de la digue en cours de destruction, un petit terrain de foot. Et le plus important peut-être : ils prévoient de construire trois autres maisons, en dôme et à moitié sur pilotis dans l’étang.
Je passe une partie de l’après-midi avec pelle et pioche à aplanir la digue et à vider les brouettes pleines de terre dans l’étang en cours d’assèchement. Il fait beau et le travail me fait du bien. Les deux pêcheurs ont pêché deux énormes carpes et un brochet. M., le cuistot du groupe, passe la fin d’après-midi, avec de l’assistance, à les préparer. Il y a d’autres gens de passage, notamment un couple qui tient un café associatif au village. Leur fille de 5 ans, une blondinette extrêmement sociable, est adorable. Les poules, une quarantaine, se baladent tout autour et dévorent les tripes et les œufs des poissons.
 |
Deux carpes et un brochet
|
Le soir, une fois les visiteurs partis (ils laissent des bières derrière eux), retraite à l’intérieur, autour de la table. Dans le noir d’abord, puis arrive la petite batterie qui chargeait au soleil. Une faible lampe s’allume, au-dessus de la table. Tous sauf moi sont fumeurs et la maison s’enfume rapidement. Le cuistot cuisine sobrement le poisson avec pâtes et sauce au citron, avec les tomates séchées que j’ai amenées. Excellent. H. part lire dans son lit de camp à la lumière d’une bougie, et au pieux.
Pour que ce récit prenne vraiment sens, il me faut parler un minimum des quatre membres de cette petite confrérie. J’hésite à le faire, car peut-être qu’ils liront tout ça, et je ne sais pas lesquels de mes mots pourraient éventuellement être froissants. De mon point de vue, il n’y a dans ce que j’écris dans les quatre paragraphes suivants pas l’ombre de la moindre négativité. Commençons. Tous ont environ 21 ans.
M. est celui qu’on pourrait qualifier de "meneur", au sens qu’il est à l’origine de ce projet. Il y songe depuis des années. Il est aussi particulièrement ambitieux, vif, voire explosif, à la fois calculateur et chaleureux. C’est essentiellement lui qui fait la cuisine (c’est son truc) et niveau travail, je l’ai surtout vu manier inlassablement la scierie mais aussi participer à tout le reste. On sent que son ardeur joue un rôle important ici. Dans ce corps social, il est l’étincelle et le brasier.
S. est le plus grand, le plus terrien ; sa tenue de travail est militaire. C’est lui qui a la formation nécessaire à la construction, et, pendant mon séjour, je l’ai surtout vu bâtir la nouvelle salle de bain (douche et toilettes), maillet, tronçonneuse ou scie à la main. Sa fierté du travail bien fait et sa temporalité plus détendue forment une légère friction avec l’ambition impatiente de M. Il est un peu bourru et n’hésite pas à émettre vivement toutes sortes d’opinions tranchées. Bien qu’intéressé par les sciences, il se moque de l’intellectualisme stérile et attend avec impatience un effondrement sociétal brutal. Dans ce corps social, il est les pieds (qui jouissent d’un parquet bien bâti) et la clé de voûte.
H. est le plus virevoltant, on ne s’étonne pas qu’il soit un évadé des beaux-arts. Fuyant la vacuité prétentieuse des études, ici, il s’occupe des plantes. D’après ce que j’ai vu, c’est lui qui a la fonction la plus spécialisée : il participe assez peu aux efforts de construction et les autres le laissent, pour l’instant du moins, gérer les affaires végétales. C’est le plus fantasque du lot : parfois il travaille en silence, le casque sur les oreilles ; parfois il rit aux éclats et enchaîne les bons mots ; parfois il se terre plus longtemps que tous les autres dans son sac de couchage ; parfois il partage avec passion son enthousiasme débordant pour l’étude et la pratique des plantes. C’est aussi celui qui souffre le plus de l’absence de femme, ou du moins celui qui n’hésite pas à en parler. Dans ce corps social, il est le cœur et la racine.
N. est le plus discret et le plus calme. Il ne m’a pas semblé être spécialisé, mais au contraire être très touche-à-tout : je l’ai vu aider à la plupart des travaux et mener seul des projets secondaires. C’est lui qui s’est joint à moi au début et qui m’a guidé, c’est donc en bonne partie grâce à lui et à sa paisible bienveillance que je me suis senti instantanément bien là-bas. Fils d’agriculteur, comme moi ennemi d’une certaine part de la modernité, il a eu du mal à s’accommoder des instruments à moteur type tronçonneuse. Face aux personnalités plus clairement à tendance excessive des trois autres, il incarne une certaine garantie de paix. Dans ce corps social, il est le sang et le souffle.
 |
Poule et planches
|
7 mars
Sommeil fragmenté mais qualitatif. Je me réveille avant 7h et, comme personne ne se lève, je reste une heure dans le sac de couchage. Je commence à écrire dans mon carnet en le posant sur mon oreiller de fortune, puis, quand un réveil sonne à 8h, je me lève. Petit-déjeuner, et retour à la digue avec pelle, pioche et brouette. Le transport d’un pavé de béton me fait tourner la tête et vers 10h30, averse. Alors retour à la maison, avant de finir la matinée de nouveau à la digue, cette fois au soleil, torse nu. À midi, les restes d’hier soir, et la maison s'enfume de nouveau. Par la fenêtre, les poules picorent devant les troncs de pin entassés.
Ensuite, certains s’allongent un peu, mais le retour au travail ne tarde pas. M. s’occupe de la scierie, S. entame la nouvelle douche, H., à cause de son doigt blessé, se contente de nettoyer les abords du lac, et je me satisfais de repartir avec N. aplanir la digue. On y passe l’après-midi. Mon corps n’est pas habitué à autant de travail physique, et si je me retrouve à faire plus de micro-pauses que N., je ne suis pas mécontent de mon endurance. On finit vers 17h30. S. a bien avancé sur la douche, mais il s’est rendu compte trop tard d’une erreur : pas assez de pilotis et planches trop fines, donc ensemble pas assez stable. Il va devoir arranger ça.
 |
C'est moi ! Et Jack.
|
Je pars récolter de la mâche repérée sur la digue. Jack, le chien, me suit, persuadé qu’il y a quelque chose d’intéressant dans le sac en papier que j’ai pris. Je lui montre que le sac est vide, mais Jack n’est pas convaincu : il semble avoir de très mauvaises bases en physique. Je ramasse la mâche, qui de toutes façons aurait été détruite en même temps que cette partie de la digue, et je farfouille dans les orties, dont les piqûres ne me font pas grand-chose. Le chien se lasse et part, puis à mon tour de rentrer. Les autres sont étonnés par ma récolte. C’est assez satisfaisant : je ne sais pas manier une tronçonneuse, ni couper des planches, ni rien bâtir, mais je sais identifier de la mâche sauvage ! Pendant que je la lave, je suis de nouveau exposé à un accompagnement sonore auquel je ne suis pas habitué : M. passe en boucle le dernier album de Booba. "Nique ta mère — nique ta grand-mère — salope — Ferrari — j’suis pas Charlie." C’est l’occasion de rester en contact avec la culture dominante je suppose. M. fait un mélange excellent avec ce qu’il reste de poisson et de pâtes, et de la vinaigrette pour la mâche.
 |
Ancienne douche à droite, et fondations de la nouvelle.
|
8 mars
Je me réveille à 4h. J’ai envie de pisser mais pour sortir, il me faudrait faire claquer la porte en métal, alors je m’abstiens. Comme on se couche tôt, il ne me manquera qu’un seul cycle de sommeil pour une nuit complète, ce qui est parfaitement acceptable. J’ai le temps de penser, dans mon sac de couchage.
Comme c’est indirectement à cause de D. que je suis ici, et que je la connais depuis tout petit (elle me l’a rappelé — je ne m’en souvenais plus), je vois défiler pas mal de scènes de jeunesse. Je me souviens très peu de mon enfance et je suis toujours étonné par ceux qui en parlent avec nostalgie. Il me semble que j’étais à peine vivant, et que si j’étais vivant, je n’étais certainement pas moi, peut-être un embryon. On est toujours l’embryon de son futur soi. Mes souvenirs sont peu nombreux au collège : essentiellement des déceptions, le contact avec la malveillance gratuite. Sans aller dans les détails, un moment symbolique. J., qu’auparavant j’aimais bien, était assis à côté de moi en maths. Il s’est mis à me donner des coups dans la cuisse avec la pointe de son stylo à intervalles réguliers. À chaque cours de maths. Ça me rendait dingue, je ne comprenais pas, j’en avais presque les larmes aux yeux. À mes "Pourquoi ? Pourquoi ?" il a enfin répondu : "Toi, t’as rien compris à la vie." J’ai fini par comprendre : il me suffisait de répliquer à la violence gratuite par la violence vengeresse. Je ne sais pas quel âge j’ai, mais je suis au-dessus des cratères de l’Etna, perdu dans les fumerolles de soufre, on me retient pendant que je me penche dans le vide au fond duquel bouillonne le monde. Je m’ennuie un soir sur l’île de Pâques et je vais marcher au bord de la mer, le village est si petit, je m’assois seul près d’un Moaï. J’aime l’île de Stromboli, parce qu’il n’y a pas de voitures mais de bonnes pizzas — sans compter la lave qui gicle. J’ai peur que la tente s’envole dans la tempête islandaise, je suis frappé par la roche volcanique, désert de noirceur. Je suis à Santiago du Chili, la nuit, les arpenteuses attendent le client, des gamins fouillent dans de gigantesques tas d’ordures et un mendiant au bras amputé joue de la guitare avec un médiator accroché à son moignon. Je suis dans je ne sais quelle montagne, je mange des myrtilles, il pleut et je suis trempé, alors je ris sous la pluie, parce que je n’ai plus rien de sec, plus rien à perdre, et je sais que l’eau, ça s’évapore.
D. n’était pas dans le même lycée que moi, mais je l’ai (re)connue via T., mon pote toxico. Vers la fin du lycée, T. avait la salive noire à force de se couler une dizaine de douilles par jour. La salive noire. Il était mon compagnon d’infortune. J’ai longtemps été en retard d’un point de vue social, ou d’intelligence émotionnelle, si on peut dire. J’en étais conscient, et j’ai abordé le lycée avec pour objectif de combler ce retard. C’était bancal, mais j’y suis parvenu. Mais quel ennui, quel terrible apprentissage de la paresse, de l’indifférence, voire pire. En terminale, je n’ai pas ouvert mon sac de cours une seule fois chez moi. En maths, T. me proposait de copier ses devoirs (sa mère le forçait à les faire) mais je préférais rendre des feuilles blanches et avoir de jolis zéros, des zéros honnêtes. Je ne voulais pas mentir, pas prétendre. Pas longtemps avant le bac, le prof d’histoire nous a jeté dehors, T. et moi, à cause d’un zéro à un devoir qui était, pour intégralité, du par cœur. Je me souviens des autres qui faisaient fonctionner la mémoire à court terme, dans le couloir, juste avant le devoir, et à quel point j’étais submergé par l’absurdité de cette "éducation". Pendant ces années-là, T. m’offrait une intéressante fenêtre sur un autre monde : celui des toxicos déscolarisés. C’était sympa, comme des safaris. C’est là que je voyais D., parfois. J’étais tout en bas de leur échelle sociale, mais je m’en foutais, ils me divertissaient. Vers le milieu de la terminale, j’ai jugé mon apprentissage social terminé, et j’ai arrêté de traîner avec les mecs cools. Je mangeais avec eux à midi, et ensuite j’allais m’asseoir à la bibliothèque pour lire. À la bibliothèque, il y avait R. R. s’asseyait et attendait la reprise des cours, sans rien faire, en souriant. R. voulait être militaire.
Pour me stimuler, quand des potes partaient en voyage avec leur famille, je leur demandais si je pouvais m’incruster. Comme ça, je me suis retrouvé à Venise avec T., pendant le carnaval. Sur la place Saint-Marc, des milliers de personnes dansaient, et j’avais la cape et le masque. Je me suis aussi égaré en Thaïlande avec S. Ce voyage, une horreur touristique. Pourquoi j’ai accepté de monter sur ce pauvre éléphant ? Et je ne sais comment, on s’est retrouvé avec S. dans le quartier chaud de Bangkok, je voyais les filles et les trans qui dansaient autour des barres, et, surtout, une horde de types nous poursuivaient en nous proposant les menus imprimés des divers établissements : les services sexuels, avec tarifs. La liste était longue.
Je crois que quelque part au début du lycée, j’ai eu un faible pour D., mais j’étais d’une indicible niaiserie (ça s’est arrangé par la suite). Je l’ai revue il y a quelques années à Bordeaux. Elle m’a aperçu dans la rue et m’a contacté via Facebook. Elle voulait s’excuser de s’être mal comportée envers moi pendant les années lycée. Je m’en souvenais à peine. Elle m’a raconté où en étaient T. et ses potes toxicos : encore plus enfoncés. Le beau gosse du groupe, némésis de la mère de T. à l’époque car corrupteur de son fils, a été défiguré dans un accident de voiture : il était défoncé au volant.
À 7h15, j’entends un peu de mouvement, alors je me lève pour écrire ce qui précède. Il fait froid, j’ai mon gros manteau pendant que j’écris. Une heure plus tard, M. est levé, clope pour petit-déjeuner. Je joue aux échecs avec lui. Il a fait 11 ans de club et il me bat deux fois, même si je lui oppose une résistance honorable, selon mes standards.
 |
La structure pour la sciure et la baraque
|
Avec N., on continue un autre projet : l’armature d’une énorme caisse qui servira à stocker la sciure de la scierie pour les toilettes sèches. Je cloue les tasseaux entre eux et je scie les extrémités. La matinée y passe. H. revient d’une balade avec des plantes ramassées qu’il replantera sur le terrain : la variété pour la variété, mais aussi pour leurs futures ruches.
Après le repas : perudo, jeu de dés proche du poker qu’ils pratiquent abondement. Puis ils me montrent le gros livre de notes et de croquis concernant l’ensemble du projet : j’y vois avec précision ce qu’ils prévoient pour leurs maisons. Retour à la caisse pour la sciure. L’armature est globalement terminée, alors on cloue des sacs poubelle qui feront office de bâche. J’aide M. à remplir de carburant le réservoir de la scierie, et je mets mon doigt sur une fuite de l’entonnoir. Ce n’est pas souvent que j’ai l’occasion de toucher de l’essence. S. continue les bases de la future douche et H. travaille à assécher un coin boueux. Je ramasse avec joie un œuf dans un des poulaillers. Les poules pondent très peu : elles viennent d’une région de France au climat plus clément. À moins qu’elles soient trop stressées par le chien qui leur court après. Il fait frais aujourd’hui, je finis l’après-midi en manteau. Je joue aux échecs avec N., qui est débutant. M., très compétitif, le pousse à la victoire, alors que je prends la défense du jeu pour le jeu.
9 mars
Je me réveille à 3h. Cette fois, je vais pisser, mais je ne me rendors pas. Je mets plusieurs heures à me rendre compte que c’est probablement à cause du froid. Je transfère mon manteau de sous moi à sur moi, et, un peu plus tard, j’arrive à arracher peut-être 30 minutes de sommeil. Ce matin, il fait 7°C dans la maison.
Je commence à donner un coup de main à S. et à N. pour la construction de la nouvelle douche, mais mon coup de main est parfaitement inutile, alors je retourne seul à la digue, manier pelle, pioche et brouette, ce qui me convient parfaitement. Ça me fait du bien d’être un peu seul. Je travaille tranquillement, à mon rythme, et je picore de la mâche en passant.
 |
L'eau chauffe pour la douche
|
À midi, je fais la vaisselle, à l’eau froide. Ensuite, je donne un coup de main à S., puis à M. à la scierie, et je vais creuser la digue seul. Je reviens en milieu d’après-midi, bien décidé à prendre ma première douche. Les autres me dissuadent de la prendre froide et N. allume le feu sous le bac que je remplis avec l’eau de la rivière. Ne voulant pas les déranger dans la construction de la nouvelle douche, juste à côté, je n’attends pas assez longtemps, et l’eau avec laquelle je remplis le bidon est terriblement tiède, c’est-à-dire franchement froide. Ma douche est donc très courte, mais je peux ensuite me laver agréablement les cheveux avec l’eau du bac qui a continué à chauffer pendant ce temps. Le reste de la journée est un peu paresseux, mais j’aide N. à construire le toit de la caisse pour la sciure. Je suis absolument affamé toute la journée, et je mange énormément : le froid combiné au travail physique extérieur.
H. fait des échanges de graines. Il utilise habituellement des emballages de sachets de thé pour les stocker, mais pour les échanges postaux, il essaie d’apprendre à faire de jolis pliages. Ce soir, il fait 10°C dans la maison, et ils allument le poêle au fioul. Cette fois, je dors avec une couverture.
 |
Le chantier de la digue
|
10 mars
Excellente nuit, pour changer. Je me lève à 8h, tout le monde est encore au lit et dehors, le terrain est blanc de givre. Grace au poêle, il fait 12°C dans la maison : grand luxe. Mais je reste en manteau.
Ils sont clairement dans une démarche de résilience face à un effondrement jugé inévitable. J’en ai surtout parlé avec S., qui voit la chose comme imminente et brutale, et avec M., qui est plus mesuré mais non moins convaincu. H. et N. me semblent moins poussés par cette perspective que par la fuite de ce qu’est l’existence contemporaine dans une société hyper-complexe et aliénante qui court aveuglément vers un avant fantasmé. Au contraire, ici, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur avenir ; ils façonnent la terre et le bois avec leurs mains ; ils assurent leur subsistance par un travail intemporel, celui de l’abri et de la récolte.
Ils ont eu une grande chance avec ce terrain : une rivière, deux étangs (avec des îles), des moines pour les gérer facilement, une source, des pins de plantation prêts à être coupés, un cercle d’arbre presque continu pour les isoler de l’extérieur, une ribambelle de châtaigniers, un village avec commerces de base, une gare à une heure à pied… Sans compter le charme de la région. Ils veulent vivre ici le reste de leur vie. Leur travail est on ne peut plus sensé.
 |
Les poules sont toujours dans nos pattes
|
Ce matin, essentiellement le début de l’empierrement du chemin qui longe les étangs depuis l’entrée, avec H. Les pierres sont vite épuisées, et les autres sont trop loin du "chantier" pour que ce soit rentable de les apporter, pour l’instant du moins. Je finis la matinée en prenant le temps de vraiment me poser près de la serre, au soleil, et je contemple le terrain. L’après-midi, je repars creuser la digue seul, mais le mal de dos causé par le déplacement d’une charge lourde la veille empire : soulever la pioche me fait mal. Alors je laisse tomber les outils et je vais ramasser des tiges de jonc avec lesquelles je fais une ficelle pendant que les autres finissent le cabanon de la douche. C’est la première fois que je double une ficelle de jonc sur une telle longueur, et le résultat est très satisfaisant. Par contre, en cette saison, le jonc est assez sec et peu odorant quand on le manipule.
 |
La vue depuis la serre
|
Je pense à mon séjour ici et au fait que, inévitablement, je ne peux pas vraiment partager le quotidien des autres, puisque leur quotidien est la construction de leur futur. Ainsi je peux pas connaître avec certitude la motivation qui anime l’ardeur de leur travail, je ne peux que la deviner. Inévitablement, je ne suis qu’un visiteur. Un visiteur qui a mal au dos.
Je pense à mes propres désirs qui sont perpétuellement fluctuants. Se lancer dans un projet pareil, c’est tracer à l’avance une part importante de toute son existence. Au contraire, je me suis souvent reposé sur l’éphémère. Si je me lançais dans telle ou telle chose, c’est parce que je savais que je pouvais en sortir. Si je suis resté si longtemps dans mon petit appartement, c’est parce que je savais que je pouvais à tout moment le quitter définitivement. Le thème récurrent dans mes rêves, c’est la fuite. Mais je ne sais pas vraiment si c’est toujours le cas : il y a bien des années que je ne me souviens plus de mes rêves. Mes rares certitudes sont des vents fiables rendus futiles par l’ouragan général. Je suppose que si je me complaisais dans l’éphémère, c’était parce que les options à long terme qui s’offraient à moi ne me convenaient pas, et parce que mes propres perspectives étaient trop limitées. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas encore ce que je voulais.
Les autres vont acheter de l’alcool et des bretzels. On boit de la bière en mangeant des bretzels. Le soir tombe et j’entends le va-et-vient de la scie pendant que j’écris. Puis c’est la bouteille de whisky qui est ouverte : elle ne fait pas long feu. M. me montre un clip de rap, et j’explose : oubliant tout tact, je lui dis que c’est de la "merde abyssale". S’ensuit une discussion animée sur le rap. Je ne suis toujours pas convaincu, mais au moins c’est sain d’en parler, et ça me tape moins sur les nerfs après avoir entendu M. expliquer ses goûts. Je présente mes excuses pour mon emportement. La soirée est d’ambiance plutôt festive, l’alcool est joyeux et réchauffe l’air.
11 mars
Malgré la pluie, N. part à la boulangerie en vélo, comme il le fait plusieurs fois par semaine. Je retiens le chien, pour qu’il ne suive pas le vélo. Les poules, tout juste libérées, mangent ses croquettes. J’essaie de les repousser, mais rien à faire : quand il y a de nourriture en jeu, elles ne sont plus du tout farouches. Jack les regarde en gémissant et tente quelques vaines contre-attaques. N. revient avec du pain et des chocolatines. Ce matin, je comprends enfin que mon mal de dos n’est pas un simple mal de dos : c’est une côte fêlée. Je reconnais les symptômes. Et en plus, il pleut. De toutes façons, il était temps que je songe à rentrer, et je me trouve un nouveau mélange train et covoiturage pour le lendemain.
Histoire de me rendre utile, et pour payer une partie de la nourriture, je pars avec S. faire les courses. Jack fait le voyage entre mes pieds. Finalement, je me retrouve à payer un litre de whisky, deux litres de vodka et les diluants : je ne crois pas avoir jamais acheté autant d’alcool, et encore moins d’alcool fort. Ils ont une relation très utilitariste avec l’alcool : le rapport quantité/prix. Je refais un peu de corde en jonc et j’explique à S. comment s’y prendre. Ils finalisent la nouvelle douche, mais tout le monde reste beaucoup à l’intérieur à cause de la pluie. Je lis avidement La Forêt-jardin de Martin Crawford. H. me donne des graines de persil et je bats M. et N. aux échecs. Pour le repas du soir, ils décident de commander des pizzas, chose qui semble un peu exotique ici. Mais en cadeau avec cinq pizzas achetées, une bouteille de vin : de l’alcool noble, j’en bois avec plaisir. Comme je suis totalement déconcentré par les pizzas, je perds une nouvelle partie d’échecs contre N. Puis c’est soirée poker, dans la salle complètement enfumée, en buvant du whisky : étonnant ! Je n’ai aucune expérience au poker et je me fais écraser, mais disons que c’est la faute des cartes. L’ambiance est différente de la veille. Les autres décident de se livrer à un rituel qui leur est habituel, comme le perudo : le visionnage d’un Cash Investigation. Cette fois, sur l’industrie du lait. Quitte à passer la soirée ensemble devant un écran (un écran de téléphone, ils n’ont pas plus gros), c’est une option tout à fait constructive, mais je n’ai pas envie d’entendre parler des horreurs de l’industrie pendant deux heures, alors je vais dans mon sac de couchage. De toutes façons, il y a bien longtemps que je n’achète quasiment aucun produit laitier.
 |
La nouvelle douche/toilette est presque terminée
|
12 mars
La matinée avant mon départ est encore une fois assez casanière. N. fait de la couture pour réparer un pantalon, et il me montre certains de ses vêtements sur lesquels il a brodé le logo de l'endroit. Un homme complet ! Moi, j’ai bien essayé la couture, mais la minutie de la chose me rend dingue. Ce qu’il reste de pizza fait office de brunch et H. ouvre la bouteille de vodka. M. m’accompagne en voiture à la gare, avec H., qui a l’intention de récolter diverses plantes près de la gare. Ils me laissent, et, seul sur le quai, je grignote de la mâche qui pousse là.
Alors, une conclusion en quelques mots ? Déjà, merci aux quatre autochtones d’avoir accepté quelqu’un qu’ils ne connaissaient absolument pas. Ensuite, oui, c’était hautement instructif et passionnant, autant sur le plan humain que sur les questions d’autonomie et de vie rurale en communauté. En dehors de toutes les qualités du terrain et de la vigueur de leur travail et de leurs ambitions, ils ont la chose la plus importante : ils sont bien ensemble, et unis par une vision commune. Je suis très curieux de voir comment le projet va progresser, et j’espère avoir l’occasion d’y remettre le nez, et les pieds. Quant à mes propres projets de ce genre, eh bien, s’ils sont toujours incertains, ils viennent de faire un grand bon en avant.