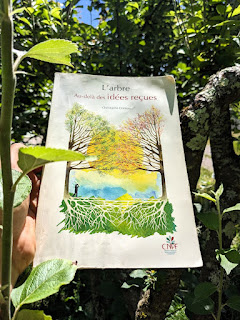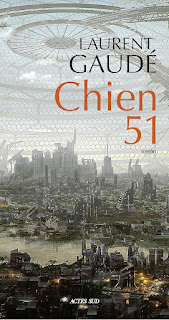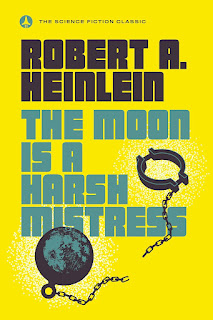Je crois que c'est la première fois que j'écris un second article à propos d'un un livre sur lequel j'ai déjà écrit ici (hors peut-être quelques nouvelles de Lovecraft). Radieux de Greg Egan est absolument billant. Je ne relis qu'avec une certaine gêne ce que j'ai pu écrire il y a 12 ans au sujet de ce recueil (j'avais 20 ans), mais en même temps, il est fascinant de constater à quel point ma perspective et ma capacité à l'exprimer ont pu évoluer.
Paille au vent (4/5)
On commence par du Greg Egan attendu : la quête d'une drogue qui permet de modifier l'identité. Ce thème particulier n'est pas forcément approfondi par rapport à d'autres nouvelles de l'auteur, mais il reste très plaisant à explorer, surtout quand il y autant d'idées tout autour : une société addict à toutes sortes de drogues chelous permises par la bio-ingénierie, une jungle génétiquement modifiée où se cachent barons de la drogues et généticiens utopistes, un tueur lui-même modifié pour survivre à cette jungle...
L'Eve mitochondriale (5/5)
Excellent ! Tout d'abord, une explication particulièrement claire des qualités particulière de l'ADN mitochondrial, présent dans les organites appelés mitochondries qui font l'essentiel de la production d'ATP dans les cellules animales :
L’ADN mitochondrial ne se présentait pas sous la forme de paires de chromosomes mais comme des boucles minuscules appelées plasmides. Il y en avait des centaines dans chaque cellule, tous identiques et venant exclusivement de l’ovule. Si on négligeait les mutations – une tous les quatre mille ans –, l’ADN mitochondrial d’un individu était exactement le même que celui de sa mère, de sa grand-mère maternelle, son arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Il était aussi semblable à celui de ses cousins issus de germains par sa mère, à celui de tous ses autres cousins par les femmes… jusqu’à ce que des mutations différentes affectant le plasmide au cours de sa transmission sur environ deux cents générations imposent enfin une certaine variation. Mais, avec seize mille paires de base d’ADN dans le plasmide, même les cinquante points de mutation depuis Ève elle-même ne représentaient pas grand-chose.
Un culte religieux se voue à l'Eve qui serait l'ancêtre commune de l'humanité, et notre narrateur, scientifique, se retrouve embarqué à travailler pour eux : à l'aide d'un tour de passe-passe quantique, il serait possible de créer un arbre généalogique parfaitement exact de l'humanité. Bien sûr, le message unificateur de ce culte ne peut fonctionner : arrivent les querelles de chapelle et la concurrence des cultes d'Adam.
« Alors
c’est ça, vous êtes l’un de ces putains de salopards de patriarches
matérialistes qui tentent de réifier l’Archétype de la Mère-Terre pour contenir
ses pouvoirs spirituels infinis ? »
Au final, la réalité est révélée et, bien entendu, tous les cultes se mettaient le doigt dans l'œil. La réalité est chaos, il n'y a aucuns sens à trouver, simplement des systèmes complexes à comprendre.
Radieux (5/5 avec félicitations du jury)
C'est de la très, très bonne SF. Ça commence fort narrativement, avec une captivante scène de vol de données cachées dans le corps des protagonistes, données défendues par une physiologie dangereusement modifiée. Ensuite, on passe aux idées, qui représentent le meilleur de ce Greg Egan peut faire quand il parvient à mélanger avec fluidité idées et narration. Il existe dans la réalité des maths différents qui ont coévolué avec les nôtres depuis la naissance de l'univers. Ces maths occupent une zone géographique précise dans le champ des propositions mathématiques possibles, zone dont la frontière est mouvante et déplaçable car c'est en réalisant les calculs qui bordent la frontière qu'on les fait tomber d'un côté ou l'autre de la frontière en fonction de l'attraction des propositions voisines. Or, il se trouve que ces maths sont à priori fort utiles pour certaines formes de vie, qui comptent bien défendre la partie de la réalité qui permet leur existence : s'ensuit un combat sur cette frontière mathématique avec un ennemi invisible.
On retrouve là un peu de Schild's Ladder, qui finalement est le même genre d'histoire mais dans le monde physique, ainsi qu'un peu de L'énigme de l'univers et La cité des permutants (mais en beaucoup mieux) dans le sens où c'est l'accomplissement d'un calcul, d'une déduction, qui contribue à façonner sa réalité.
Monsieur Volition (5/5)
Une nouvelle brillante sur le libre arbitre. Notre narrateur a l'intention de jouer au Raskolnikov (en l'occurrence tuer pour se prouver à lui-même son libre arbitre), mais avec un peu de technologie bonus : un gadget qui lui permet de visualiser les processus mentaux qui se déroulent dans son esprit ; les connections d'idées, de concepts, de neurones, qui font l'esprit. Au début, naïf, il s'imagine trouver son moi :
L’idée est vertigineuse… et
enivrante. Quelque part au plus profond de mon esprit, il doit y avoir
le « Moi » : l’origine de toute action, celui qui décide. Exempt
de toute influence culturelle, éducative ou génétique – la source de la
liberté humaine, totalement autonome, responsable devant lui-même, uniquement.
Mais, plus tard, il perçoit la réalité :
Il n’y a pas de cause première ici ; nul endroit où
les décisions peuvent naître. Rien qu’une grande machine composée de vannes
et de turbines, mue par le courant de causalité qui la traverse – une
machine construite à partir de mots, d’images, d’idées faites chair.
J'admire la façon dont Greg Egan parvient à évoquer et utiliser ces concepts sous forme narrative. « Il n’y a pas de cause première » : j'ai moi-même écrit ces mots récemment.
Cocon (4/5)
Une société de biotech fabrique un filtre à substances chimiques pour préserver les embryons de diverses maladies. Leur centre de recherche explose, et l'enquêteur s'avère être homosexuel : on connait les ficelles de la narration, et on comprend instantanément que ce n'est pas un hasard, et que ce filtre va filtrer certaines prédispositions innées en plus des maladies. Si le procédé n'est pas très subtil, la nouvelle reste une excellente variation sur le thème de l'homosexualité (on sait que les diverses questions de genre et d'orientation sexuelle sont un classique de Greg Egan). C'est accompli d'une façon hautement pertinente et aucunement moralisante. Le narrateur, l'enquêteur homosexuel, est d'ailleurs lui-même exaspéré par l'idée qu'il y aurait une identité liée à l'orientation sexuelle, il n'aspire au fond qu'à l'indifférence ; il veut qu'on s'en foute, de l'orientation sexuelle (de la même façon que le meilleur moyen d'esquiver le racisme serait de ne pas s'occuper d'ethnicité). Le rêve universaliste, en somme. Son compagnon ne partage pas son avis, et la nouvelle est pour le narrateur l'occasion de découvrir que le monde est encore loin de l'indifférence : tout fragment d'identité, tout comportement, toute liberté, comme inévitable sujet d'un combat permanent entre forces culturelles antagonistes. Le champ de bataille de la mémétique. Épuisant.
Rêve de transition (3/5)
De l'habituel pour Greg Egan : la numérisation de l'esprit humain. Ici, les cités virtuelles sont passées de mode, et les gens préfèrent se faire réincarner dans des corps artificiels. Il est question spécifiquement des rêves de transition éponymes : il s'agit des moments de conscience qui naissent du processus de copie de l'esprit. Pour copier, ou transférer, la conscience, il est nécessaire de manipuler des fractions importantes du cerveau simulé ; fractions qui, de fait même de leur existence (transitoire), fonctionnent et produisent de la conscience. Idée passionnante, mais cette fois la narration ne parvient pas à lui faire honneur ; il est compliqué de rendre intéressant narrativement le rêve.
Vif argent (4/5)
Cette nouvelle est clairement une longue complainte de l'auteur face à l'irrationalité humaine générale. Le vif argent est une maladie pas si fréquente, mais contagieuse et mortelle. Notre narratrice est à la poursuite d'un vecteur de transmission, et elle est déprimée par les superstitions consternantes qui envahissent les esprits à propos de la maladie, jusqu'à la révélation prévisible que le vif argent est répandu volontairement, pour une raison mystique à la con. Egan n'est ici pas très subtil dans son propos, mais je lui accorde sans regret cette lamentation... que je partage. Sur ce, je retourne essayer de ne pas devenir trop misanthrope en voyant les gens autour de moi se complaire dans les superstitions et pseudo-sciences les plus exaspérantes.
Des raisons d'être heureux (5/5 avec félicitations du jury)
Celle-là, elle m'avait marqué. Je l'avait même relue une fois depuis ma première lecture il y a 12 ans. C'est en somme une superbe évocation du déterminisme biologique : un individu dont la personnalité, les émotions, le comportement, etc., sont complètement bouleversés par le chaos cellulaire qui se déchaine dans sa tête. D'abord, suite à une tumeur, son cerveau libère en surabondance une hormone qui le rend perpétuellement heureux ; puis, suite à un traitement raté qui cause une nécrose neuronale, il perd tous les récepteurs de cette hormone et passe 18 ans dans une quasi catatonie ; et enfin, suite à un traitement mieux réussi, il obtient la capacité de décider de son attraction ou de sa répulsion pour chaque stimulation.
Il me semble que pour avoir une vision crédible de soi et des comportements humain, il est indispensable d'embrasser un pur matérialisme, de considérer la machinerie humaine comme ce qu'elle est : une machinerie. Ce n'est pas que nous sommes à la merci de ce déterminisme, c'est que nous sommes ce déterminisme : le narrateur est le résultat des errements de son cerveau. En même temps, quelque part, il y a la capacité de faire des choix (à ne pas confondre avec l'idéal impossible du libre arbitre) qui est illustrée d'une façon radicale dans la troisième partie de la nouvelle. D'un côté, ça fait penser à la doctrine stoïcienne : tu n'es pas tes émotions, tes émotions sont un signal, ta volonté les contemple et règne ; mais c'est une philosophie pratique. Dans la nouvelle, si la situation du narrateur est bien sûr préférable dans la troisième partie, il n'a pas plus de libre arbitre que dans les précédentes : chaque choix de sa part, quand il décide de son appréciation pour les choses, est soit purement pratique, soit un jet de dé. Il n'y a nul échappatoire au fait que ce que nous sommes n'est qu'un assemblage d'une infinité de liens causaux qui remontent à l'origine de l'univers — bien qu'une voix intérieure nous hurle des mensonges.
Notre-Dame de Tchernobyl (3/5)
Une nouvelle pas ratée, juste étonnamment banale par rapport au reste. C'est une simple enquête policière, avec quelques gadgets high-tech. Il y a bien vers la fin l'évocation d'une religion bizarre et de ses superstitions , mais rien d'étoffé.
La plongée de Planck (4,5/5)
C'est la nouvelle superbement illustrée en couverture par Manchu, et c'est aussi la dernière du recueil, pour une bonne raison : c'est de la hard SF très hard. Les premières pages sont un barrage de physique difficile à franchir. Il n'y a 12 ans, je n'y avais rien compris, et je crois qu'aujourd'hui... je comprends mieux. Pas parfaitement, loin de là, mais la profonde esthétique de cette odyssée physique ne me passe plus complètement au-dessus de la tête. Je dois avouer que c'est satisfaisant. Mais je ne suis pas assez naïf pour croire que dans 12 ans ça me semblera limpide.
En plus de l'odyssée physique, il y a un petit arc narratif plus accessible : nos protagonistes sont des humains dématérialisés, comme dans d'autres romans de Greg Egan, et les membres de notre équipe d'aventuriers de la physique sont visités par deux citoyens d'une polis fondée sur la nostalgie de l'humanité charnelle et ses arts narratifs idéalisés. Bien que Greg Egan ait évidemment son parti, l'opposition entre les deux visions est pertinente : face aux froids physiciens, la perspective du pseudo-Homère, qui réécrit la réalité selon ce qui lui semble le plus percutant narrativement, n'est pas si folle. J'y vois presque Egan opposant sa littérature exigeante et impitoyable à d'autres types de romanesque... Ainsi, à propos des « récits archétypaux » :
C’est le
produit de quelques attracteurs aléatoires de la neurophysiologie organique. À
chaque fois qu’une histoire plus complexe ou plus subtile était disséminée par
transmission orale, elle finissait par dégénérer en un récit archétypal. Une
fois l’écriture inventée, de telles narrations n’ont plus été créées
délibérément que par des organiques qui n’avaient pas compris de quoi il
s’agissait. Si les plus belles statues de l’antiquité avaient été lâchées sur
un glacier, elles seraient à présent réduites à un spectre prévisible de
cailloux sphéroïdaux, ce qui ne fait pas pour autant desdits cailloux le
pinacle de la forme artistique.