Un bouquin bien sympa, organisé en une centaine de fausses affirmations que l'auteur s'empresse de corriger. A moins d'être déjà un professionnel aguerri de l'arbre, nul doute qu'il y a bien des choses à apprendre. Ci-dessous, quelques notes en vrac.
La greffe naturelle entre racines serait assez fréquente, et point frappant : on peut observer certaines souches de résineux coupés qui continent à pousser, nourries par les racines de leurs congénères, formant ainsi une sorte de bourrelet, le cambium poussant autour d'un tronc ligneux qui n'est plus là.
La plus grande partie de la masse d'un arbre est techniquement de la matière morte, y compris l'aubier. Sont "vivants" le cambium, le parenchyme (tissus stockant de réserves), des cellules voisines des éléments conducteurs de la sève descendante (les cellules compagnes du phloème), les feuilles et les extrémités en croissance des tiges et racines. De plus, les cellules vivantes sont bien plus légères que celles devenues ligneuses. Mais les cellules "mortes" jouent néanmoins des rôles cruciaux : transport des sèves brutes et élaborées, soutien mécanique de l'édifice et protection contre les agressions climatiques ou biotiques.
On connait le rôle important que les champignons jouent pour les arbres, avec la mycorhize notamment, mais la quantité de champignons est encore une fois supérieure à ce qu'on pourrait croire : au niveau des feuilles (la phyllosphère), un arbre peut accueillir des centaines d'espèces fongiques. Elles peuvent même vivre dans les feuilles. La plupart ne seraient pas pathogènes, et beaucoup joueraient un rôle positif sous forme de mutualisme (entraide), par exemple en limitant les attaques d'insectes avec certaines substances. Rappelons que dans la mycorhize (myco = champignon, rhize = racine), l'arbre donne des sucres synthétisés par photosynthèse en échange d'eau et de nutriments recueillis par le champignon. D'ailleurs, tous les arbres auraient des mycorhizes. Les seules plantes qui y échapperaient seraient les plantes aquatiques, qui n'ont aucune difficulté à absorber directement l'eau et les éléments nutritifs dissous car elles n'ont pas de cuticules cireuse qui empêche les pertes d'eau par évaporation chez les plantes terrestres. Quelques autres espèces n'ont pas de mycorhizes, parce qu'elles ont été sélectionnées par l'humain (le blé) ou parce qu'elles sont pionnières (giroflée, chénopodes, renouée, sarasin). Il y a aussi les champignons saprotrophes, qui se nourrissent de la matière organique morte et minéralisent la matière organique, la rendant ainsi de nouveau disponible pour les arbres.
Les gourmands sont plutôt appelés suppléants : comme ce nom l'indique, ils servent de réserve de branches prêtes à prendre le relai, par exemple en cas de descente de cime ou de branche cassée. La sénescence d'un arbre va avec l'incapacité à produire des suppléants vigoureux.
Le duramen n'est pas la cause du vieillissement du bois, au contraire, il nécessite une intense activité métabolique (obturation des vaisseaux, synthèse d'extractibles comme tanins, gommes et cires, réacheminement des substances nutritives vers l'aubier). L'arbre dépense plus d'énergie pour la transformation de l'aubier en duramen que pour son maintien. La mort du bois n'est pas la cause de la création du duramen, mais sa conséquence. Le duramen sert en fait moins au support de l'arbre que l'aubier, car c'est en périphérie du tronc, donc au niveau de l'aubier, que les forces de tension et de compression sont les plus fortes. Le duramen a un rôle de défense contre les pathogènes, vu qu'il est bien moins riche en substances nutritives. Plus un arbre augmente en volume, plus il dépense une quantité croissante d'énergie pour le maintient des cellules vivantes, notamment celles de l'aubier. Il doit donc accroitre sa surface foliaire pour produire de l'énergie, mais, problème : un gros édifice présente bien plus de volume par rapport à sa surface qu'un petit édifice de même forme (même problème qu'avec le refroidissement des gros animaux). Le duramen sert donc à adapter la quantité d'aubier à la surface foliaire disponible. A terme, si le duramen est exposé aux éléments, il peut se dégrader sans tuer l'arbre, et l'arbre peut même faire des racines dans la matière organique à présent disponible qui était son duramen.
La chute des feuilles n'est pas directement induite par le froid, puisque même les arbres tropicaux perdent leur feuilles (d'ailleurs d'une façon non saisonnière : certaines parties d'un arbres peuvent êtres défeuillées à un moment et d'autres non). La caducité du feuillage est, dans les régions à saisons, essentiellement déterminée par le raccourcissement des jours.
C'est la taille des vaisseaux de circulation de la sève qui détermine en bonne partie la résistance d'un arbre au gel : plus les vaisseaux sont grands, plus les bulles d'air pigées dans la glace pendant l'hiver sont grosses et entravent la circulation. Ainsi les résineux ont des taux d'embolie quasi nuls à cause de leurs vaisseaux très fins, ce qui explique leur tolérance au gel.
Au printemps, avant la poussée des feuilles :
- La poussée racinaire : elle correspond à une eau en surpression au niveau des racines. Les racines développent des millions de minuscules poils qui absorbent l'eau du sol. Cette entrée d'eau, alors que toute sortie est impossible faute de transpiration foliaire, crée une surpression qui chasse les bulles d'air dans l'aubier. C'est la montée de sève.
- La production précoce de vaisseaux : quand les vaisseaux on un trop grand diamètre (essences à bois à zones poreuses comme les chênes) la poussée racinaire est insuffisante pour résorber l'embolie hivernale. Les arbres fabriquent de nouveaux vaisseaux pour contourner les bulles d'air.
Et le cycle hivernal :
- Préparation à la dormance : à la fin de l'été, l'arbre produit des feuilles atrophiées, courtes, épaisses et dépourvues de pétiole. Ce sont les écailles qui protègent le bourgeon pendant l'hiver. Sous les écailles, les cellules se divisent intensément pour produire une partie de la pousse de la saison suivante.
- Entrée en dormance : déclenchée surtout par la diminution de la durée du jour. Les cellules ne se divisent plus et les inhibiteurs de croissance s'accumulent dans les bourgeons. Les feuilles des espèces caduc tombent.
- Endurcissement : quand les températures baissent, l'amidon stocké en en fin d'été est en partie hydrolysé pour dans libérer le cellules des sucres solubles qui un pouvoir antigel. Cette étape ne fonctionne qu'en cas de baisse progressive de la température.
- Levée de la dormance : la quantité de froid accumulé pendant l'hiver lève progressivement la dormance.
- Reprise de la croissance : fin de la dormance, mais début de la quiescence, qu'on pourrait qualifier d'attente attentive, là où la dormance serait un sommeil. Puis, plus les conditions deviennent favorables, plus les pousses préformées l'année précédente s'allongent et provoquent l'ouverture des bourgeons. Les divisions cellulaires reprennent.
Rappelons aussi que la matière constituant les arbres provient essentiellement de l'atmosphère. Le sol fournit 13 des 16 éléments indispensables aux arbres sous forme d'ions minéraux. Seuls le carbone, l'hydrogène et l'oxygène proviennent de l'air et de l'eau, mais dans un arbre adulte, le carbone constitue l'essentiel, et on ne trouve que quelques kilos de minéraux en tout.
Les jeunes rameaux sans feuilles ont de la chlorophylle sous l'écorce et sont capables de photosynthèse pendant 1 à 5 ans, et à degré non négligeable par rapport aux feuilles. Ils perdent cette capacité plus l'écorce s'épaissit.
Hop, concluons sur un petit schéma qui évoque les trois outils utilisés par l'arbre pour l'ascension de la sève :

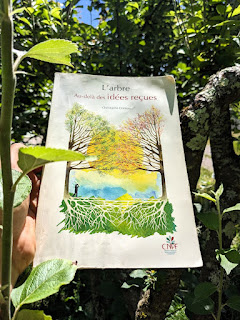

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire