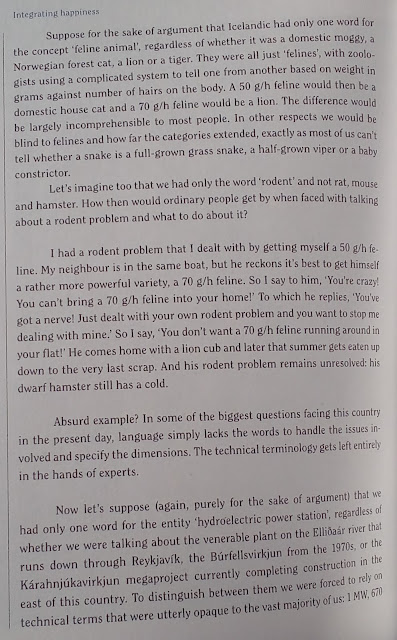vendredi 30 mars 2018
Génocides - Thomas Disch
L'humanité est gentiment éradiquée par des envahisseurs venus d'outre-espace. Un pitch on ne peut plus classique qui est traité d'une façon originale et réussie. Les envahisseurs, ils restent dans l'ombre. On ne sait strictement rien d'eux, si ce n'est que la Terre est apparemment un très bon terrain pour cultiver... la Plante. La Plante est un végétal qui prend la forme d'un arbre gigantesque. Extrêmement invasif, il se répand partout, extrêmement rapidement, et résiste à la plupart des assauts humains. Après sept ans de culture et une élimination systématique des formes de vies locales par des drones, les aliens inconnus sont prêts pour leur première récolte.
Au milieu de ce monde qui tourne mal, une petite communauté paysanne tente tant bien que mal de survivre. Pour la plupart, ils sont superstitieux et pas très futés. Leur nombre baisse à vue d’œil. Génocides est le récit de leurs tentatives de survie. Comme toujours, l'homme devient un loup pour l'homme. On retrouve beaucoup de scènes classiques du genre, mais Thomas Disch parvient à imposer sa patte grâce à son ton qui n'est pas à proprement parler humoristique, mais qui a sans conteste le don de provoquer des sourires grinçants. Je pense notamment à cette scène de cannibalisme. Pas du cannibalisme barbare, oh, non, du cannibalisme très civilisé, autour d'une table. La chair humaine est mélangée à de la chair de porc pour former de charmantes petites saucisses. Et il est de bon ton de complimenter la cuisinière.
Plus tard dans le récit, les survivants plongent dans le gigantesque réseau des racines des Plantes et se nourrissent de sa pulpe. Pendant des mois. Comme des vers. C'est sans doute la vision la plus marquante du roman : les résidus de l'humanité transformés en une sorte de parasite qui grignote les récoltes de l'intérieur. Des larves qui rongent l'intérieur d'un fruit bien plus grand qu'eux. Et la Terre qui n'est rien d'autre qu'une plantation comme il doit y en avoir bien d'autres dans l'univers. Un roman apocalyptique qui parvient à sortir du lot.
1965, omnibus
jeudi 29 mars 2018
Terre brulée - John Chistopher
Le titre anglais de ce roman est plus parlant : The death of grass. En effet, un virus se met à détruire toutes les graminées du monde, c'est à dire toute l'herbe et toutes les céréales. Heureusement, il reste les pommes de terre, mais on devine que l'humanité n'est pas prête pour tel changement. La chute commence en Asie, et les européens regardent de haut ces pays déjà barbares s'écrouler. Puis la glorieuse Angleterre est frappée.
Le roman commence de façon un peu bavarde en présentant ses personnages avec une masse de dialogues pas toujours très intéressants. Mais quand ça commence, ça commence vraiment. Terre brulée est d'une rare brutalité. Un petit groupe se forme, et les voilà fuyant Londres pour aller se réfugier dans une ferme isolée par des montagnes infranchissables à l'autre bout de l'Angleterre. Les personnages principaux comprennent avec une rapidité troublante que pour survivre dans la nouvelle réalité qui se présente à eux, il faut tuer ou être tuer. Le gouvernement aussi l'a compris : il tente d'atomiser les principales villes du pays pour avoir moins de bouches inutiles à nourrir. A travers ce qui se présente comme un road novel, John Christopher démolit avec brio le vernis civilisationnel. Pour défendre leur tribu, des citoyens comme les autres se transforment en tueurs de sang-froid, non pas du jour au lendemain, mais d'une heure à la suivante. Il faut tuer par prévention. Tuer pour avoir un endroit où passer la nuit. Tuer pour un peu à manger. Abandonner les faibles à leur sort. Tolérer voire récompenser les forts malgré leur éthique discutable parce qu'ils sont un atout crucial pour la tribu. Et cette descente vers la brutalité pragmatique culmine dans un final qui achève de briser les anciens codes.
Ce qui marque dans le roman de John Chistopher, c'est qu'il n'hésite pas à pousser ses personnages à agir en tueurs. Dans d'autres romans du genre, ce pourrait être les autres qui agiraient ainsi, les antagonistes, qui tueraient de sang-froid, pendant les héros lutteraient contre cette violence. Mais ici, ceux qui se laissent aller à la pitié se font impitoyablement écraser. Alors les survivants sont ceux qui laissent l'ancienne morale derrière eux. Avec comme espoir à long terme, comme excuse à leurs agissements, de pouvoir reconstruire un havre de paix. Un classique à placer à côté de The day of the Triffids, dont il n'a pas l'élégance mais qu'il surpasse en férocité.
En un sens, j'ai le sentiment que ce serait plus juste que le virus gagne. Depuis des années maintenant, nous traitons la terre comme si elle était une gigantesque tirelire à dévaliser jusqu'au dernier sou. Alors que la terre, après tout, est la vie elle-même.
1956, omnibus
Libellés :
Christopher John,
Littérature,
Science fiction
mardi 27 mars 2018
La fin du rêve - Philip Wylie
La fin du rêve ressemble à un best of de scénarios apocalyptiques. En 2030 environ, l'humanité se remet péniblement des décennies catastrophiques qui viennent de prendre fin. Les quelques survivants s'organisent et décident de rédiger une sorte de manuel d'histoire plein d'exemples à ne pas suivre pour les générations suivantes. Ce manuel, c'est le roman. En gros, on passe d'un apocalypse à un autre. Et Philip Wylie se laisse aller : l'échelle des désastres va parfois jusqu'au ridicule. Notamment ces pets toxiques, causés par une alimentation riche en addictifs artificiels, qui font littéralement exploser les gens. Ou cette rivière tellement surchargée de produits chimiques en tous genres qu'elle finit par exploser avec la puissance d'une bombe atomique. Ou cette invasion de vers carnivores venus des fonds marins qui prolifèrent parce que l’humanité, en polluant les océans, a tué tous leurs prédateurs naturels.
Si tout cela est souvent un peu gros, Philip Wylie parvient pourtant à rester efficace et pertinent. Efficace, parce que ces désastres sont bien trouvés, bien mis en scène, et se renouvèlent jusqu'au bout. Pertinent, parce que derrière ces facilités de l'écrivain qui a envie de décrire des scènes puissantes jusqu'au ridicule se cache un vrai discours engagé. Un discours pas très subtil, certes, mais toujours autant d'actualité, qui peut se résumer ainsi : pour la majorité de l'humanité, les profits immédiats font oublier toutes les conséquences futures potentiellement désastreuses. Le profit à court terme prend le pas sur la survie à long terme de l'espèce.
Philip Wylie se laisse aussi aller pendant un passage hors-sujet et d'assez mauvais goût sur, je crois, la décadence sexuelle de l'époque. Mais dans l'ensemble, cette vision de l'avenir et des cataclysmes environnementaux qui l'accompagnent est marquante. L'une des meilleurs scènes est un désastre atmosphérique à New York. Les autorités savent parfaitement bien que le danger est là, mais il ne faudrait quand même pas empêcher les citoyens de consommer dans cette période pré-noël, non ? Si on demande aux gens de ne pas venir à Manhattan, de ne pas utiliser leurs voitures pendant un moment, ce ne serait pas bon pour l'économie. Alors tant pis, advienne que pourra. Et le désastre frappe, encore une fois à une échelle un peu invraisemblable (bien que plaisante pour le lecteur), mais l'idée reste parfaitement juste : la soumission totale à la croissance économique et la pensée à court terme ne sont pas sans prix à payer.
En 1970, moins de deux Américains sur mille étaient capables de définir la "science". Elle n'est, bien sûr, que la connaissance, la pure connaissance, avec ses enseignements et les moyens d'ajouter à sa somme. Mais en cette période, presque tout le monde, et nombre de scientifique même, considéraient que la "science" étaient le résultat matériel des applications de la connaissance. Et tous ces hommes étaient formés à des fins particulières qui n'avaient que peu — ou pas — de rapport avec tout le reste de la science (ou connaissance) où on aurait découvert — ou pu découvrir — des renseignements sur les terribles conséquences dont risquaient de s'accompagner l'unique fin visée.
1972, omnibus
vendredi 23 mars 2018
De la nature - Lucrèce
Lucrèce, il y a plus de 2000 ans, entreprend la lourde tâche de mettre en langue latine la philosophie d’Épicure. J'ai lu son long poème dans une traduction en prose plutôt qu'en vers pour privilégier la fluidité de lecture. Lucrèce, pour développer sa vision d'un monde sans dieux, décrit longuement le fonctionnement de tous les phénomènes naturels possibles. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la naissance de la vie à la destruction de toutes choses, l'ambition du poète est admirable. Parfois, on sourit devant des explications qui nous semblent aujourd’hui naïves et invraisemblables, et on est de temps en temps lassé de lire ce qui ressemble à une longue énumération, mais la force de la plume de Lucrèce est toujours là : c'est un plaisir que d'accompagner le poète-philosophe dans sa quête de savoir et de connaissance. Jamais il ne cède à l'obscurantisme et à la superstition. Même quand il se plante magistralement, on apprécie la tentative de compréhension du monde. J'y retrouve le même plaisir que je retire d'une partie de la philosophie antique : il y a quelque-chose de particulièrement touchant dans ces textes anciens écrits par des sages qui courent après la vérité, qui cherchent comment vivre bien. Ils donnent envie d'aimer l'humanité.
Ci-dessous, quelques passages sélectionnés.
Pour la terre, elle n'a jamais été qu'une matière privée de sentiments ; mais, comme elle possède une multitude d’éléments des choses, elle produit de mille manières une multitude de corps à la lumière du soleil. Néanmoins, si l'on veut appeler la mer Neptune, et les moissons Cérès, si l'on se plaît à employer abusivement le nom de Bacchus au lieu du terme propre qui désigne le vin, on est maître aussi de donner à la terre le titre de Mère des dieux, pourvu qu'en réalité on préserve son esprit de la souillure honteuse de la superstition.Ne va pas croire pourtant que tous les atomes puissent se combiner de toutes les façons : car alors on verrait communément des monstres dans la nature ; des êtres mi-hommes mi-bêtes viendraient au monde, de hautes branches s'élanceraient du corps d'un animal vivant, des membres d'animaux terrestres s'uniraient à des parties d'animaux marins et des chimères soufflant la flamme par leur gueules seraient nourries par la nature sur la terre, mère de toutes les choses. Aucun de ces prodiges n'apparaît ; c'est que tous les corps proviennent de semences définies, ont une mère déterminée et croissent avec la faculté de conserver chacun son espèce.Tout d'abord, nulle part, en aucun sens, à droite ni à gauche, en haut ni en bas, l'univers n'a de limite ; je te l'ai montré, l'évidence le crie, cela ressort clairement de la nature même du vide. Si donc de toutes parts s'étend un libre espace sans limites, si des germes innombrables multipliés à l'infini voltigent de milles façons et de toute éternité, est-il possible de croire que notre globe et notre firmament aient été seuls créés et qu'au-delà il n'y ait qu'oisiveté pour la multitude des atomes ? Songe bien surtout que ce monde est l'ouvrage de la nature, que d'eux-mêmes, spontanément, par le seul hasard des rencontres, les atomes, après mille mouvements désordonnés et tant de jonctions inutiles, ont enfin réussi à former les unions qui, aussitôt accomplies, devraient engendrer ces merveilles : la terre, la mer, le ciel et les espèces vivantes. Il te faut donc convenir, je te le redis, qu'il s'est formé ailleurs d'autres agrégats de matière semblables à ceux de notre monde, que tient embrassé l'étreinte jalouse de l'éther.Toutes les fois d'ailleurs qu'une abondante matière se tient prête, qu'un espace l'attend et que rien ne fait obstacle, il est évidemment fatal que les choses prennent forme et s'accomplissent. Et si par surcroît les germes sont en telle quantité que tout le temps de l'existence des êtres ne suffirait à les compter ; si la même force subsiste et la même nature pour les rassembler en tous lieux et dans le même ordre que les atomes de notre monde, il faut admettre que les autres régions de l'espace connaissent aussi leur globe, leurs races d'homme et leurs espèces sauvages.Tous les corps, en effet, que tu vois grandir heureusement et s'élever peu à peu à l'état d'adultes, acquièrent plus qu'ils ne dissipent ; la nourriture aisément circule dans toutes les veines et les tissus ne sont pas assez lâches et distendus pour perdre beaucoup de substance et laisser la dépense l'emporter sur l'acquis. Nos corps font des pertes importantes, il faut en convenir, mais le compte des acquisitions domine jusqu'au jour où le faîte de la croissance est atteint. Dès lors, insensiblement les forces diminuent, la vigueur de l'adolescence est brisée et l'âge glisse vers la décrépitude. Plus est vaste en effet un corps qui ne cesse de croître, plus sa surface est large, et plus nombreux sont les éléments qu'il répand de toutes parts et qui s'échappe de sa substance. Les aliments ne se répandent plus aisément dans toutes les veines et ne suffisent pas pour réparer les flots de matière qui s'échappent sans cesse et pour fournir la substance de remplacement. Il est donc fatale que les corps périssent, étant moins denses à cause de leur pertes incessantes et plus faibles contre les chocs qui surviennent. Car la nourriture finit par manquer au grand âge, et dans on état d'affaissement l'être résiste mal aux chocs répétés du dehors, sa résistance est vaincue par leur acharnement.L'éducation peut former certains hommes et les polir uniformément ; le caractère de chacun n'en garde pas moins son empreinte première. Nos défauts, croyons-le, ne peuvent être si bien extirpés, que l'un ne reste toujours sur la pente qui fait glisser à la colère, que l'autre ne se tourmente trop vite de crainte, qu'un troisième n'ait trop de facilité à s’accommoder des choses. En bien d'autres points, des différences distinguent fatalement les divers tempéraments, avec les mœurs qu'ils engendrent ; je ne puis en exposer maintenant les raisons secrètes, ni trouver des noms pour tant d'éléments et de figures, principes de cette diversité. Il est une évidence que je puis cependant proclamer, c'est que les traces du naturel premier, que la raison est incapable d’effacer, s'atténuent cependant au point que rien ne peut nous empêcher de mener une vie digne des dieux.Si l'âme est immortelle et qu'au moment de la naissance elle se glisse dans le corps, pourquoi notre vie antérieure ne nous laisse-t-elle aucun souvenir ? Pourquoi ne conservons-nous aucune trace de nos anciennes actions ? Et si l'âme a subi de telles altérations que tout souvenir du passé en soit perdu, un tel état n'est pas, je pense, bien éloigné de la mort. Allons ! L'âme d'autrefois est morte et celle d'aujourd'hui a été crée aujourd'hui.Toujours en effet la vieillesse dans le monde doit céder au jeune âge qui l’expulse ; les choses se renouvellent aux dépens les unes des autres, suivent un ordre fatal. Nul n'est précipité dans le noir gouffre du Tartare ; mais il est besoin de matière pour la croissance des générations nouvelles, lesquelles à leur tour, leurs vies achevées, iront te rejoindre ; toutes celles qui t’ont précédé ont déjà disparu, toutes après toi passeront. Ainsi jamais les êtres ne cesseront de s'engendrer les uns les autres ; la vie n'est propriété de personne, tous n'en sont que l'usufruit.Regarde maintenant en arrière, tu vois quel néant est pour nous cette période de l'éternité qui a précédé notre naissance. C'est un miroir où la nature nous présente l'image de ce qui suivra notre mort. Qu'y apparaît-il d'horrible, quel sujet de deuil ? Ne s'agit-il pas d'un état plus paisible que le sommeil le plus profond ?Et toi, tu hésiteras, tu t'indigneras de mourir ? Tu as beau vivre et jouir de la vue, ta vie n'est qu'une mort, toi qui en gaspille la plus grande part dans le sommeil et dors tout éveillé, toi que hantent les songes, toi qui subis le tourment de mille maux sans parvenir jamais à en démêler la cause, et qui flotte et titube, dans l'ivresse des erreurs qui t'égarent.Mais pourquoi donc vouloir plus longue vie ? Qu'en serait-il retranché du temps qui appartient à la mort ? Nous ne pourrions rien distraire qui diminuât la durée de notre néant. Ainsi tu auras beau vivre assez pour enterrer autant de générations qu'il te plairait : la mort toujours t'attendra, la mort éternelle, et le néant sera égal pour celui qui a fini de vivre aujourd'hui ou pour celui qui est mort il y a des mois ou des années.Puisque la masse terrestre, l'eau, les souffles légers des vents et les brûlantes vapeurs du feu, dont se composent l'ensemble des choses, puisque tous ces corps connaissent la nécessité de naître et de mourir, pensons qu'il en est de même pour le monde entier. Car les êtres dont nous voyons les membres formés d'une substance née et d'un corps mortel, et êtres-là apparaissent contraints à naître et à mourir. C'est pourquoi, voyant les vastes membres, les parties gigantesques du monde se consumer et ensuite renaître, je conclus que pour le ciel et la terre pareillement il y a eu un premier instant et il y aura une ruine fatale.C'est que le bien que nous avons sous la main, tant que nous n'en connaissons pas de plus doux, nous l'aimons entre tous, il est roi ; mais une nouvelle et meilleure découverte détrône les anciennes et renverse nos sentiments. Ainsi l'homme méprisa le gland, de même il renonça aux couches d'herbes garnies de feuillages. Les vêtements faits de peau de bête un jour n'eurent plus de valeur : et pourtant leur découverte avait excité tant d'envie qu'un guet-apens mortel avait attiré, j'en suis sur, le premier qui les porta ; et cette dépouille disputée entre les meurtriers, toute sanglante, ft déchirée, et aucun d'eux ne put en jouir.Alors, c'étaient les peaux de bête, aujourd'hui, c'est l'or et la pourpre qui préoccupent les hommes et les fait se battre entre eux : ah ! C'est bien sur nous, je le pense, que retombe la faute. Car le froid torturait ces hommes nus, ces enfants de la terre, quand les peaux leur manquaient : mais pour nous, quelle souffrance est-ce donc de n'avoir pas un vêtement de pourpre et d'or rehaussé de riches broderies ? Une étoffe plébéienne ne suffit-elle pas à nous protéger ? Ainsi donc le genre humain se donne de la peine sans profit et toujours consume ses jours en vains soucis. Faut-il s'en étonner ? Il ne connaît pas la borne légitime du désir, il ne sait les limites où s’arrête le véritable plaisir.Pareils aux enfants qui tremblent et s’effraient de tout dans les ténèbres aveugles, c'est en pleine lumière que nous-mêmes, parfois, nous craignons des périls aussi peu redoutables que ceux dont s'épouvantent les enfants dans les ténèbres et qu'ils imaginent tout près d'eux. Ces terreurs, ces ténèbres de l'esprit, il faut donc pour les dissiper, non les rayons du soleils ni les traits lumineux du jour, mais l'étude rationnelle de la nature.
samedi 17 mars 2018
Dreamland: A Self-Help Manual for a Frightened Nation - Andri Snær Magnason
Un livre ramené de mon dernier voyage en Islande, il y a déjà pas mal d'années. En couverture, la fameuse Route 1, la route qui fait le tour de cette île de 300 000 habitants. L'Islande, un petit pays où sont possibles des choses surprenantes à nos yeux de continentaux. Par exemple, l'actuel président est un universitaire, un historien, et il a même traduit des romans de Stephen King en islandais ! Et le personnage arrivé en troisième place des élections de 2016 est Andri Snær Magnason, l'auteur de ce livre.
Andri Snær Magnason s'attaque ici aux politiciens et industriels qui veulent transformer l'île en l'industrialisant, en multipliant les barrages électriques, qui noient de bonnes parties de la nature islandaise, et en développant l'industrie de l'aluminium, une industrie hautement polluante. La première partie du livre est très théorique, traitant de grandes idées générale, et la seconde devient plus pratique, se concentrant sur les faits touchant très particulièrement à la politique islandaise. Il semble que la quête de la croissance économique à travers l'industrie lourde soit devenue une sorte de religion d'état, que l'auteur s’emploie à déconstruire. Commençons par la seconde partie. L'auteur résume ainsi l'industrie de l'aluminium : Seen in its ugliest light, the aluminium industry comes out like this: an ecologically sensitive forest is stripped away in Jamaica, clear forest pools are filled with red sludge and caustic sauda, a ship sails off to Iceland, in Iceland a dam blocks off a valley, the land sinks under the weight of the water, clay is whipped up by winds from the mudflats beside a reservoir, electricity is sold at give-away prices by the people that sacrified their land. there are always two side of a story:there are some very pretty flowers on the website (p.246). L'auteur passe beaucoup de temps à démonter la politique énergétique de son pays mais aussi les industriels auxquels les politiciens avaient l'intention de vendre cette même énergie : des industriels qui n'hésitent pas à commettre crimes de guerre et crimes environnementaux pour leurs profits. Mais dans la novlangue du premier ministre, la situation est présentée ainsi : There is a consensus over the need for continued economic growth in Iceland, and it is abundantly clear that if we fail to utilize the country's energy ressources there will be an apreciable downturn in economic growth as early as 2007 with an attendant rise in unemployment (p.231). Un magnifique exemple de langue de bois politique qui, déconstruite longuement par l'auteur, n'est rien d'autre que de la menace mensongère. Je ne vais pas reproduire ici tous les arguments que l'auteur avance pour promouvoir la protection environnementale, mais il résume la chose selon une perspective très habile : Perhaps we ought to consider putting what remains of the waterfalls and wide open spaces of Iceland under the directorate of health as a designated and inalienable part of the national health service. By this, I mean health both physical and mental (p.210). Et, pendant ce temps, l'armée américaine locale, en coopération avec l'état islandais, mène des exercices à grande échelle de lutte contre des... environnementalistes extrémistes (p.207).
Revenons vers le début du livre, bien plus difficile à résumer, où Andri Snær Magnason prend le temps de poser des bases théoriques pour alimenter son propos à venir. Il faut ici noter son écriture : c'est un écrivain, et on le sent. Il n’hésite pas à partir loin, à faire un peu de politique-fiction ou presque de la fable. Il commence son livre par évoquer le langage et les difficultés de communications entre individus. Le monde se complexifie à vue d’œil, et cette complexité est exploitée par le pouvoir. Comment penser si on ne peut mettre des mots sur les choses ? L'auteur imagine un monde où les humains discutent de félins avec la même précision avec laquelle il parlent de stations hydroélectriques, c'est un dire un monde où le langage technique est employé quotidiennement sans être compris de la plupart des gens (p.64) :
L'auteur passe plusieurs pages à déconstruire le terme croissance économique. Selon lui, c'est devenu un outil linguistique d'une puissance considérable mais que peu de gens comprennent vraiment, un outil qui se rapproche du mysticisme religieux (p.72) Accuser quelqu'un d'être contre la croissance économique revient à une excommunication, une décrédibilisation totale. L'auteur soutient à la place une multitude d'indicateurs précis plutôt que ce géant : des indicateurs pour l’éducation, le progrès technologique, et autres choses de ce genre. Il en arrive inévitablement à l'éducation, et j'aime beaucoup ces quelques phrases : People build up a thick layer of fact but cannot apply it to the real world. They never actualy take the plunge. They forget that science is about huge, burning questions crying out to be answered, not answers that need to be learned. Science, philosphy and the arts were once branches of the same tree, not starkly demarcated oposites."There is no point re-inventing the wheel", they say; perhaps the truth is more that the wheel has not been invented often enouth (p.93). Andri Snær Magnason va plus loin en proposant des directions pour l’éducation : permettre aux élèves/étudiants d'être acteurs, créateurs, les mettre en contact concret avec le monde et avec autrui plutôt que de les laisser assis passivement (p.96). Ce genre de chose me parle. Beaucoup.
Magnason se laisse aller à un petit exercice de ré-imagination de la construction des pyramides égyptiennes, une fable qui sert à faire parallèle avec l'industrie lourde en Islande. En gros, la morale en est : Man has a tendancy to preserve esthablished systems wether they make sense or not (p.149). Il imagine que, une fois commencée, la construction des pyramides ne pouvait plus être stoppée car trop de gens en dépendaient financièrement. Que ces chantiers soient absurde ou non n'est pas la question : ils ne peuvent être stoppés car ils donnent du travail a une partie importance de la population. Par exemple, rien d'autre que la volonté politique n’empêche le métier de caissier d'être entièrement automatisé. Un métier en bonne partie inutile qui pourtant fournit du travail en masse. Pourquoi prendre le risque de changer l'ordre établi ? Et en bonus, une très amusante vision de l'emploi : To save on costs Pharaoh decides not to use slaves but wage slaves - slaves need watching over, feeding, clothing and driving forward; they may be physically bound, but spiritually they are free and look to escape at the first opportunity. Wage slaves turn up to work volontary and can work for way below subsistence levels. What they fear above all else is freedom, that they call unemployment (p.150). Je suppose que toute ressemblance avec la réalité est parfaitement fortuite.
Dreamland m'a fait penser à autre chose. C'est un livre environnementaliste, et souvent on ne peut pas séparer l’environnementalisme du végétarisme/végétalisme, et pour de bonnes raisons. Mais ici, le sujet est évoqué mais rapidement laissé de côté avec indifférence. Et, au contraire, l'auteur soutient clairement la production de viande. Il est clair que les conditions islandaises ne sont pas les mêmes que sur le continent : beaucoup d'océan pour la pèche, beaucoup de terres pour l'élevage, très peu de population et un environnement peu propice à la culture de fruits et légumes. Il me semble qu'en Islande, l’élevage animal et la pèche, en raison de la très faible population, sont écologiquement viables et peut-être même nécessaires (bien entendu c'est une supposition : je n'en sais rien). Dans ce cas, est-ce que peut surgir le problème éthique ? Ou le problème éthique ne peut-il surgir à grande échelle que quand des alternatives viables existent ? En Islande, la culture sous serre avec l'aide de l'énergie thermique est-elle cette alternative ?
En somme, Dreamland: A Self-Help Manual for a Frightened Nation est une excellente lecture. De l'environnementalisme appliqué à une situation précise dans un petit pays qui s’efforce de maintenir son rapport privilégié avec son environnement, en opposition avec des forces considérables qui veulent exploiter cet environnement jusqu'à la corde. Je ne crois pas qu'il existe de traduction en français.
281 pages, 2006, citizen-press london
dimanche 11 mars 2018
La conquête sociale de la terre - Edward O. Wilson
Un mélange de biologie
de l'évolution et de psychologie cognitive qui explore l’aspect
social de l'évolution humaine. La principale thèse de l'auteur,
c'est la sélection à niveaux multiples. C'est à dire que
l'évolution humaine serait due à un mélange entre la sélection
individuelle, la plus connue, et la sélection de groupe. Une autre
notion qui revient en permanence, c'est l'eusocialité, qui définit
l'humanité et quelques autres animaux sociaux (fourmis,
abeilles...). Pour se développer, l'eusocialité a besoin d'un
groupe qui protège un nid en coopérant. Elle se réalise quand
« les membres d'un groupe appartiennent
à plus d'une génération et divisent le travail d'une façon qui
sacrifie au moins une partie de leurs intérêts personnels à
l'intérêt du groupe. » (p.184) L'auteur passe aussi pas mal
de temps à parler des fourmis, qui sont à mes yeux nettement moins
passionnantes que les humains. Ci-dessous, un petit relevé des
éléments les plus marquants du livre.
En revenant
au début du labyrinthe de l'évolution, Wilson rappelle les
« préadaptations » (caractéristiques qui permettront à l'espèce qui les possède de se développer)
extrêmement improbables qui ont permises à l'humanité de prendre
les bons virages dans le labyrinthe et de devenir ce qu'elle est :
- L'existence sur la terre ferme. En effet, pas de feu, de soufflet ou de forge sous l'eau.
- La grande taille du corps. Seule une infime partie des organismes terrestres font notre taille ou plus. Et pour les organismes trop petits, il n'est pas possible d'avoir un cerveau suffisamment grand ni d'allumer et maîtriser un feu.
- Les mains préhensiles. C'est la particularité des primates, et sans doigts souples (ou tentacules), il n'est pas possible de fabriquer ou d'utiliser des outils complexes.
- La position debout qui permet de libérer les mains, qui peuvent du coup servir à manipuler des objets avec adresse.
- L'adaptation à un régime alimentaire incluant de la viande, très dense en calories.
- La coopération, notamment dans la chasse, qui permet la formation de groupes organisés.
- La maîtrise du feu, pour la cuisson, la chasse et bien d'autres choses.
- Le feu permet une certaine sédentarité, et autour des ces « nids » a pu se développer l'eusocialité.
- La division du travail.
L'auteur
consacre un chapitre particulièrement intéressant au tribalisme
comme trait humain fondamental (pages 81 et suivantes). « Les
gens ont besoin d'appartenir à une tribu. Ils reçoivent d'elle un
nom qui s’ajoute au leur et une raison d'être sociale dans un
univers chaotique. L'environnement devient par là moins déroutant
et moins dangereux. » « De nos jours, à travers le
monde, échaudés par la guerre dont ils redoutent les conséquences,
les gens se sont tournés de plus en plus vers son équivalent
moral : les sports d'équipes. Leur soif d'appartenir à un
groupe gagnant peut-être comblée par la victoire de leurs guerriers
au terme des affrontements qui ont lieu sur ces champs de bataille
ritualisés. » « Le besoin élémentaire de former des
groupes et de prendre grand plaisir à appartenir à un groupe se
traduit facilement à un plus haut niveau dans le tribalisme. Les
gens ont tendances à être ethnocentriques. » « Quand,
au cours d'expériences, on a furtivement montré à des Américains
blancs et à des Américains noirs des photos de l'autre race, leur
amygdale, centre de la peur et de la colère, s'est activée si vite
et si imperceptiblement que cette réaction a échappé aux centres
conscients de leurs cerveaux. Les sujets, en effet, n'y pouvaient
rien. Quand, au contraire, on a jouté un élément pertinent – par
exemple le Noir était un médecin et le Blanc, son patient –, les
autres sites du cerveau intégrés dans les centres supérieurs de
l'apprentissage, le cortex cingulaire préférentiel dorso-latéral,
se sont activés en réduisant l’amygdale au silence. Ainsi, le
grégarisme est le fruit de l'évolution de parties différentes du cerveau par
sélection de groupe. Celles-ci entrent en jeu dans la tendance innée
à dévaloriser ceux d'autres groupes ou au contraire à refréner
ses effets autonomes immédiats. »
La suite
logique à explorer après le tribalisme, c'est la guerre. « La
meilleur façon d'obtenir le soutien du public est de faire appel aux
passions que suscite la lutte à mort, et l'amygdale en est le grand
ordonnateur. »
Wilson
explore souvent la frontière entre le génétique et le culturel.
Par exemple, on sait que la consanguinité n'offre pas de bonnes
perspectives d'avenir, et il semble que cet instinct soit implanté
génétiquement en nous, pas seulement culturellement. Dans ce cas,
c'est « la coexistence étroite dans les trente premiers mois
de la vie d'un des partenaires ou des deux » (p.259) qui
éveille chez l'individu l'instinct qui l’empêche de considérer
autrui comme un partenaire reproductif.
Dans des
expériences, des humains de deux ans et demi semblent avoir les
mêmes compétences que des chimpanzés pour résoudre des problèmes
physiques et spatiaux. Pas contre, les enfants dominent très
largement les singes dans les tests sociaux. Il semble donc que « les
humains réussissent non pas parce qu'ils possèdent une intelligence
supérieure qui trouve la solution à tous les défis, mais parce
qu'ils sont de naissance des spécialistes ès compétences sociales.
En coopérant par la communication et la lecture d'intention, les
groupes font beaucoup mieux que les efforts de n'importe quel
solitaire. » (p.290)
Une théorie
particulièrement centrale et marquante de Wilson est la façon dont
il utilise la sélection à niveaux multiples pour explorer la
moralité humaine. « La sélection individuelle résulte de la
compétition pour la survie et la reproduction entre les membres du
même groupe. Elle façonne dans chacun des instincts
fondamentalement égotistes, tant par des conflits directs que par
des différences de compétences destinées à l'exploitation de
l’environnent. La sélection de groupe façonne des instincts qui
tendent à rendre les individus altruistes les uns envers les autres
(mais pas envers les membres d'autres groupes). La sélection
individuelle est responsables en grande partie de ce que l'on appelle
péché, alors que la sélection de groupe l'est pour l'essentiel de
la vertu. » (p.310) Mais pas forcément la vertu envers les autres
groupes, je précise. Wilson continue sur le sujet : « il
existe une règle impérative dans l'évolution sociale génétique :
les individus égoïstes l'emportent sur les individus altruistes,
alors que les groupes d'altruistes l'emportent sur les groupes
d’égoïstes. La victoire ne peut jamais être totale, car
l'équilibre des pressions de sélection ne va à aucun des deux
extrêmes. » (p.354) On peut deviner les tensions qui résultent
de ces deux forces, et Wilson ne manque pas d'y venir : « Il
est inévitable que ces forces antagonistes de sélection à niveaux
multiples provoquent dans l'esprit de l'être humain une distorsion
permanente, qui s'expriment par d'innombrables scénarios à la
faveur desquels les individus se lient, s'associent, se trahissent,
partagent, se sacrifient, se volent, trompent, se rachètent,
punissent, supplient et se prononcent. La lutte endémique qui se
livre dans le cerveau de chacun et qui se reflète dans l'immense
superstructure de l'évolution culturelle constituent la matière
première des sciences humaines. Un Shakespeare dans le monde des
fourmis, qui ignorent la lutte entre l’honneur et la trahison et
que leurs instincts limitent à une minuscule palette de sentiments,
ne pourrait écrire que deux tragédies, l'une célébrant une
victoire et l'autre déplorant une défaite. En revanche, l'homme de
la rue peut inventer une variété illimitée d'histoires de ce genre
et composer une symphonie sans fin où les états d'âmes se modulent
sur des registres inépuisables. » (p.349) Ainsi l'art peut
aussi s'expliquer par cette théorie évolutionnaire.
Wilson
parsème tout son livre, et particulièrement la fin, d'une
réfutation rationnelle des religions. Je ne me suis pas attardé sur
le sujet car même si c'est fort bien amené, je n'ai vraiment pas
besoin d'être convaincu. Wilson conclut, sans le citer explicitement, sur le paradoxe de Fermi, qui décidément se retrouve
partout. Son opinion est que l'humanité ne quittera sans doute
jamais la Terre, que de toutes façons ça ne servirait pas à grand
chose et que c'est au contraire un espoir dangereux car il peut
servir d'excuse pour la destruction sans complexe de notre biosphère.
378 pages,
2012, flammarion
jeudi 8 mars 2018
La tour de verre - Robert Silverberg
Relecture d'un autre petit roman de Silverberg. Dans environ 200 ans, le milliardaire mégalo Siméon Krug construit une tour de verre d'un kilomètre et demi de haut quelque part dans un coin paumé de la toundra. Ce n'est pas simplement pour flatter son ego : la tour permettra d'envoyer des messages plus rapides que la lumière vers une planète d'où proviennent de mystérieux signaux. Mais ce n'est qu'une toile de fond. Le vrai sujet du roman, ce sont les androïdes, qui ont fait la fortune de Krug, leur inventeur et créateur. Ce sont les androïdes qui suent et qui meurent sur le chantier de la tour, ce sont les androïdes qui font toutes les basses besognes d'une humanité dont la population a drastiquement baissé.
Et si certains d'entre eux se lancent en politique pour réclamer à l'humanité le droit d'être autre chose que des objets, la plupart se réfugient dans la religion. Il vénèrent Krug, qui est littéralement leur créateur. Il attendent que Krug décrète la fin de leur période d'épreuves et place les nés-de-la-cuve à égalité avec les nés-de-la-matrice. C'est tout cet aspect qui fait l'intérêt de La tour de verre. Silverberg va jusqu'à réécrire une sorte de bible androïde, à leur imaginer des rituels complexes et crédibles. Les androïdes se réfugient dans le religion pour se cimenter en tant que communauté, pour s'inventer une identité et pour accepter leur sort de sous-humains. Comment réagirait le tumultueux Krug s'il venait à apprendre qu'il a été érigé en divinité par ses créatures ? On peut deviner que ce serait une mauvaise idée pour lui de contredire leur foi... Un bon roman, certainement, mais un peu trop éparpillé pour son propre bien. Les idées s'accumulent sans toujours murir : l'intrigue avec la potentielle forme de vie lointaine, le chantier titanesque de la tour, la pulsion vitale débordante de Krug, les doutes de son fils écartelé entre un mariage raté et une amante androïde qu'il désire follement, l'organisation complexe et secrète de la société androïde, le système de téléportation planétaire, la disparition de la classe ouvrière, un androïde qui apprend à être plus humain par le sexe, la théologie de l'église androïde... Au moins, à cette période de sa carrière d'écrivain, Silverberg n'exploite pas ses idées jusqu'à la corde et ne prend pas le risque d'ennuyer son lecteur.
318 pages, 1970, le livre de poche
Libellés :
Littérature,
Science fiction,
Silverberg Robert
Inscription à :
Commentaires (Atom)