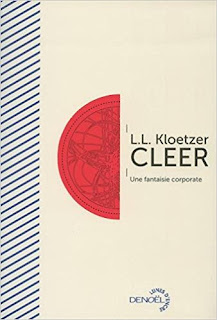lundi 30 octobre 2017
Cleer, une fantaisie corporate - Laurent Kloetzer
Vinh et Charlotte sont deux nouvelles recrues de Cohésion Interne, une division de la gigantesque multinationale Cleer qui s'apparente à des ressources humaines de très haut niveau. Cleer, c'est une énorme machine à dollars, présente dans tous les secteurs, et notamment dans l'électronique, genre téléphones et ordinateurs. Une énorme machine à dollars qui cultive une très puissante culture d'entreprise, une véritable aura religieuse. Vinh et Charlotte sont le lien entre les hautes sphères de l'abstraction monétaire et la réalité du terrain, où il faut recadrer, virer, délocaliser, manipuler. Étonnamment, le récit se déploie sous forme d’enquêtes, au nombre de cinq, chacune formant un mini techno-thriller. Les deux personnages se transforment à l'occasion en véritables James Bond. Mais plus on avance dans le roman, plus les choses deviennent cryptiques. On comprend à peine quels sont les enjeux, Vinh et Charlotte perdent la boule, frôlent le burnout, et on a vient parfois à douter de la réalité des expériences qu'ils vivent. Cela va encore plus loin, par exemple quand Charlotte se fait remettre une sorte d'anneau magique qui la rend insomniaque et développe dangereusement ses capacités d'empathie. Est-ce que c'est vraiment un anneau magique, comme dans un conte de fée ? Charlotte est-elle victime d'une machination de Cleer visant à expérimenter sur ses employés ? Ou l'objet n'a-t-il aucun rapport avec ce qui est simplement un burnout ?
C'est flou, et parfois frustrant. Par contre, le récit réussit à créer un atmosphère exotique, une atmosphère de couloirs blancs traversés par des génies psychopathes, de nuits de travail agrémentées de verres de vodka et de quelques heures de sommeil, de compétition inhumaine poussée jusqu'au combat à mort, littéralement. Les actionnaires qui siègent au board sont des anges, vivant dans le royaume de lumière qu'est le sommet du gratte-ciel de Cleer, et l'ambition de tout cadre est de joindre leurs rangs. Pour cela, il faut connaitre et pratiquer la doctrine, éliminer les hérétiques et se transcender à coup d'expériences mystiques. Ces êtres de lumière, ceux qui ont le pouvoir et l'argent, semblent hors du monde sensible, stoïques à l’extrême, asexués, immatériels. Leurs voies sont impénétrables. Du coup, dès qu'on sort du coté espionnage du roman pour aller vers de la mystique corporate, le lecteur froncera sans doute les sourcils. Pourtant, c'est clairement le plus intéressant. Opaque, mais stimulant. Et le langage utilisé, à défaut d’être toujours clair, est imprégné de l'aspect frénétique et exalté de l'univers qu'il décrit.
351 pages, 2010, denoël
Libellés :
Kloetzer Laurent,
Littérature,
Science fiction
mercredi 25 octobre 2017
Illuminatus ! L’œil dans la pyramide - Robert Shea & Robert Anton Wilson
Comment parler de cette étrangeté ? Premier tome d'une trilogie dont les deux autres volumes n'ont, je crois, jamais été traduits en français, L’œil dans la pyramide est pour le moins... déconcertant. Déjà, oubliez toute notion de continuité. Si les auteurs restent parfois sur un point de vue stable pendant plusieurs pages, il est la plupart du difficile de savoir ce qu'il se passe, quand, où, avec qui et pourquoi. Souvent, toutes les deux ou trois lignes, on passe sans transition de personnage en personnage, de lieu en lieu, en allant et venant dans le temps. Et on ne sait jamais vraiment si ce que l'on lit est une hallucination sous acide, un bad trip, un fantasme de névrosé ou quelque chose se rapprochant de la réalité.
Comme l'indique le titre, les illuminati sont réels (ou pas ?), et les quelques personnages identifiables du roman sont soit en pleine enquête pour comprendre une vérité élusive, soit déjà activement entre lutte contre les comploteurs. Mais à part quelques rares moments, les illuminati existent essentiellement à travers les discours de ceux qui cherchent à se renseigner sur leur existence et ceux qui luttent contre eux, ou s'imaginent lutter contre eux. Les iluminati pourraient juste être une illusion, un bouc émissaire sorti de l’esprit de gens en quête de sens, paumés dans un monde trop complexe. C'est quelque chose que le roman fait plutôt bien : mettre en scène le chaos idéologique de l'humanité, la confusion des idées, des opinions, des modes de vie. On peut estimer que le style d'écriture est une expression de ce chaos... On passe d'une expédition en sous marin du coté de l'Atlandide en compagnie d'un mélange entre le capitaine Nemo et Andrew Ryan à... Hum. Il est difficile de se souvenir de scènes en particulier, dans cette vaste purée saupoudrée d'une infinité de références. Lovecraft, Machen, Ambrose Bierce, William Chambers, Huxley, Ayn Rand, Burroughs... Et ce ne sont là que les auteurs, on trouve intégrés à ce grand bordel toutes sortes d'autres personnalités. Et du coup, est-ce que c'est bien ? Parfois j'adorais, devant des passages d'un humour loufoque et cynique irrésistible, parfois je m'ennuyais, submergé par une multitude de fragments bordéliques dont je ne savais que faire. Disons juste que je suis content que ce machin existe, et qu'il vaut le détour. Quand à essayer de le décrire, je laisse la parole aux auteurs, qui ne manquent pas de se moquer d'eux-mêmes dans leur propre roman :
C'est un livre horriblement long, explique Wildeblood avec mauvaise humeur, et je n'aurai certainement pas le temps de le lire, mais je suis en train de le parcourir très attentivement. Les auteurs sont de la dernière incompétence - aucun sens du style ou de la structure. Ça démarre comme une enquête policière, puis ça bascule dans la science fiction et enfin, dans le surnaturel, le tout agrémenté de détails sur des dizaines de sujets tous les plus ennuyeux les uns que les autres. Et la chronologie est complètement chamboulée, dans une imitation très prétentieuse de Faulkner et de Joyce. En plus, il est parsemé de scènes de cul cochonnes au possible, juste pour faire vendre, manifestement ; et les auteurs - dont je n'ai jamais entendu parler - ont le mauvais goût suprême d'introduire de véritables personnalités dans tout ce mic-mac et de faire semblant de dévoiler une authentique conspiration. Tu peut être sur que je ne vais pas perdre mon temps à lire des âneries pareilles, mais tu auras une critique parfaitement dévastatrice sur ton bureau demain à midi.
478 pages, 1975, abysses
Libellés :
Fantastique,
Littérature,
Science fiction,
Shea Robert,
Wilson Robert Anton
lundi 16 octobre 2017
Surface de la planète - Daniel Drode
De la SF qu'on peut rattacher au mouvement du Nouveau Roman, mais, pour plus de clarté, je préfère le terme roman expérimental. En gros, l'auteur se permet pas mal de néologismes, de libertés avec la mise en page et, plus globalement, une trame plus floue que nécessaire. Est-ce que ça fonctionne ? Pour l'écriture, oui. Pour un moment du moins. Le temps d'accepter qu'il faut, en tant que lecteur, fournir quelques efforts supplémentaires, on se laisse prendre au jeu de Daniel Drode. Jusqu'à un certain point. Si on sourit parfois devant de bonnes trouvailles, la plupart des étrangetés de mise en page sont parfaitement inutiles (si ce n'est la totalité) et donnent à l'ensemble un désagréable côté prétentieux. Et les quelques moments de brillance ne changent rien au fait que plus on avance dans le récit, plus on se sent embourbé dans une vaine confusion.
Surface de la planète a beaucoup de liens avec d'autres œuvres. Au début, l'humanité vit dans un monde souterrain, le Système, où chaque individu reste dans sa cellule, son attention absorbée par une sorte de flux d'information, la Vision. Voilà qui rappelle vivement La machine s’arrête de E.M. Foster (1909). Puis, quand le Système s’effondre inévitablement, les humains retournent errer à la surface la planète, d'où le titre. Ce n'est jamais plus qu'une errance, en effet. Il ne se passe pas grand chose. Les quelques réflexions pessimistes sur la civilisation humaine sont dans la lignée de Jacques Spitz ou Régis Messac, que Drode connaissait peut-être. On discerne une inquiétude environnementale, un cataclysme d'origine humaine ayant causé la migration en sous-sol. Puis, plus loin dans l'errance, on se rapproche du encore inexistant Stalker. La nature est parcourue d'un frisson mystérieux, d'anomalies venues d'on ne sait où. L'une de ces anomalies est un monde en deux dimensions tout droit sorti de Flatland (1884). Malheureusement on se saura jamais rien de ce monde, il se contente d’être là, pendant que le narrateur erre, erre encore, erre toujours.
J'aimerais aimer Surface de la planète. Mais, malgré beaucoup d'ambition, c'est tellement bancal. Un fond qui plonge doucement mais sûrement dans l'ennui se noie dans une forme souvent inutilement alambiquée, et on termine avec l'impression de sortir d'un charabia insensé.
1959, robert laffont
samedi 14 octobre 2017
La vie et l'œuvre du compositeur Foltyn - Karel Čapek
Le titre même ce ce court roman est une blague. Le compositeur Foltyn est un personnage ridicule, prétentieux, incapable. S'il a bien une vie, il n'a certainement pas d’œuvre. Depuis son plus jeune age, Foltyn prend la pose, s’efforce autant qu'il peut d'avoir l'air artiste, de mener une vie troublée et bohème, comme un apprenti Rimbaud. Il sait jouer du piano, il est sincèrement passionné, mais il est surtout grotesque et médiocre.
Le roman est organisé comme une suite de témoignages fragmentaires. Divers personnages ayant connu Foltyn à des stades variés de sa vie livrent leurs souvenirs et leurs impression à son égard. On rigole beaucoup devant le comportement du pseudo-artiste et l'incrédulité de ceux qu'il cherche à impressionner. Mais Karel Čapek ne se contente pas de faire rire, il interroge sur la nature de l'art et de l'artiste. Qu'est-ce que la passion sans le talent ? La posture sans le travail ? La prodigalité sans la discipline ?
La vie et l’œuvre du compositeur Foltyn est un roman posthume et inachevé, mais sa nature fragmentaire fait qu'on n'en a vraiment pas l'impression. Une habile satire sur l'art et l'artiste.
171 pages, 1939, stock
samedi 7 octobre 2017
Water Knife - Paolo Bacigalupi
De La fille automate, du même auteur, je me souviens bien de l'univers, intelligent et inventif, mais pas du tout de la trame. Je sens que ça risque de faire pareil avec Water Knife.
Futur proche. Le sud des USA manque d'eau. Gravement. Phoenix sombre lentement sous la poussière, assaillit par la sécheresse. Vegas arrive à s'en sortir en usant de toutes sortes de coups fourrés pour garder le contrôle des lacs et des fleuves. La plupart de ses habitants vivent dans des arcologies, de grandes tours en vase quasi-clos, dont le but est de recycler la moindre goutte d'eau. Mais dehors, l'air est sec, et le sol aspire avidement le sang des réfugiés climatiques. Paolo Bacigalupi fait preuve une fois de plus d'un grand talent de worldbuilding. Cette vision du futur est proche, frappante, et surtout terriblement crédible. Plus un documentaire anticipatif que de la SF (mais n'est-ce pas la même chose ?). De ce coté, Water Knife est une grande réussite. Une foule de détails pertinents viennent renforcer la vision d’ensemble, comme ces sacs qu'on trouve partout et qui servent à filtrer la pisse de façon à pouvoir en récupérer l'eau et la boire. D'autres détails, comme cette obsession à appeler toutes les voitures des Tesla, sont plus discutables : c'est le genre de chose qui vieillira terriblement quand cette marque disparaitra.
Pour explorer son univers, Bacigalupi utilise trois personnages. Angel, un tueur au fond pas trop mauvais, homme de main au service de Vegas, chargé de d'intervenir avec plus ou moins de violence dans tout ce qui a un rapport avec la gestion de l'eau. Le water knife du titre. Une journaliste, dont j'ai oublié le nom alors que je viens de finir le bouquin il y a quinze minutes, qui s'acharne à rester à Phoenix couvrir l'effondrement de la ville, alors que contrairement aux locaux elle a les papiers pour se barrer. Et Maria, jeune texane paumée dans un monde de merde, prête à tout pour se barrer de Phoenix.
Ces personnages fonctionnent. Quand à l'intrigue, bon, il s'agit d'abord d'une visite guidée de l'univers, puis d'un thriller classique. Une longue course après un MacGuffin qui se retrouve là où ça arrange l'auteur, avec du sang, du sexe, du suspense. Là aussi, ça fonctionne. Mais sans plus. C'est trop long, trop bavard. L'auteur utilise beaucoup les dialogues pour meubler. Par exemple, la rencontre entre Angel et la journaliste : "Bouge pas, je vais te tuer !" "Non, tu n'oseras pas !" "Si, je vais le faire, sans déc !" "Trop pas !" "Trop qu'si!" La scène de sexe qui s'étire sur des pages entières, les personnages qui, même quand ils sont seuls, trouvent encore le moyen de faire des dialogues avec eux-mêmes... La trame est loin d’être assez riche pour justifier autant de texte.
Paolo Bacigalupi sait créer des univers importants, qui méritent le détour, mais on aimerait qu'il nous y conte des histoires de la même qualité.
488 pages, 2015, au diable vauvert
Libellés :
Bacigalupi Paolo,
Littérature,
Science fiction
Inscription à :
Commentaires (Atom)