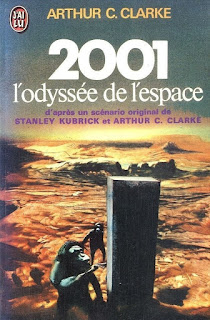mercredi 31 août 2016
L'Attrape-cœurs - J. D. Salinger
Je ne savais rien de ce roman avant de le commencer, si ce n'est qu'il est très populaire aux USA et que ça parle d'un ado. Et cette édition a une quatrième de couverture complétement vide. Mystère, donc. Première chose chose qui choque : l'écriture. C'est sensé être écrit par un gamin de 16 ans. Donc, c'est très mal écrit. Je ne sais pas si c'est la traduction ou pas, mais il y a quelques trucs qui écorchent le regard. Le fait que la moitié des phrases soient ponctuées d'un « et tout » par exemple. Ou que « parce que » soit constamment remplacé par « bicause ». Sérieusement, bicause... Bon, on s'y fait plus ou moins, et ce style oral fait que le tout se lit très facilement. Deuxième chose qui marque : mais que c'est glauque ! Holden, l'ado en question, s'est encore fait virer du lycée, et va errer quelques jours dans New York. Il n'aime rien ni personne, tous les gens qu'ils rencontre sont des abrutis, il va en boite, se bourre la gueule, drague des filles et voit une prostituée. Pas joyeux tout ça. On a l'impression qu'Holden essaie sincèrement de s'intéresser à autrui, mais que toutes ses tentatives sont vouées à l'échec. Bon, c'est de sa faute aussi, il est un peu con parfois. Il faut reconnaitre que Salinger parle assez bien de l'adolescence. Ce jeune homme complètement paumé, on le comprend. La principale relation épanouissante qu'il a, c'est avec son adorable petite sœur. Salinger rend avec merveille ce soulagement qu'Holden ressent en se trouvant en présence de quelqu'un avec qui il peut parler vraiment, sincèrement, même si cette personne est encore moins expérimentée que lui. Juste le soulagement qu'apporte cette connexion intime et instinctive. A noter aussi, l'humour décalé et moqueur qui m'a souvent fait sourire. Dans l'ensemble, L'Attrape-cœurs m'a plutôt convaincu. Ce roman a, je crois, été très populaire dans les cours d'anglais aux USA, et ça m'a fait penser à une chose : c'est terriblement masculin. Je ne sais pas si cette pensée a un fond de vérité, mais il me semble qu'une bonne partie de la littérature tolérée par le système éducatif (et aussi une partie de la littérature en général) est très... masculine. Je veux dire, si j'étais une ado et que mes lectures lycéennes étaient essentiellement constituées de ce genre de points de vues masculins... et bien je ne sais pas du tout quel effet ça me ferait, parce que je ne peux pas l'expérimenter. Voilà voilà.
253 pages, 1951, pocket
samedi 27 août 2016
La rencontre amoureuse du solitaire dans Premier Amour de Beckett et Les Nuits blanches de Dostoïevski
Juste un papier écrit pour la fac qui, je crois, n'est pas trop
mauvais, du coup je le stocke ici avant qu'il ne disparaisse quand mon
pc rendra l’âme sans prévenir. Hop.
Les Nuits blanches, longue nouvelle de Dostoïevski publiée en 1848, et Premier Amour
de Beckett, nouvelle publiée en 1970 mais écrite en 1946, sont
séparées d'environ une centaine d'années. La distance qui sépare
ces deux œuvres est aussi géographique et culturelle. Pourtant on y
trouve des ressemblances assez frappantes aussi bien dans leur
structure que dans leur personnage principal. Dans les deux cas il
est aussi le narrateur, et c'est un homme solitaire fuyant les
préoccupations de ses pairs. Au cours de ses errances, il rencontre
au bord d'un canal une femme avec qui il aura une esquisse de
relation, un semblant de « premier amour ». En plus de cette
structure narrative rapidement résumée, il y a un autre lien entre
les deux œuvres. Le titre « Premier Amour » a
vraisemblablement été emprunté par Beckett à la nouvelle de
Tourgueniev du même nom. Si cette nouvelle a en effet le même
thème, sa structure est très différente. Cependant Tourgueniev et
Dostoïevski étaient contemporains l'un de
l'autre et, plus important, Les Nuits blanches s'ouvre sur une
citation de Tourgueniev.
Même sans pouvoir savoir avec certitude si Beckett a lu ou non Les
Nuits blanches, on sait qu'il était familier de
Dostoïevski, on peut donc supposer que les liens
entre les deux nouvelles ne sont pas anodins. C'est d'autant plus
probable quand on connaît le goût de Beckett pour les inspirations
et références littéraires assez peu perceptibles. Quoi qu'il en
soit, il est intéressant de se demander comment deux auteurs comme
Dostoïevski et Beckett peuvent construire des
œuvres répondant à leurs styles et préoccupations propres en
ayant un point de départ commun. Premièrement, c'est la figure de
l'homme solitaire s'excluant lui-même de la société qui va nous
intéresser. Les deux auteurs mettent ensuite en scène deux
rencontres amoureuses à la fois étonnamment semblables et tout à
fait différentes. Ces rencontres mènent à deux visions de l'amour,
et par extension de la vie humaine en général, où cette fois les
visions de Beckett et Dostoïevski semblent se dissocier pour de bon.
•••
Dans les deux nouvelles, la façon dont le personnage se désigne
est en accord avec son caractère effacé et solitaire. On ne
connaîtra le nom d'aucun des deux, ils resteront anonymes. Avoir un
nom est utile dans les situations sociales, pour des raisons
pratiques d'identification. Mais nos héros n'ayant pas, ou presque,
de vie sociale, un nom est pour eux un outil superflu, inutile. On a
droit dans les deux cas à un « je » anonyme. Le
lecteur n'a de toutes façons pas besoin d'un nom pour identifier le
narrateur du récit. Pourtant chez Dostoïevski, à défaut d'un nom,
on aura un surnom. C'est le narrateur qui se le donne lui-même ;
qui d'autre le pourrait puisqu'il ne connaît personne ? C'est à
l'occasion de la rencontre avec le seul autre véritable personnage
de la nouvelle, la jeune femme Nastenka. On remarque d'ailleurs que
le narrateur ne songe à demander son nom à l'inconnue qu'à leur
seconde rencontre, soulignant ainsi le coté superflu de ce système
de désignation pour les êtres aussi solitaires que lui. Peu importe
son nom puisqu’elle est la seule jeune femme qu'il connaît. Donc,
quand il commence à parler de lui, le narrateur se désigne ainsi :
« je suis un rêveur ». Et tout le long du récit son
identité restera celle-ci, il se désignera lui-même comme « le
rêveur ». Ce surnom est finalement bien plus utile et
approprié qu'un nom classique car il nous apprend le caractère du
personnage qu'il désigne. L'isolement social permet au narrateur de
subvertir le coté arbitraire des noms pour faire de celui qu'il se
choisit un reflet de son caractère. L'effacement de l'identité
sociale est donc déjà bien avancée chez Dostoïevski, mais elle
est comme on peut s'y attendre en connaissant l'auteur encore plus
frappante chez Beckett. Le narrateur et personnage principal n'a
cette fois ni nom ni aucune désignation particulière pendant tout
le récit. Il restera du début à la fin un simple « je ».
C'est d'autant plus significatif quand on sait que Becket aime dans
un bon nombre de ses œuvres donner à ses personnages des noms
formés à base de jeux de mots. Si celui-ci n'a pas de nom, c'est
que même pour un personnage beckettien il est particulièrement
isolé socialement. Comme on peut supposer que le narrateur comme son
créateur est d'origine irlandaise, on l’appellera pour des raisons
pratiques « l'irlandais ».
Ces deux personnages, bien que très proches par leur isolement, ont
néanmoins des tournures d'esprit très différentes. Cette
opposition est perceptible dès les premières lignes de leurs
confessions respectives. Le rêveur commence par nous parler de l'une
de ses nuits d'errance solitaire, mais il le fait d'une façon
positive, pleine de vie :
C'était une nuit merveilleuse, une de ces nuits comme il n'en
peut exister que quand nous sommes jeunes, ami lecteur. Le ciel était
si étoilé, un ciel si lumineux, qu'à lever les yeux vers lui on
devait malgré soi se demander : se peut-il que sous un pareil
ciel vivent des hommes irrités et capricieux ? Cela aussi c'est
une question jeune, ami lecteur, très jeune... mais puisse le
Seigneur vous l'inspirer souvent !
Le rêveur n'est pas à première vue triste de sa situation. Dans ce
premier paragraphe le narrateur insiste sur une impression
d’émerveillement enfantin, en quelques lignes on trouve trois fois
le mot « jeune ». En effet on comprendra à la fin
du récit que le narrateur raconte cette histoire quinze ans après
les événements. Il ne semble pas éprouver de regret, mais plutôt
une certaine tendresse pour le jeune homme qu'il était. La nuit est
« merveilleuse », le ton positif est posé dès
les premiers mots, mais est nuancé juste après par une touche de
mélancolie. La personne plus âgée qui écrit ces lignes sait que
ce merveilleux ne durera pas toute la vie. On trouve aussi deux fois
l'interpellation « ami lecteur ». Encore une fois,
c'est une formule pleine de positivisme, invitant à la confiance et
à la complicité. Le seul élément négatif, les « hommes
irrités et capricieux », est évoqué « malgré
soi », à contrecœur. Les éléments négatifs du monde,
et donc du récit, ne semblent donc pas être inhérents au
personnage, mais venir de l'extérieur. Le paragraphe se conclut sur
la mention du « Seigneur » qui semble vouloir nous
rappeler l'importance de la morale chrétienne dans l’œuvre de
Dostoïevski qui, si elle n'est pas évidente dans Les Nuits
blanches, ne sera pas à négliger.
Quand ensuite on s'intéresse à Premier Amour, les
impressions initiales sont bien différentes. Le premier paragraphe
est extrêmement court, ce qui semble être un signe évoquant le
vide intérieur du personnage :
J'associe, à tort ou à raison, mon mariage avec la mort de mon
père. Qu'il existe d'autres liens, sur d'autres plans, entre ces
deux affaires, c'est possible. Il m'est déjà difficile de dire ce
que je crois savoir.
La première chose marquante est l'association de l'idée de mariage,
rituel généralement symbole de vie, avec « la mort de mon
père ». Que peuvent avoir à faire ensemble un mariage et
un décès ? Le but semble être de dévaloriser l'idée de
mariage, de lui enlever sa dimension sacrée. Ensuite ces deux
événements sont qualifiés d' « affaires ».
Le mot pourrait convenir pour désigner pudiquement le décès mais a
une connotation bien trop neutre voir négative pour référer au
mariage, sauf bien sur si le but est justement de désenchanter
l'idée de mariage. Ainsi dès les premières phrases sont opposées
les idées de mort et de vie, et c'est la mort qui prend le dessus
grâce aux jeux de langage. L'autre élément essentiel de ce
paragraphe est la notion d'incertitude. L'irlandais s'exprime « à
tort ou à raison », il est « possible »
qu'il y ait d'autres liens, c'est « difficile à dire ».
Et pour bien insister, il indique qu'il ne sait rien mais qu'il
« croit savoir ». Cela ressemble à un exploit de
mettre autant d'incertitude en si peu de phrases. Ainsi dès le début
de chacune des deux nouvelles, le ton est posé. Chez Dostoïevski,
il reste pour le solitaire un espoir, une capacité à jouir de la
beauté du monde. Chez Beckett, il n'y a que mort et oubli.
Au delà de ces impressions initiales, on comprend au fil de leurs
confessions que ces deux personnages partagent ce qui ressemble à
une profonde anxiété sociale. Le rêveur vit dans une intense
solitude, il ne semble avoir aucun contact humain à part avec sa
bonne Matriona. Mais toute communication avec elle est impossible :
« elle se borna à me regarder étonnée et s'en retourna
sans répondre un seul mot ». Il en est même réduit à se
lier d'amitié avec des maisons. Il leur imagine une personnalité,
les salut, leur parle :
Quand je me promène, chacune a l'air de courir à ma rencontre
dans la rue : elle me regarde de toutes ses fenêtres et me dit,
ou tout comme : « Bonjour, comment allez-vous ? Moi
je vais bien, Dieu merci ! Au mois de mai on va m'ajouter un
étage ».
Ces épisodes contribuent à construire sa personnalité de rêveur.
Il n'est pas fou, il sait très bien qu'il ne parle pas vraiment aux
maisons, mais c'est pour lui un délice de l'imagination. On constate
de plus que cette solitude n'est pas totalement négative :
faute de parler à des humains, il parle à des maisons. Et elles
sont sympathiques, agréables, peut-être plus que bien des humains.
Quand aux hommes, s'il ne s'aventure pas jusqu'à leur adresser la
parole, il est loin d'exclure tout contact avec eux. Un passage en
particulier met en scène de façon particulièrement touchante ce
lien ténu mais intense. Le rêveur croise régulièrement un autre
marcheur :
Voilà pourquoi nous sommes parfois à deux doigts de nous saluer,
surtout quand nous sommes tout deux de bonne humeur. Dernièrement,
comme nous ne nous étions pas vus de deux jours entiers, le
troisième, en nous rencontrant, nous portions déjà la main à nos
chapeau, quand par bonheur nous reprîmes à temps nos esprits,
abaissâmes le bras et passâmes avec sympathie l'un à coté de
l'autre.
Malgré l'extrême isolement social, il y a pour le rêveur la
possibilité d'une forme de contact humain : la fraternité des
flâneurs. Ces hommes seuls, cachés, à la nature sensible,
appartiennent donc à un groupe flou et indistinct. La ville est le
terrain de jeu du flâneur, qui préfère être spectateur plutôt
qu'acteur, et le rêveur ne déroge pas à la règle. Mais quand les
hommes plus intégrés socialement décident d'aller passer les beaux
jours à la campagne, Saint-Pétersbourg se vide, perdant ainsi son
essence vitale qui permettait au flâneur de compenser sa solitude,
et celui-ci ressent un manque : « Soudain il
m'apparut que j'étais seul, abandonné de tous, et que tout le monde
s'écartait de moi ». Ne pouvant plus grappiller assez de
chaleur humaine dans les rues, le rêveur panique, et la vérité de
sa situation lui apparaît : « J'ai été pris de peur
à me trouver seul, et trois jours plein j'ai erré par la ville dans
un ennui profond, sans rien comprendre à ce qui m'arrivait ».
Cette fois l'illusion de la beauté du monde semble doucement
s'évanouir et le rêveur découvre « l'ennui profond ».
Malgré la vivacité de son imagination il a besoin des autres
humains pour atteindre une forme de calme, ne serait-ce que pour
pouvoir peupler ses rêves. Mais il a l'air de rester aveugle à ces
faits et c'est ce qui le rapproche du personnage de Beckett :
cette impuissance à savoir, cette condamnation à ne « rien
comprendre ».
L'irlandais est un personnage beaucoup moins torturé. Le rêveur
est une personnalité extrême parce qu'il est déchiré entre deux
extrémités : l'insurmontable désir de solitude et
l'inavouable et irréalisable désir de contact humain. L'irlandais
est extrême dans un seul sens : il s'enfonce dans la solitude,
l'indifférence et le vide. Lui n'erre pas dans une ville, observant
les vivants, mais dans un cimetière, se moquant des morts :
Oui, comme lieu de promenade, quand on est obligé de sortir,
laissez moi les cimetières et allez vous promener, vous, dans les
jardins publics, ou à la campagne. Mon sandwich, ma banane, je les
mange avec plus d’appétit assis sur une tombe, et si l'envie de
pisser me prend, et elle me prend souvent, j'ai le choix. Ou j'erre
les mains derrière le dos parmi les pierres, les droites, les
plates, les penchées, et je butine les inscriptions. Elles ne m'ont
jamais déçu, les inscriptions, il y en a toujours trois ou quatre
d'une telle drôlerie que je dois m'agripper à la croix, à la
stèle, ou à l'ange, pour ne pas tomber.
Il semble donc préférer la compagnie des morts. Et encore, c'est
quand il est « obligé de sortir ». Il
préfère habituellement rester enfermé dans sa chambre, sous ses
couvertures, voir affalé sur un banc public dans les moments où il
n'a pas de toit sous lequel se réfugier. C'est une différence
majeure avec le rêveur qui passe ses journée à se balader. Mais on
pourrait objecter que le rêveur ne sort pas de son plein gré, qu'il
y est « obligé » par la solitude et l'ennui.
Ainsi l'irlandais serait une version plus honnête, plus consciente
d'elle même, du héros de Dostoïevski. Plutôt que d'essayer de
combler sa vacuité par de vaines errances, il l’embrasse sous ses
draps, et si jamais il doit sortir, il va se la rappeler chez les
morts. Contrairement au rêveur qui apostrophait le lecteur en tant
qu' « ami », créant ainsi une proximité
avec lui, l'irlandais nous invite à aller voir ailleurs et à le
laisser tranquille. On pourrait même penser que cet encouragement à
aller se balader « à la campagne » s'adresse au
rêveur lui-même. Celui-ci va en effet gambader « entre des
champs ensemencés et des prés », c'est comme si le
personnage de Beckett le rejetait personnellement en plus de rejeter
les autres hommes en général. Avec la mention du repas et le fait
qu'il « mange avec plus d’appétit assis sur une tombe »
on a une nouvelle fois l'association d'un rituel vital et de la mort.
La nourriture pourrait être un réconfort pour le solitaire, mais il
choisit se s'en servir pour se remettre en mémoire le caractère
fragile et mortel du corps. Cette idée est renforcée par l'humour
scatologique qui suit. Pisser sur une tombe et se moquer des
épitaphes, c'est démystifier la mort, et rejeter toute l'importance
donnée aux sépultures. Quand l'irlandais doit s'« agripper
à la croix » pour ne pas tomber de rire, c'est une parodie
de la puissance divine, dont les symboles sont tout juste bons à
soutenir physiquement le blasphémateur. On est bien loin des
évocation respectueuses du « Seigneur » qu'on
trouve chez Dostoïevski.
Contrairement au rêveur qui vit seul et ne fait aucune mention
d'une éventuelle famille, l'irlandais parle de son père et de ce
qui ressemble à un foyer. Ce sont son asociabilité et son absolue
passivité qui ont conduit à son rejet :
Je leur dit, Gardez cet argent et laissez-moi continuer à vivre
ici, dans ma chambre, comme du vivant de papa. J'ajoutai, Que Dieu
ait son âme, dans l'espoir de leur faire plaisir. Mais ils n'ont pas
voulu. […] Un jour, en revenant des w.-c., je trouvai la porte de
ma chambre fermée à clef et mes affaires empilées devant la porte.
On constate que si l'irlandais désire rester dans le foyer que l'on
suppose familial, ce n'est absolument pas par attachement humain mais
par pur sens pratique : il est plus facile de rester dans sa
chambre et se faire apporter ses repas que de vivre dans la rue. Pour
ce confort il est même prêt à la manipulation, la formule de deuil
évoquant « Dieu » est en effet en parfaite
contraction avec ses rapports à la religion que l'on a pu constater
auparavant. Cela nous informe néanmoins sur la nature de sa
famille : ce sont probablement des gens à peu près normaux
comparés à lui. Ils ne font que rejeter activement celui qui les
rejette passivement et qui finalement existe à peine, sinon comme un
fardeau. L'irlandais réagit à cet abandon principalement pas un
humour scatologique. Il ne ressent aucun trouble face au rejet,
contrairement au rêveur qui en est profondément tourmenté :
Pourquoi, dites-moi, Nastenka, la conversation a-t-elle tant de
mal à s'engager entre ces deux interlocuteurs ? Pourquoi aucun
rire, aucun mot saillant ne surgit-il chez cet ami soudainement entré
et intrigué qui en toute autre circonstance aime tant le rire, et
les mots saillants, et les discours sur le beau sexe, et les autres
sujets plaisants ? […] Pourquoi enfin le visiteur saisit-il
son chapeau et s'en va-t-il rapidement, s'étant souvenu tout d'un
coup d'une affaire absolument inévitable, qui n'a jamais existé
(…) ?
Le rêveur lui aussi est donc presque incapable de se lier d'amitié
avec qui que ce soit, incapable d'avoir une conversation normale sur
des sujets normaux. Cependant il en a parfaitement conscience, chose
sur laquelle l'irlandais ne s'attarde guère. Pour lui l’asociabilité
semble aller de soi. Enfin le rêveur n'est absolument pas satisfait
par cet état des choses. Il essaie, il invite une connaissance chez
lui, il tente de communiquer, mais il échoue totalement et en
souffre : « j'ai été ainsi bouleversé et éperdu
pour toute la journée ». Le rêveur a en lui une profonde
énergie vitale impossible à concrétiser, alors que l'irlandais
semble n'avoir aucune potentialité.
•••
Ces deux personnages vont
quitter l'espace d'un instant leur profonde solitude grâce à leur
rencontre avec une femme. La scène de la rencontre est un classique
en littérature, et elle se produit le plus souvent dans un contexte
social, chose impossible pour nos héros. Leur vie est une longue
errance, une soudaine apparition dans un dîner ou une soirée ne
serait pas conforme aux personnages. Les rencontres ont donc lieu
dans la rue, dans un contexte étonnamment semblable. Chez
Dostoïevski, le rêveur rentre chez lui après une énième journée
d'errance :
Mon chemin passait par le quai
du canal, où à cette heure on ne rencontre plus âme qui vive. […]
Dans un coin, appuyée au parapet, se tenait une femme. Accoudée sur
la grille, elle semblait regarder avec beaucoup d'attention l'eau
trouble du canal. Elle avait un très joli petit chapeau jaune et une
coquette mantille noire. […] J'avais perçu un sourd sanglot. Oui !
Je ne m'étais pas trompé : la jeune fille pleurait. Une minute
plus tard, encore et encore un sanglot. O mon Dieu ! Mon cœur
se serra. J'ai beau être timide avec les femmes, le cas est
exceptionnel !...
La rencontre est parfaitement
intégrée dans la routine du personnage. Premièrement, la vision
d'un être seul, visiblement perdu dans ses pensées, ne peut que le
toucher, par identification. Ensuite, la mention de l'attention que
la jeune femme porte à l'eau du canal pourrait faire penser à une
tentative de suicide. Qui sait si elle n'est pas sur le point de se
jeter à l'eau ? La situation devient proche de l'un des
nombreux songes qui sans doute hantent le rêveur : lui, jeune
homme fougueux, sauvant une élégante jeune femme d'un moment de
détresse. Malgré ce désir qui commence à germer la lui, la
situation est encore trop ambiguë pour justifier le passage du songe
à l'action. L'excuse est fournie opportunément par un poivrot venu
importuner l'inconnue, il est donc dans les devoirs du jeune homme de
prendre sa défense. Au delà du procédé narratif fort pratique,
c'est une continuation de la réalisation d'un fantasme pour le
rêveur. Le voilà devenu un vaillant chevalier volant au secours
d'une princesse en détresse, avec son « excellente canne
noueuse » en guise d'épée. Le rêveur est parfaitement
conscient que c'est le hasard et non sa hardiesse qui lui a permis
d'aborder la jeune femme : « O monsieur malvenu, comme
je te bénissais à cet instant ! ». Le reste est
cousu de fil blanc : dans un songe, la princesse toute
tremblante se réfugierait dans les bras de son sauveur, elle
tomberait amoureuse de sa bravoure, lui de sa beauté, puis ils se
marieraient. Dans l'esprit du rêveur c'est ainsi que les choses vont
continuer, mais la réalité ne se pliera pas à ses désirs. Chez
Beckett les choses se passent sensiblement différemment :
Devant, à quelques mètres,
le canal coulait, si les canaux coulent, moi je n'en sais rien, ce
qui faisait que de ce coté là non plus je ne risquais pas d’être
surpris. Et cependant elle me surprit. […] Faites-moi une place,
dit-elle. Mon premier mouvement fut de m'en aller, mais la fatigue,
et le fait que je ne savais pas où aller, m’empêchèrent de le
suivre. Je ramenai donc un peu mes pieds sous moi et elle s'assit. Il
ne se passa rien entre nous, ce soir là, et elle s'en alla bientôt,
sans m'avoir adressé la parole.
Le
premier lien entre les deux rencontres est le lieu : un espace
public, au bord d'un canal. Le banc occupe à chaque fois une place
centrale. Chez Beckett il est mentionné dès le début car c'est un
élément important pour faire comprendre la passivité de
l'irlandais. Contrairement à son homologue russe, il ne marche pas,
il reste immobile. Chez Dostoïevski le banc est introduit un peu
plus tard, quand les deux jeunes gens commencent à éprouver de
l’intérêt l'un pour l'autre et savent qui vont avoir besoin de
s’asseoir pour parler longtemps : « Regardez,
il y a ici un banc, asseyons-nous... Personne ne passe par ici,
personne ne nous entendra et ... ».
Plus tard, le banc devient même « notre
banc »,
symbole de la relation. On peut interpréter le traitement du banc
par Beckett comme un nouveau désenchantement des symboles. Après
tout, un banc est avant tout un objet où poser un corps fatigué, ce
que l'irlandais fait à merveille. Autre lien entre les deux
rencontres, la multiplicité des rendez-vous est présente dans les
deux nouvelles. Dans Les
Nuits blanches,
le titre fait même directement référence à ces rencontres. En
quelques jours, le rêveur et Nastenka vont passer
ensemble quatre soirées. C'est pour le rêveur seulement que ce sont
des nuits blanches, car l’excitation que lui procurent ces
rencontres l'empêche de dormir. Toute l'action dure moins d'une
semaine. En revanche, chez Beckett, le contact est loin d’être
aussi immédiat. Le banc prêt du canal devient dans ce cas un lieu
de rendez-vous informel, les deux futurs amants ne communiquant
jamais assez pour prendre la décision de se revoir.
Autre différence majeure, il y a entre les récits une inversion
des dynamiques relationnelles. Dans Les Nuits blanches, c'est
le rêveur qui prend l'initiative de la relation, c'est lui qui est
le plus enthousiaste à l'idée de ce contact, mais c'est Nastenska
qui est en position dominante. C'est elle qui met des limites au
narrateur et finalement c'est elle qui décide de quand et comment la
relation prend fin. Inversement, dans Premier Amour,
l'irlandais est essentiellement passif. Il n'agit pas et c'est Lulu
qui par son insistance finit par le conquérir, si l'on peut dire.
C'est elle qui fournit le logement, c'est elle qui travaille. C'est
donc elle qui est responsable de la relation, comme l'est le rêveur,
et c'est l'irlandais qui met un terme à cette relation, comme le
fait Nastenka. L'irlandais se contente de tolérer sa compagne : «
Elle me dérangeait profondément, même absente ». C'est
Lulu qui lui court après :
Quel intérêt pouvait-elle avoir à me poursuivre ainsi ? Je le
lui demandai, sans m’asseoir, en allant et venant et en battant la
semelle. Le froid avait bosselé le chemin. Elle me répondit qu'elle
ne sait pas. Que pouvait-elle voir en moi ? Je la priai de le
dire, si elle le pouvait. Elle me répondit qu'elle ne le pouvait
pas.
Cet extrait met en avant le caractère inégalitaire de la relation.
Le terme « poursuivre » est assez éloquent,
d'autant plus que le temps est excessivement froid, il faut vraiment
que Lulu soit très motivée pour venir voir un vagabond sur un banc
exposé à toutes les intempéries. Le narrateur semble en avoir
parfaitement conscience, les deux questions posées à Lulu étant
comme des moyens de souligner la différence d’intérêt que les
deux personnages éprouvent l'un pour l'autre. Lulu ne pourrait pas
poser ce genre de question car l'irlandais n'a rien laissé
transparaître d'une éventuelle réciprocité, bien qu'a ce stade du
récit il ait informé le lecteur de ce qu'il appelle son « amour ».
Dans Les Nuits blanches, le narrateur est au contraire
tellement attiré par Nastenka que celle-ci doit le rappeler à
l’ordre :
Vous savez pourquoi je suis venue ? Bien sur, pas pour
bavarder sottement comme hier. Voilà : il nous faut dorénavant
nous conduire plus intelligemment. […] Il faut recommencer depuis
le début, parce que, en conclusion de tout, j'ai décidé
aujourd'hui que vous m’êtes encore parfaitement inconnu, que j'ai
agi hier comme un enfant, comme une fillette (…).
Cette dimension de la relation souligne le coté extrême du rêveur :
vivant dans une intense solitude, il est incapable de se contenir dès
qu'il croise quelqu’un avec qui il se sent bien. Il n'a plus de
barrières, le monde des rêves et le monde réel s’entremêlent.
Il ne lui vient pas à l'idée de faire preuve de tact. Cette naïveté
sentimentale le rend vulnérable : il affiche immédiatement son
intérêt pour Nastenka, il n'y a plus aucun mystère, plus aucun jeu
de séduction. Pour Nastenka, il est acquis et soumis, contrairement
à l'autre homme qu'elle attend depuis un an et qui est entouré
d'une aura de mystère : va-t-il revenir ? L'aime-t-il
toujours ? L'a-t-il trahie ? Comme Lulu qui poursuit le
vagabond, le rêveur poursuit Nastenka. Avec une telle dynamique
relationnelle, l'échec semble dans les deux cas être la seule
option possible.
Cette tirade de Nastenka met également en avant le fait qu'elle
n'est pas un simple accessoire dont le seul but est d'avoir un effet
sur le narrateur. Si elle à certes une place mineure comparée à
lui, elle est un personnage à part entière qui a droit à de
nombreuses pages de développement. Elle passe beaucoup de temps à
écouter le rêveur raconter sa vie, mais elle fait de même peu
après. Une partie de la seconde nuit est ainsi accordée au récit
de sa vie, et ce dernier est suffisamment important pour que
Dostoïevski fasse comme si c'était un récit inséré en mettant en
majuscule le titre « Récit de Nastenka », alors
qu'il s'agit plutôt d'une simple continuation logique du dialogue
entre les deux personnages. Si la jeune femme de dix-sept ans est
plus raisonnable que le rêveur, voyons ce qui les rapproche.
Nastenka semble être une héroïne de roman sentimental tout à fait
classique. Jeune, élégante et vertueuse, elle a été maintenue
isolée et enfermée contre sa volonté. Dans ce cas elle n'a pas été
enfermée dans la haute tour d'un château mais littéralement
attachée à sa grand-mère. Dans ce genre de situation, pour une
jeune femme sans fortune, le principal espoir de libération est le
mariage avec un homme. Natenska en est bien consciente et elle tente
donc sa chance avec le seul homme qu'elle connaît qui ait
respectueusement montré de l’intérêt pour elle :
Je fis un balluchon de toutes mes robes, de tout mon linge
nécessaire, et ce balluchon en main, ni vive ni morte, je montai
dans la mansarde trouver notre locataire. Je crois que j'ai mis une
bonne heure à monter l'escalier. Quand j'ouvris sa porte, il poussa
un cri en me voyant. Il me prenait pour un fantôme. Il courut me
chercher de l'eau, car je tenais à peine debout. Mon cœur battait
si fort que j'en avait mal à la tête, et j'en avait comme perdu la
raison.
Toute la dynamique de ce passage consiste à faire coexister la
volonté de liberté du personnage et sa vertu. En effet, s'il est
noble et courageux de prendre des risques pour se délivrer d'une
grand-mère possessive, il n'est pas très acceptable pour une jeune
femme d'aller seule un soir dans la chambre d'un homme pour s'enfuir
avec lui. Le balluchon est parfaitement symbolique de la solitude et
de l'exil, c'est la preuve des intentions nobles de Natenska. Cela
met aussi en avant sa naïveté : où croit-elle s'enfuir ainsi
avec juste quelques robes ? Comme toujours chez Dostoïevski,
les troubles de l'âme sont accompagnés de troubles physiques.
Natenska n'est « ni vive ni morte »,
elle met un temps fou pour monter l'escalier, elle tient « à
peine debout », elle a
« mal à la tête »…
Peu après elle se met à pleurer « comme une
Madeleine ». Tout cela
sert à montrer qu'elle n'est pas dans son état normal, elle a
« comme perdu la raison »,
et ainsi sa vertu est sauve. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas
très moral, elle en est terriblement confuse, c'est donc qu'elle est
morale. Dostoïevski utilise le même procédé de façon un peu plus
légère pour le locataire. Le fait qu'il pousse un cri et qu'il
prenne Nastenka pour un fantôme est révélateur de la pureté de
ses intentions : jamais il n'avait imaginé que la jeune femme
puisse venir se faufiler dans sa chambre. Lulu, l’alter-ego
beckettien de Nastenka, semble être une inversion de ce personnage.
Tout d'abord, Lulu n'a a aucun moment dans le récit l'occasion de
s'exprimer. C'est très révélateur de l’intérêt limité que lui
porte le narrateur et du leur absence de communication. Le rêveur,
en tant que narrateur lui aussi, aurait pu choisir de ne pas donner
la parole à Nastenka. S'il le fait, c'est qu'il s'intéresse
sincèrement à elle, à ce qu'elle est et à ce qu'elle dit. Lulu
utilise sa voix principalement pour chanter, et on a là une forme de
lien entre les deux personnages :
Je ne connaissais pas la chanson, je ne l'avais jamais entendue et
je ne l'entendrais jamais plus. Je me rappelle seulement qu'il y
étais question de citronniers, ou d'orangers, je ne sais plus
lesquels, et pour moi c'est un succès, d'avoir retenu qu'il était
question de citronniers ou d'orangers, car des autres chansons que
j'ai entendues dans ma vie (…) je n'en ai rien retenu du tout, pas
un mot, pas une note, ou si peu de mots, si peu de notes, que, que
quoi, que rien, cette phrase a assez duré.
Le narrateur a donc un vague
souvenir de la chanson de Lulu, c'est une amélioration par rapport à
son absence totale de mémoire habituelle. Mais cette amélioration
reste négative. Ce souvenir est très mauvais, juste un peu moins
mauvais que d'habitude. Lulu n'est pas pour l'irlandais créatrice de
positivité, elle permet juste un peu moins de négativité. Mais ce
petit passage d'espoir est rapidement balayé par la fin de la phrase
qui constitue un jeu de mots laissant l'impression que tout cela
n'est qu'une vaste blague. Cette impression est renforcée par la
perte de sens progressive de la phrase : « que,
que quoi, que rien ».
Impossible de prendre au sérieux le début de la phrase quand la fin
n'est qu'un jeu. Si Nastenka est un modèle de vertu, ce concept n'a
pas sa place chez Beckett. Lulu est une prostituée : « Alors
vous vivez de la prostitution ? dis-je . Nous vivons de la
prostitution, dit-elle. Vous ne pourriez pas leur demander de faire
un peu moins de bruit ? dis-je, comme si je croyais ce qu'elle
venait de me dire ».
L'irlandais, bien qu'habitant avec Lulu, ne connaissait pas son
métier, c'est un énième signe indiscutable de l'absence de
communication entre eux. Mais surtout, quand ils parlent, il ne la
croit pas. On peut supposer qu'il ne pense pas particulièrement
qu'elle mente, mais qu'il n'a juste aucun intérêt pour quoi que ce
soit qui la concerne. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa
tranquillité. Quand l'irlandais emploie le mot « amour »,
on peut se demander si c'est vraiment le même mot que celui que l'on
trouve dans Les Nuits blanches.
•••
Se trouvant une étable
abandonnée pour passer la saison froide, l'irlandais commence à
ressentir un sentiment imprécis, chose inhabituelle pour lui.
Cependant son amour est assez difficile à prendre au sérieux :
Oui, je l'aimais, c'est le nom
que je donnais, que je donne hélas toujours, à ce que je faisais, à
cette époque. Je n'avais pas de données là-dessus, n'ayant jamais
aimé auparavant, mais j'avais entendu parler de la chose,
naturellement, à la maison, à l'école, au bordel, à l'église, et
j'avais lu des romans, en prose et en vers, sous la direction de mon
tuteur, en anglais, en français, en italien, en allemand, où il en
était fortement question.
La première phrase de ce passage
est un aveu en apparence classique mais qui commence déjà à ne pas
être tout à fait crédible. En effet, l'action d'aimer est-elle
quelque chose que l'on fait ? Si l'on cherche à
décrypter cette phrase, on penser à l'amour physique, ou du moins à
l'amour à proximité de la personne aimée, mais l'irlandais est
tout seul. Cela peut alors être l'amour tellement intense qu'il
prend le pas sur toute autre chose, mais on ne peut imaginer ce
personnage subir des accès de mélancolie, cela ne cadre pas avec
tout le reste. La formulation étrange est ensuite en partie
expliquée par un autre aveu, celui d'une ignorance complète sur le
sujet, mais cette déclaration est plutôt créatrice de doutes. En
effet, si le lecteur pouvait soupçonner le personnage d'employer le
mot « amour » avec beaucoup de légèreté, il en
a maintenant la confirmation. La longue liste des sources du modeste
savoir du personnage ne fait que poursuivre la décrédibilisation du
sentiment. Déjà, placer le « bordel » entre
« l'école » et « l'église »,
c'est se moquer doublement de l'amour. Le bordel est l'élément le
plus marquant : ce n'est certainement pas le meilleur endroit
pour apprendre l'amour. Pourtant, l'école et l'église sont-ils de
meilleurs endroits ? Si l'on était chez Dostoïevski, l'église
le serait certainement, même si ses personnages ne s'en rendraient
pas compte. Mais chez Beckett, on ne peut imaginer l'église
autrement que comme un grand espace un peu trop froid pour vouloir y
passer l'hiver. De plus, il y a du passage et des gens qui chantent
en latin. Vraiment, on est mieux dans une étable abandonnée. Quand
à l'école, c'est en parfaite opposition avec le personnage,
puisqu'il semble poursuivre l'oubli de tout plutôt que l’acquisition
de la connaissance. Après réflexion, le bordel semble donc parmi
les trois le meilleur endroit pour apprendre l'amour. Au moins on y
apprend l'amour physique, et ce n'est pas l'église qui pourra
rivaliser. L'autre source de savoir sur l'amour, ce sont les livres.
C'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur l'irlandais : non
seulement il a eu un tuteur, mais il pouvait lire dans de nombreuses
langues, qu'il a certainement oublié depuis, sauf pour
d’occasionnelles références. Sa situation présente n'est donc
pas le fruit du hasard, on peut supposer qu'il avait toutes les
cartes en main pour au moins vivre décemment. Sa vie est donc soit
un choix soit le résultat d'une nature innée impossible à changer.
Quoi qu'il en soit, il y a quelque de comique à imaginer un tel
personnage lire des livres d'amour approuvés par un tuteur. En
effet, il n'y a rien de romanesque dans son attitude. On peut même
le visualiser en train de lire une traduction des Nuits Blanches,
récit probablement approuvé par un tuteur responsable pour sa
description d'un amour chaste et d'un contre-exemple de personnage
négatif, modèle à ne pas suivre. D'une certaine façon c'est
réussi, le rêveur ne se conduirait certainement pas ainsi :
L'amour vous rend mauvais,
c'est un fait certain. Mais de quel amour s'agissait-il, au juste ?
De l'amour passion ? Je ne le crois pas. Car c'est bien l'amour
passion le satyriaque n'est-ce pas ? Ou est-ce que je confond
avec une autre variété ? Il y en a tellement, n'est-ce pas ?
Toutes plus belles les unes que les autres, n'est-ce pas ?
L'amour platonique, par exemple, en voilà un autre qui me revient à
l'instant. C'est désintéressé. Peut-être que je l'aimais d'un
amour platonique ? J'ai du mal à le croire. Est-ce que j'aurais
tracé son nom sur de vielles merdes si je l'avais aimée d'un amour
pur et désintéressé ? Et avec mon doigt par dessus le marché,
que je suçais par la suite ?
Ce passage est un régal de
déconstruction du sentiment amoureux. La première phrase ne
démystifie pas l'amour de façon très subtile, mais elle fait
penser aux Nuits Blanches, où l'amour est plus intense et
véritable, mais où justement il est moins intéressant. On ne peut
douter de l'amour du rêveur, mais cet amour l'a-t-il rendu
meilleur ? C'est très discutable. Ainsi quand le rêveur
souffre du rejet de celle qu'il aime, « Oh ! Nastenka,
Nastenka, qu'avez-vous fait de moi ! », cette
souffrance ne le rendra pas meilleur. Il affirme à Nastenka que
« toute la vie je garderai votre souvenir », mais
ce n'est certainement pas la meilleur chose à faire. Par exemple on
ne peut douter de l'amour du jeune Werther de Goethe (que l'irlandais
a peut-être lu sous l'autorité de son tuteur), mais si cet amour
pousse a quelque chose d'aussi négatif que le suicide, on ne peut
qu'approuver l'irlandais quand il dit que l'amour rend mauvais. Le
rêveur n'ira pas aussi loin, mais presque : « Aujourd'hui,
la journée a été triste, pluvieuse, sans éclaircie, comme ma
future vieillesse ». Il prévoit un malheur futur causé
par cet amour malheureux. Où est la positivité de l'amour dans ces
conditions ? Le sentiment douteux de l'irlandais est peut-être
le plus constructif après tout. Il essaie ensuite de préciser ce
sentiment, mais aucune des hypothèses ne retient son attention,
éloignant encore la possibilité que ce qu'il ressent soit vraiment
de l'amour au sens classique du terme. Il multiplie les questions
rhétoriques au lecteur, ce qui crée un effet comique car il est peu
probable que le lecteur puisse éprouver une impression
d'identification. Cet effet culmine dans les deux dernières phrases,
quand apparaît la bouse de vache. Il y a plusieurs effets comiques.
Tout d'abord, le simple fait de formuler cette idée sous forme de
question au lecteur. Ce dernier n'a probablement pas beaucoup
d'expérience sur la question. Ensuite, associer le nom de la femme
aimée à une bouse de vache. C'est une parodie d'un classique
amoureux, du beau papier ou un tissu de luxe seraient plus
appropriés. Troisième effet, le fait que la question porte sur
« l'amour platonique » en particulier. C'est censé
être un amour élevé, loin de tout ce qui est corporel. Or quoi de
moins élevé et corporel qu'une bouse de vache ?
On constate donc que les visions
de l'amour dans les deux récits n'ont rien à voir, mais que
paradoxalement c'est l'amour le plus véritable qui a les effets les
plus négatifs. Pourtant, si l'irlandais semble totalement figé dans
son immobilité, il y a toujours chez Dostoïevski une possibilité
de rédemption. La figure féminine, comme dans Crime et Châtiment
par exemple, est l'instrument divin de cet élan positif :
« Écoutez-moi, mais savez-vous que ce n'est pas bien du
tout de vivre comme ça ? ». Le rêveur est
partiellement réceptif à cet appel :
Je sais, Nastenka, je sais !
m'écriai-je sans plus retenir mon sentiment. Et maintenant je sais
mieux que jamais que j'ai perdu en pure perte toutes mes meilleurs
années ! Maintenant je le sais, et j'en ai plus cruellement
conscience depuis que Dieu vous a envoyé à moi, vous mon bon ange,
pour me le dire et me le prouver. Maintenant que je suis assis auprès
de vous et que je vous parle, j'ai peur de penser à l'avenir, car
dans l'avenir c'est encore la solitude, encore cette vie inutile,
renfermée...
La première étape sur le chemin
de la rédemption est la prise de conscience des erreurs passées.
Avec l'aide de Nastenka, c'est chose possible pour le rêveur.
Rejeter sa vie, c'est une forme de suicide, un péché très grave.
Cependant il ne parvient pas à franchir la seconde étape : le
changement. Il semble englué dans sa vie de solitaire, incapable
d'en sortir, comme poussé par une force supérieure à lui. Est-ce
la voix du diable ? C'est possible, le rêveur indiquant peu de
temps avant sentir s'éveiller en lui « un diablotin
ennemi ». En proie à de telles tensions entre deux forces
contraires, quelle est la place pour l'amour ? Nastenka semble
plus que jamais être un amour impossible puisqu'elle est un « bon
ange ». Or est-il possible d'aimer un ange d'un amour
terrestre ? Probablement pas. En imprimant sa vision chrétienne
sur la jeune femme, il se coupe d'elle. Il la rend céleste alors que
lui reste sur terre. Du coté de Beckett, l'irlandais n'a pas ce
genre de problème. La relation qu'il a avec Lulu n'a certainement
rien de platonique, comme la bouse de vache nous l'avait appris.
C'est très clair dès le début de leur semblant de relation, avec
une longue dissertation sur l’érection : « Mais à
vingt-cinq ans il bande encore, l'homme moderne, physiquement aussi,
de temps en temps, c'est le lot de chacun, moi même je n'y coupais
pas, si on peut appeler ça bander ». Même le plaisir
physique ne trouve pas grâce aux yeux de l'irlandais. Non seulement
même quelque chose d'aussi terre à terre qu'une érection semble ne
pas pouvoir être une réussite, mais cela ressemble plus à une
malédiction. Y a-t-il quoi ce soit qui ait une once de positivité
pour cet homme ? Probablement pas, si ce n'est peut-être ce
qu'il appelle son « amour » passager.
On peut voir dans la façon dont
se terminent ces deux histoires d'amour un bon résumé de la nature
des textes. L'irlandais fuit en cachette, parce qu'il y a trop de
bruit dans la maison. Il fuit plus particulièrement la naissance
d'un enfant, de son enfant. C'est sa négation finale de toute
vie, de tout ce qui tend vers le plus et pas vers le moins. Même
cette fuite ne peut se faire sans humour désenchanteur : « Cela
me faisait mal au cœur, de quitter une maison sans qu'on me mît
dehors ». C'est comme si fuir la naissance de son enfant
n'était pas assez négatif à son goût, il aurait voulu ressentir
une hostilité active envers lui. Au contraire, malgré son amour
frustré dont il n'arrive pas à faire le deuil, le rêveur éprouve
quinze ans après les événements une certaine reconnaissance.
Ainsi, s'adressant au souvenir qu'il a de la jeune femme :
Que ton ciel soit lumineux,
que soit clair et serein ton gentil sourire, et bénie sois-tu
toi-même pour la minute de félicité et de bonheur que tu as donnée
à un autre cœur solitaire, reconnaissant !
O mon Dieu ! une minute
entière de félicité ! Mais n'est-ce pas assez pour toute une
vie d'homme ?...
Le rêveur reste solitaire et
isolé. Comme l'irlandais, il n'a finalement pas changé grand chose
à sa situation. Mais contrairement à lui il en retire quelque chose
d'intensément positif : la certitude, à moment de sa vie,
d'avoir été heureux.
•••
Les
personnages de Dostoïevski et de Beckett ont en commun cette absence
de lien social si forte qu'ils n'ont même pas besoin de noms. En
revanche, il y a entre eux un fossé dans leur nature profonde. Le
rêveur est plein d'énergie et de désirs, il tente d'aller vers les
autres. L'irlandais au contraire est comme un cadavre ambulant
seulement animé par l'humour scatologique. Les rencontres amoureuses
des deux personnages sont assez semblables, bien que la dynamique des
relations qui vont se former soit opposées : le rêveur va avec
insistance vers une Nastenka plus réservée, et l'irlandais se fait
poursuivre par Lulu. Les personnages féminins semblent être chacune
une vision inversée de l'autre. Ce que les deux héros appellent
« l'amour » semble n’être pas du tout la même chose,
celui de l'irlandais étant une pâle ombre de celui du rêveur, voir
une parodie. Bien que les deux relations soient des échecs, seul le
rêveur, qui contrairement à l'irlandais a subi le rejet, semble en
tirer quelque chose de positif. C'est symbolique de la nature
profonde des deux personnages et de la vision de la vie que laissent
transparaître les œuvres des auteurs. Chez Dostoïevski, les hommes
sont d'une intensité remarquable. Même quand ce sont des
misérables, ce sont des misérables magnifiques, habités par une
force qui les pousse toujours plus loin. Chez Beckett, rien de tout
cela. Ce qui marque, c'est l'absence. Le chaînon manquant entre les
deux univers semble pouvoir se trouver dans Le
Sous-sol
de Dostoïevski, récit tout juste antérieur à ses grands romans
mettant un scène un homme embrassant vraiment de tout cœur le
négatif et la passivité, comme l'irlandais. Mais, en tant que
personnage dostoïevskien, on ne peux lui enlever cet intense énergie
qui le pousse activement vers les recoins les plus sombres :
« La fin
des fins, messieurs,
dit-il, c'est de
rien faire du tout. L'inertie contemplative est préférable à quoi
que ce soit. Ainsi donc, vive le sous-sol ! ».
Éditions utilisées :
Dostoïevski, Les Nuits blanches & Le Sous-sol,
Gallimard Folio classique
Beckett, Premier Amour, Les éditions de minuit
Libellés :
Beckett Samuel,
Dostoïevski,
Littérature,
Mes p'tits essais,
Univers réaliste
lundi 22 août 2016
Il est difficile d'être un dieu - Arkadi & Boris Strougatski
Un roman qui fait beaucoup penser à la Culture de Iain M. Banks. Sur une planète moyenâgeuse, les terriens ont, comme sur bien d'autres mondes du même genre, quelques centaines d'observateurs planqués un peu partout dans la société. Ces quelques personnes semblent vivre le rêve de tout historien : assister au déroulement de l'Histoire en direct, pouvoir en faire partie, la comprendre et la documenter de l'intérieur. Mais, loin de la sécurité des livres, ces historiens doivent faire face à la dure réalité d'une civilisation qui leur semble ne même pas pouvoir porter ce nom, peuplée de brutes ignorantes, égoïstes et violentes. Et pas question d’interférer dans l'Histoire locale, les conséquences d'un tel idéalisme pourraient se révéler bien pires que le déroulement naturel des choses. Et pourtant, c'est tentant ! Roumata, faux noble à la cour d'un souverain obscurantiste, se sent si puissant. Avec tout l'héritage d'un millier d'années de progrès supplémentaires, il est comme un dieu. Il serait si facile d'annihiler les leaders, de prendre leur place et de lancer ce monde sur la brillante voie du savoir et de la justice...
Il est difficile d'être un dieu est une exploration de ce concept. C'est un roman très sombre, dans lequel toute la bonne volonté imaginable semble impuissante face à l'inertie des peuples. On y perçoit le temps d'une façon particulièrement intense, avec une certaine fatalité. Le progrès ne peut pas être injecté de l'extérieur, mais doit venir d'une lente maturation intérieure. Les Strougatski ne tiennent pas leur lecteur par la main, les choses ne sont pas expliquées clairement, et c'est petit à petit que l'on comprend la situation (sauf si le lecteur en question vient de lire la quatrième de couverture...). L’utopie terrestre restera ainsi dans l'ombre, seuls certains indices lui donnent un visage à tendance communiste. Le tout ne manque pas de rythme ni d'humour, et les quelques personnages frustres mais bienveillants auquel Roumata s'attache en sont souvent la cause, précurseurs maladroits d'un potentiel futur moins sauvage. Un livre étonnant qui, en s'intéressant au futur à travers un monde venu du passé, a merveilleusement bien passé l'épreuve du temps.
290 pages, 1964, folio sf
Libellés :
Littérature,
Science fiction,
Strougatski Arkadi et Boris
vendredi 19 août 2016
Arthur C. Clarke : genèse de 2001 L’odyssée de l'Espace à travers la nouvelle La Sentinelle
Juste un papier écrit pour la fac qui, je crois, n'est pas trop mauvais, du coup je le stocke ici avant qu'il ne disparaisse quand mon pc rendra l’âme sans prévenir. Hop.
Le roman
2001 L’odyssée de l'Espace n'existerait
pas sans Stanley Kubrick. En effet, le réalisateur, décidé à
faire un film de science fiction, prend contact au printemps 1964
avec Arthur C. Clarke, considéré à l'époque comme une référence
du genre en littérature. Ensemble, les deux hommes vont créer une
histoire qu'ils adapteront chacun dans leur média de prédilection.
Clarke indique dans la préface à 2010 Odyssée Deux
que « les deux projets ont été menés de front,
chacun venant influencer l'autre ».
C'est ainsi qu'en 1968 verront le jour le film et le roman qui
partagent le même nom et la même trame globale, même si de
nombreux détails diffèrent. Clarke est crédité avec Kubrick comme
co-scénariste du film, et ce dernier, dont le nom ne figure pas dans
le livre, si ce n'est dans la dédicace « à
Stanley », a eu un rôle
essentiel dans sa création. Il ne s'agira pas ici de savoir qui est
à l'origine de quoi, mais d'explorer les liens entre le roman et une
nouvelle de Clarke écrite en 1948, La Sentinelle.
Ce court récit est en effet un véritable prototype de 2001
et semble déjà en contenir
l'essence. On peut trouver dans d'autres nouvelles de Clarke des
signes précurseurs du roman à venir, mais nous essaierons de
montrer en quoi cette nouvelle est particulièrement intéressante.
Commençons par un
résumé des œuvres pour montrer les liens les plus évidents entre
la nouvelle et le roman. 2001
s'ouvre sur une scène préhistorique. Une tribu d' « hommes
singes » fait la rencontre
d'un monolithe venu de l'espace qui, après quelques expériences,
tente d’insuffler à ces créatures un commencement d'intelligence.
Il est clairement indiqué que de nombreux monolithes se livrent à
des activités similaires partout sur la Terre. L’artefact retourne
d'où il est venu après avoir accompli sa mission avec succès.
Séquence suivante, cette fois dans un futur proche. Un scientifique
se dirige d'urgence vers la base que l'humanité a installé sur la
lune. On apprend qu'un étrange monolithe noir a été découvert
dans le sol lunaire, un objet vieux de trois millions d'années
manifestement créé par une intelligence inconnue. Une fois mis au
jour, le monolithe envoie un puissant signal vers les étoiles. Les
hommes savent désormais qu'ils ne sont pas seuls, et de nombreuses
spéculations quant à la nature de ces autres êtres intelligents
ponctuent le roman à partir de ce point. Le lecteur suivra ensuite
le vaisseau d’exploration Explorateur 1 (Discovery One en version
originale) parti en mission vers Japet, lune de Saturne, qui semble
avoir été le point visé par le signal émit par le monolithe.
Après quelques déboires avec l'intelligence artificielle du
vaisseau, David Bowman, seul survivant de l'expédition, découvre
sur Japet un autre monolithe. Il sera transporté très loin dans
l'espace par des forces dépassant les capacités de compréhension
humaine, rencontrera une intelligence extraterrestre bien plus
avancée que l'Homme sur la longue route de l'évolution, et
retournera à proximité de la Terre en étant devenu un être plus
proche du dieu que de l'humain. La Sentinelle
étant une nouvelle, son échelle est bien plus limitée. Dans ce
récit, lors d'une exploration de routine de la lune, le narrateur
découvre un artefact en forme de pyramide qui apparaît clairement
comme étant un objet extraterrestre extrêmement ancien mais
pourtant parfaitement conservé. Le narrateur se livre ensuite à des
conjectures quand à la nature de la pyramide et des êtres qui l'ont
construite. Les deux récits impliquent donc la découverte d'un
objet mystérieux sur la lune et diverses réflexions sur la nature
de l'intelligence et de son évolution à travers le temps. Nous
essaierons de détailler ces liens de façon progressive, en
commençant par les éléments plus anecdotiques pour aller vers les
grandes idées structurelles.
A l'origine du projet,
la création commune de Kubrick et de Clarke avait pour titre
« Journey Beyond the Stars ».
Le titre final a le mérite d’être moins générique tout en
reprenant explicitement la thématique du grand voyage en renvoyant à
L'odyssée d'Homère.
La nouvelle La Sentinelle
se déroule à la « fin de l'été 1996 ».
C'est une date très proche de celle à laquelle se passe le roman,
mais on comprend que 1996 L'odyssée de l'Espace
aurait été un titre moins percutant que 2001,
qui symbolise l'entrée dans nouveau millénaire, un nouveau départ
pour l'humanité, une ère où tout semble possible (du moins en se
replaçant dans le contexte des années soixante). Le titre original
de la nouvelle avait un sens plus concret, en rapport direct avec son
contenu. Mais on ne peut comprendre ce qu'est cette sentinelle qu'une
fois le récit lu. Au contraire, un titre comme 2001
L’odyssée de l'Espace
véhicule avec succès des idées générales indiquant clairement la
nature de l’œuvre : dans un futur suffisamment proche pour
qu'on se sente concerné mais suffisamment éloigné pour que tout
soit possible, l'homme part explorer l'espace. La date choisie a donc
une fonction symbolique tout en donnant trois décennies à
l'écrivain pour rendre crédible les progrès scientifiques qu'il
lui plaira de mettre en scène.
La nouvelle et le roman partagent un lieu capital :
la lune. Si l'intégralité de La Sentinelle y prend place,
dans 2001, la lune n'est qu'un lieu de passage. En effet, à
l'époque de rédaction du roman (1964-1968), le satellite est
presque conquis, l’Homme s’apprête à y poser le pied. Pour que
le récit reste pertinent sur le long terme et offre un sentiment de
plongée vers l'inconnu, il importe donc de faire voyager le lecteur
plus loin que ce que la réalité offrira sous peu. On constate de
nombreux points communs dans la description du satellite. Ainsi, dans
la nouvelle de 1948, l'exploration lunaire est décrite comme étant
« une routine assommante » ne présentant « aucun
caractère périlleux ou même excitant ». On retrouve cet
aspect dans 2001, où les voyages Terre-lune ne semblent
qu'une formalité, la base lunaire ressemblant à une véritable
petite ville dans laquelle vivent même des enfants ne connaissant la
Terre que de réputation. Les moyens de déplacement sur le sol
lunaire se ressemblent aussi beaucoup. Dans la nouvelle le véhicule
d'exploration dans lequel « tout est si banal, si familier,
à l'exception de la sensation de légèreté et de la lenteur
insolite à laquelle tombent les objets » ressemble à une
maison croisée avec un tracteur à chenilles. Dans 2001, les
personnages utilisent un « laboratoire mobile »,
« une véritable base autonome dans laquelle vingt hommes
pouvaient vivre et travailler durant plusieurs semaines ».
On constate cependant une amélioration notable par rapport au
véhicule de la nouvelle : celui-ci dispose de fusées et est en
fait « une sorte d'astronef qui se déplaçait au sol et
pouvait décoller en cas de besoin ». Si les progrès
technologiques font évoluer les moyens de transport, ils ne changent
pas les paysages lunaires. Ceux-ci, dans La Sentinelle, sont
décrits comme emplis de « terrifiantes montagnes, bien plus
acérées que les douces collines de la Terre » et de
« murailles montagneuses ». Dans 2001, ce
« paysage pétrifié » débordant de « pics
acérés » reste le même. Il est agrémenté d'un détail
frappant l'imagination : le clair de Terre. Déjà évoqué dans
la nouvelle, « le croissant de la Terre, blotti dans berceau
d'étoiles » prend une dimension nouvelle dans 2001.
Notre planète y « était des dizaines de fois plus
brillante que la pleine lune et recouvrait le paysage d'une froide
clarté bleu-vert », agissant comme un phare rappelant leur
origine à tous les humains de l'ère spatiale.
On trouve dans la vision de la lune des deux textes une
différence majeure : la vie. En 1948, l'idée que la lune
pouvait un jour avoir abrité quelques formes de vie semblait
acceptable. Le narrateur ne cesse de mentionner la présence massive
d'eau liquide sur la lune comme si elle allait de soi :
Nous avions déjà parcouru un peu moins de deux cents
kilomètres en une semaine, contournant les contreforts des montagnes
qui bordaient le rivage de ce qui, quelques millions d'années
auparavant, avait été une mer. Lorsque la vie en était sur Terre à
ses premiers balbutiements, ici, elle s’éteignait déjà. Les
flots se retiraient des flancs de ces formidables falaises pour
s’abîmer dans le cœur béant de la lune. Sur le sol même que
nous foulions, l'océan sans marée avait jadis atteint près d'un
kilomètre de profondeur.
Si pour lui les Mare de la lune étaient
autrefois de véritables mers, la présence de vie fait sens. Les
scientifiques, dont lui-même, sont persuadés que « les
seules créatures qui eussent jamais existé ici étaient quelques
plantes primaires et leurs ancêtres, à peine moins dégénérés ».
Ainsi on peut comprendre qu'en se retrouvant face à l’artefact
pyramidal, la principale hypothèse du narrateur soit celle d'une
civilisation lunaire. Pour lui, c'est une remise en cause de ses
conceptions, car il n'envisageait pas la vie intelligente sur la
lune, mais cela reste crédible, car il était déjà convaincu de
la présence d'eau liquide et de vie végétale dans le passé du
satellite. Son processus de pensée est progressif. Dans un premier
temps, il est envahi par une « étrange euphorie »
car il sait à présent qu'a bel et bien existé une « civilisation
lunaire ». Puis, petit à petit, constatant notamment que
la pyramide est totalement vierge de « poussière
cosmique » et d'impacts de météores, contrairement au
sol lunaire à coté d'elle, « comme si un mur invisible la
protégeait des ravages du temps », la vérité se fraie
un chemin dans son esprit. En revanche, dans 2001, il n'y a
jamais d’ambiguïté. La première partie du roman mettant en
scène quelques millions d'années plus tôt les confrères du
monolithe lunaire, il n'est pas question de surprise pour le
lecteur : il sait parfaitement que ses créateurs dépassent de
loin l'intelligence humaine et viennent d'un lieu bien plus éloigné
que la lune. Ainsi, si les hypothèses évoquées dans 2001 à
propos des extraterrestres ne manquent pas, elles partent toutes de
ces bases.
La façon dont est découvert l’artefact est
également représentative d'un progrès entre les deux textes. Dans
La Sentinelle, c'est la façon la plus primaire qui soit :
la vue. Un reflet étrange aperçu de loin et une personnalité
curieuse, on comprend qu'il s'agit d'un hasard. Il aurait été
possible que, dans toute l'Histoire à venir, jamais personne ne
passe dans ce coin stérile de lune. Dans 2001, le monolithe
est enfoui sous plusieurs mètres de sol lunaire, toute détection
par la vue est donc impossible. C'est par un moyen plus complexe que
la découverte sera faite : « l'exploration magnétique
de cette région à partir d'un satellite placé en orbite basse ».
Suite à la détection d'une déconcertante anomalie magnétique, une
équipe est envoyée sur place pour découvrir l'origine de cette
perturbation. Le premier constat que l'on peut faire sur ce
changement est celui de la mise en scène du progrès technologique.
Il est plus crédible que dans des environnements aussi vastes les
découvertes se fassent par le biais d'outils automatisés que par
les très limités sens humains. Ensuite, cela change complètement
les rôles possibles de l’artefact. S'il est discrètement posé
dans un coin, cela implique qu'il pourrait avoir été créé sans
prendre en compte sa possible découverte par une jeune espèce à
l'intelligence naissante comme l'humanité. Si, en revanche, il est
caché tout en émettant un signal identifiable, cela pourrait
signifier qu'il avait pour but d’être découvert. Pas trop tôt,
quand une jeune espèce ne pourrait compter que sur sa vue, mais
immanquablement quand elle commencerait à faire des recherches à
grande échelle impliquant un certain niveau technologique. On voit
donc que dans 2001 la façon dont est découvert le monolithe
est un élément capital de tout le récit à venir puisqu'il est
explicite qu'il avait pour but d’être trouvé.
Continuons sur la nature de l’artefact lunaire. Une
différence majeure entre la vision de la nouvelle et celle du roman
concerne la forme de l'objet. De « grossièrement
pyramidal », faisant « deux fois la hauteur d'un
homme », il devient « un bloc de matière noire,
dressé verticalement » et « parfaitement
symétrique » d'environ trois mètres. Premier constat, il
n'y a pas dans le monolithe de 2001 quoi que ce soit de
« grossier ». Au contraire, il est la perfection
incarnée. Après beaucoup d'analyses, il est même établi que le
rapport entre la hauteur, la largeur et l'épaisseur du monolithe est
de « 1 – 4 – 9, ce qui correspond au carré des trois
premiers nombres entiers », rapport qui se maintient
« jusqu'aux limites du mesurable ». Si ces détails
géométriques ne peuvent être compris, ils contribuent à donner à
l'objet une aura de supériorité mystique, comme si ses créateurs
avaient découvert une vérité mathématique imperceptible pour les
humains. De plus, on peut remarquer qu'un monolithe possède trois
axes de symétrie alors qu'une pyramide n'en a que deux, rapprochant
ainsi l’artefact d'une sorte d'idéal géométrique. Mais le
véritable sens de ce changement de forme pourrait être bien
différent. Le fait est que le marché de la pyramide était déjà
complètement saturé par l’Égypte antique. Le narrateur de La
Sentinelle, une fois sa découverte faite, ne manque pas de faire
le rapprochement : « les Égyptiens auraient pu le
faire, pensai-je, si leurs artisans avaient possédés des outils
identiques à ceux qu'avaient utilisés ces architectes biens plus
anciens ». Il est possible que ce soit le développement du
film en parallèle du roman qui soit à l'origine de ce changement.
Plus encore que le roman, le cinéma a besoin de visuels iconiques.
Une pyramide ancrerait dans l'esprit des spectateurs des
rapprochements qui pourraient nuire à leur perception du film. La
forme du monolithe était beaucoup plus disponible, encore neutre. Ce
qui, grâce à Clarke et Kubrick, n'est plus le cas aujourd'hui.
Quand par exemple Christopher Nolan dans Interstellar donne à
ses intelligences artificielles des corps qui ont la forme de
monolithes noirs, ce n'est pas innocent. La figure du monolithe,
comme celle de la pyramide avant elle, est désormais chargée d'un
puissant héritage.
L’artefact a changé et avec lui les méthodes
d'investigation humaine. Dans La Sentinelle, les méthodes
employées sont assez brutales :
Il nous a fallu vingt ans pour briser ce bouclier
invisible et atteindre la machine dissimulée à l'intérieur de ces
murs de cristal. Ce que nous ne pouvions comprendre, nous l'avons
détruit avec la puissance sauvage de l'arme atomique, et j'ai vu les
fragments du bel objet brillant que j'avais découvert, là-haut, sur
la montagne.
La technique d'ouverture de l'objet est ancrée dans le
contexte de rédaction, quand l'explosion des bombes atomiques dans
le ciel japonais ne datait que de quelques années et que la menace
de la guerre froide faisait ses débuts. Il faut reconnaître aux
scientifiques de Clarke d'avoir eu pendant vingt ans la patience de
tenter d'autres possibilités, mais aucune n'est mentionnée.
L'artefact semble donc particulièrement coriace, mais s'il a été
capable de résister aux forces de la nature pendant des centaines de
millions d'années, ne peut-on pas supposer qu'il pourrait également
supporter une petite explosion atomique ? Dans 2001, de
nombreux moyens plus subtils sont envisagés :
Jusqu'à présent, le bloc noir avait résisté à
toutes les tentatives de Michaels et de ses collègues pour prélever
des échantillons. Ils ne doutaient pas qu'un rayon laser put en
venir à bout – rien ne résistait à une telle concentration
d'énergie – mais la décision d'employer un moyen si radical
revenait à Floyd. D'ors et déjà, il était déterminé à essayer
les rayons X, les ultra-sons, les faisceaux ne neutrons et autres
moyens avant d'en venir au laser. C'était le propre du barbare de
détruire ce qu'il ne pouvait comprendre (…).
Cette fois la narration n'attendra pas vingt ans pour
donner les résultats de ces expériences, mais on peut les deviner.
Il est probable que ce déchaînement de technologie ne donne aucun
résultat. On peut supposer que cela correspond aux vingt ans de
recherches infructueuses qui sont évoquées dans La Sentinelle et
que les chercheurs de 2001 n'auront pas plus de succès.
Peut-être finiront-ils eux aussi par utiliser des moyens
destructeurs. Et même si l'arme atomique ou le laser parviennent à
ouvrir l'artefact, cela ne mènerait pas à grand chose, comme on
l'apprend dans la nouvelle : « les mécanismes – si
mécanisme il y a – de la pyramide appartiennent à une technologie
hors de notre portée ». Et en conséquence, pour
l'humanité, « ils n'ont aucun sens ». Ce serait
le cas aussi dans 2001, peu importe ce qui se trouve à
l'intérieur du monolithe, ce qu'il importe de savoir c'est que ce
serait certainement incompréhensible. Le récit peut donc
progresser, l'homme peut envoyer un vaisseau d'exploration vers
Japet, sans que l’énigme du monolithe ne paraisse irrésolue.
Ces vingt années de recherche, qui représentent une
partie non négligeable d'une vie humaine, ne sont pas grand chose à
l'échelle des intelligences à l'origine de l'artefact. Pourtant,
entre les deux récits, cette échelle a changé de façon
significative. Dans La Sentinelle, il est possible de
déterminer l'âge de la pyramide à partir de « l'épaisseur
de la poussière de météorite accumulée sur le plateau »
qu'elle occupe. Les résultats sont assez impressionnants :
« elle a été érigée à cet endroit avant même que la
vie n'émerge des océans terrestres ». Ce qui nous amène
à environ quatre cent millions d'années dans le passé de notre
planète, voire bien plus. Ce sont aussi les minéraux lunaires
environnants qui permettent de dater le monolithe dans 2001 :
« nous sommes en mesure de le dater avec précision par
rapport au site géologique ». Le monolithe a trois
millions d'années, ce qui le rend bien plus jeune que son confrère
pyramidal. Pourquoi une telle différence? On peut voir dans ce
changement d'échelle une tentative de rester crédible. Dans La
Sentinelle, les humains ne vont pas jusqu'au stade du premier
contact, événement qui arrive en revanche dans 2001. Trois
millions d'années, à l'échelle humaine, c'est énorme. Mais à
l'échelle de l'univers, ce n'est pas grand chose. L'idée que
certaines formes de vie puissent se maintenir reste acceptable, tout
en donnant à ces créatures un âge impressionnant qui laisse à
l'écrivain toute liberté pour imaginer leur évolution. Mais quatre
cent millions d'années représentent une portion non négligeable de
l'âge de l'univers. C'est peut-être simplement trop, ainsi cette
durée aurait été revue à la baisse pour rendre crédible une
rencontre avec les créateurs de l'artefact.
Ce changement a une autre conséquence : modifier
radicalement le rôle de ces intelligences extraterrestres. Le fait
que ce soit elles qui soient à l'origine de l'évolution humaine est
au cœur de 2001, et leur date d'arrivée dans le système
solaire en est un élément clé. Quelques millions d'années plus
tôt, et il n'y aurait peut-être pas eu sur Terre d'espèce
susceptible de recevoir le don de l'intelligence, et quelques
millions d'années plus tard, nos ancêtres auraient pu disparaître
sans avoir eu l'occasion de développer leur potentiel. Dans La
Sentinelle, il n'est jamais indiqué que ces entités puissent
être intervenues pour modifier la destinée de la Terre :
Ces voyageurs ont dû regarder la Terre, gravitant dans
l'étroite zone de sécurité comprise entre le feu et la glace. De
tous les enfants du soleil, ils devinèrent qu'elle était la
favorite. Là, dans un lointain futur, surgirait l'intelligence ;
mais d'innombrables étoiles les attendaient, et sans doute ne
reviendraient-ils jamais de ce coté. Alors, ils laissèrent une
sentinelle, une parmi les millions qu'ils ont dispersées à travers
l'Univers, veillant sur tous les mondes où existait une promesse de
vie.
Ici,
ils ne sont que témoins. Une fois que la sentinelle aura révélé
sa découverte, leur intervention est probable, mais cette
potentielle rencontre est laissée à l'imagination du lecteur.
Pourtant, est-ce un hasard si ces entités sont arrivées « avant
même que la vie n'émerge des océans terrestres » ?
Il est indiqué qu'elles ont été capables de percevoir l’immense
potentiel des organismes primaires habitant les mers. Mais peut-être
est-il possible que, comme dans 2001,
elles n'aient pas été simples spectatrices ? Peut-être
sont-elles intervenues, poussant une poignée de végétaux
à quitter le confort marin pour s'aventurer sur les plages, et
ensuite des créatures plus complexes, d'abord quelques instants
puis, au fil des millénaires, de plus en plus longtemps. Cette
hypothèse n'est jamais évoquée directement, mais n'oublions pas
que le récit est conté par un narrateur qui a déjà vu sa
conception du monde complétement chamboulée. On peut le supposer
incapable de faire ce pas supplémentaire vers l'inconcevable, Clarke
laissant ainsi au lecteur la possibilité de se faire ses propres
opinions. Il est également possible que cette théorie n'ait pas du
tout été prévue par l'auteur sur le coup et que ce ne soit que
plus tard, quand un réalisateur de talent vient le consulter,
partant en quête d'idées, que Clarke se soit souvenu des
possibilités entraperçues mais non explorées dans La
Sentinelle.
Passant de spectateurs à créateurs, les intelligences
extraterrestres se voient donc offrir une nature différente. Voici
un extrait des traits que leur donne l'imagination du narrateur dans
la nouvelle :
Prêt de cent mille millions d'étoiles gravitent dans
le cercle de la Voie lactée, et longtemps auparavant, d'autres
races, sur les mondes d'autres soleils, ont dû gravir et dépasser
les sommets que nous avons atteints. Songez à ces civilisations, se
profilant loin dans le temps contre les dernières lueurs déclinantes
de la Création, maîtresses d'un univers si jeune que la vie n'avait
encore effleuré qu'une poignée de mondes. Leur solitude devait être
inimaginable, la solitude des dieux scrutant l'infini, sans y trouver
personne qui pût partager leurs pensées.
Chose surprenante, le narrateur semble faire preuve de
compassion envers ces « dieux scrutant l'infini ».
Ce sentiment semble un peu hors de propos, et l'on pourrait peut-être
imaginer l'inverse, c'est à dire ces entités éprouver de la
compassion pour une race aussi primitive que l'humanité. Ou supposer
que le concept même de compassion ne pourrait pas s’appliquer à
ces êtres. Quoi qu'il en soit, on ne retrouve pas d'idée similaire
dans 2001. En revanche on y retrouve le terme de « dieux »,
et de façon peut-être plus justifiée. En effet, dans La
Sentinelle, ces entités n'ont pas d'autre caractéristique
divine qu'un énorme avantage technologique. Dans ce cas une race
divine n'est qu'une race plus avancée sur la route de l'évolution
qu'une autre. Cette situation peut donner l'illusion de la divinité,
comme des humains d'aujourd'hui pourraient, avec quelques armes
modernes, se faire passer pour des dieux s'ils rencontraient des
hommes préhistoriques. Dans ce cas la caractéristique divine ne
peut apparaître qu'en comparaison à une race plus jeune. Quand le
narrateur imagine ces dieux seuls dans l'univers, c'est de son point
de vue. Mais du point de vue de ces créatures, si elles sont seules,
il ne peut y avoir de tels concepts puisque leur stade de
développement leur apparaîtrait normal. Un univers peuplé de dieux
est un univers sans dieu. Dans 2001 le mot est parfois utilisé
dans un sens proche, notamment quand est développée l'hypothèse
d'une évolution commençant par la chair, puis la chair créant la
machine, l'esprit se libérant de la chair pour migrer dans la
machine, et enfin l'esprit se libérant de tout support physique.
Alors « ce qui se trouvait au-delà ne pouvait avoir qu'un
seul nom : Dieu ». On retrouve donc la même idée
d'un dieu étant le stade ultime de l'évolution naturelle. Mais les
dieux de 2001 ont un trait supplémentaire : ce sont des
cultivateurs d'intelligence. S'ils ne créent pas la vie, ils la
modèlent selon leurs idéaux. On se rapproche là d'une capacité
démiurgique, donnant aux entités de 2001 un statut plus
clairement divin que celles de La Sentinelle.
Une fois ces « dieux » identifiés,
il ne reste plus qu'à les rencontrer. Voyons comment ce premier
contact est envisagé à la fin de la nouvelle :
A présent, (…) ceux qui sont investis de cette
fonction vont se tourner vers la Terre. Peut-être désirent-ils
aider notre civilisation naissante, mais ils doivent être très,
très vieux, et souvent les vieux éprouvent à l'égard de leurs
cadets une jalousie insensée. Je ne peux plus contempler la Voix
lactée sans me demander duquel de ces nuages d'étoiles surgiront
les émissaires. Si vous voulez bien me pardonner un tel cliché, je
dirais que nous avons tiré la sonnette d'alarme et qu'il ne nous
reste plus qu'à attendre. Et notre attente sera de courte durée,
j'en suis certain.
On retrouve dans 2001 cette incertitude
concernant les intentions des entités : « actuellement,
nous ne savons pas s'il convient d'espérer ou de craindre ».
Mais les personnages du roman s’interrogent également sur les
conséquences que pourrait avoir une telle rencontre sur la société
humaine : « ainsi que l'histoire de notre monde nous
l'a souvent prouvé, les races primitives, en général, n'ont pas
survécu à la rencontre avec des civilisations supérieures ».
Bien que le concept de « civilisations supérieures »
dans l'histoire humaine puisse être sujet à débat, ces
préoccupations ajoutent une couche de profondeur à ces craintes.
Ainsi les intentions des entités peuvent être totalement
bienveillantes mais provoquer malgré tout des conséquences
négatives. Le narrateur de La Sentinelle a l'air persuadé
que l'humanité ne va pas tarder à recevoir la visite de ces êtres
supérieurs. Mais quand on prend en compte l'âge colossal de la
pyramide et le nombre potentiellement énorme de formes de vie
éparpillées à travers la galaxie, il est aisé de douter de cet
espoir. Qu'est-ce qu'une énième planète abritant un frémissement
d'intelligence pour ces êtres si vieux qu'ils ont dû oublier depuis
longtemps ces vieilles préoccupations ? L'espoir du narrateur
est représentatif d'un fait important : dans La Sentinelle,
l'humanité n'a pas appris l'humilité. Il est tentant d'imaginer les
gouvernements humains se préparant à recevoir en fanfare des
« émissaires » venus s’intéresser à la
passionnante civilisation humaine. Mais cette vision des choses n'est
qu'une illusion, la vérité étant probablement que l'humanité est
insignifiante pour des êtres si vieux et ayant tant voyagé. Dans
2001, l'humanité est un peu plus modeste puisque c'est elle
qui envoie des émissaires vers Japet, n'attendant pas qu'on vienne à
elle. Cependant, il n'y a pas grand chose sur le satellite de Saturne
si ce n'est une version géante du monolithe. Quand David Bowman s'en
approche, il ne se passe rien pendant un moment. Puis le voilà
transporté à l'autre bout de la galaxie où une entité lui
accordera quelques instants pour lui faire franchir un grand pas
évolutif avant de le renvoyer d'où il vient. Ce premier contact est
très représentatif du peu d'importance de l'humanité. Ce ne sont
pas les autres qui viennent à nous, mais c'est l’émissaire humain
qui est amené à eux par ce qui ressemble plus à un système
automatique qu'a une volonté consciente. De leur mode de vie, de
leurs structures de pensées, on ne saura rien, juste qu'ils en
savent assez sur les humains pour pouvoir les transformer avec
aisance en êtres éthérés. Ils ne s’intéressent pas à l'homme,
mais à son potentiel futur. Ils ne viennent même pas voir la Terre,
pouvant certainement se la représenter aisément pour avoir vu un
grand nombre de ses semblables. La fin du roman sonne comme un écho
de son début, ces intelligences supérieures donnant à l'humanité
un second élan évolutif, puis laissant les choses se faire d'elles
même.
La
nouvelle La
Sentinelle
et le roman
2001
L’odyssée de l'Espace
sont
donc étroitement liés, que ce soit par leur trame générale, leur
vision de la lune, le fait d'avoir un ancien artefact au cœur de
leur intrigue ou l'aperçu d'intelligences supérieures. Mais entre
les deux textes la vision de l'auteur a changé et évolué,
influencée par les progrès technologiques et la création en
parallèle d'une œuvre jumelle utilisant un autre média. Mais
surtout on constate dans 2001
un vaste et riche développement d'idées qui n'avaient été
qu’effleurées dans la nouvelle. Entre ces deux textes on sent
comme un grand pas évolutif, à l'image de l'action du monolithe
dans 2001.
L'influence de cet œuvre se partageant deux médias est énorme dans
le domaine de la fiction, mais parfois aussi dans des domaines plus
surprenants. Ainsi, à les Eyzies en Dordogne, devant le musée
national de préhistoire, légèrement à l'écart, on peut
admirer un monolithe noir placé là l'air de rien, comme n'importe
quelle statue pourrait l’être. Un clin d’œil de l'Histoire à
l'histoire.
Sources
Arthur C. Clarke, La Sentinelle dans Les neuf
milliards de noms de Dieu et autres nouvelles, Librio
Arthur C. Clarke, 2001 l’odyssée de l'espace,
j'ai lu
Arthur C. Clarke, 2010 odyssée deux, j'ai lu
Piers Bizony, 2001 le futur selon Kubrick,
Cahiers du cinéma
Libellés :
Clarke Arthur C.,
Littérature,
Mes p'tits essais
Inscription à :
Commentaires (Atom)