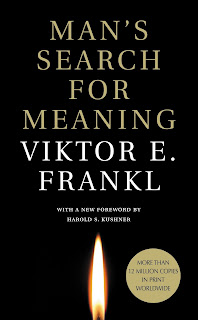jeudi 29 août 2019
Man's Search for Meaning - Viktor Frankl
Man's Search for Meaning est divisé en deux parties. La première, écrite en neuf jours peu après la guerre, est un compte-rendu de l'expérience des camps de concentration et d'extermination d'un point de vue psychologique. Personnellement, j'associe ma connaissance des conditions de vie dans les camps essentiellement à Maus d'Art Spiegelman, que j'ai lu et relu de nombreuses fois pendant mon enfance. Sans surprise, les points communs entre les deux ouvrages sont légion. Chez Frankl, l'écriture est sobre, détachée, et je peux comprendre pourquoi ce petit texte a eu autant de succès. Notons qu'il n'est imprégné d'aucune colère, au contraire, il se termine sur l'exemple d'un directeur de camp qui, malgré sa position, faisait preuve d'une certaine humanité, et qui à la libération a été sauvé par ses propres détenus. Une telle conclusion n'est pas un hasard, et elle est habillement choisie pour marquer et interroger le lecteur.
La seconde partie est un petit essai présentant la théorie psychothérapeutique de l'auteur, la logothérapie. En gros, il s'agit de soigner mentalement en cherchant pour l'individu du logos, du sens. Franchement, ça me laisse plus que sceptique. Déjà, pas besoin d'être un psychologue surentrainé pour saisir que oui, en effet, l'idée de sens est importante pour un équilibre mental à long terme. Mais surtout, il échoue à donner à sa doctrine cohérence et profondeur. Exactement comme Jung dans son autobiographie, il se contente surtout de mentionner des anecdotes de thérapie, et on a juste l'impression qu'il est un homme intelligent et pénétrant qui, parfois, arrive à comprendre suffisamment l'esprit pour parvenir à aider des gens troublés.
Autre chose qui me chiffonne : la façon dont est traitée la religion. Frankl est un croyant, mais il ne l'affirme jamais clairement, il se contente d'allusions. Or, c'est extrêmement frustrant dans un ouvrage qui traite du sens. En effet, si Frankl croit en un Dieu, un principe créateur premier, alors il l'a, son logos, son univers raisonné et ordonné ! Mais il ne fait jamais ce lien entre les micro logos du thérapeute, par exemple vivre pour prendre soin d'un enfant, et le logos total du croyant. Comment est-ce possible ? S'il est croyant, c'est l'univers entier qui est sensé, et le logos inclut toute la création. Qu'il l'assume, bon sang. D'autant plus que le sujet des camps, mixé à un sous-texte clairement déiste, ne peut que mettre en avant le problème du mal, qu'il ne prend pas la peine d'aborder.
Un autre problème de cette logothérapie, qui a l'air de se concentrer sur des petits logos propres à chaque individu. Frankl évoque lui-même ce problème : « Woe to him who found that the person whose memory alone had given him courage in the camp did not exist anymore ! Woe to him who, when the days of his dreams finally came, found it so different from all he had longed for ! » En effet, ces petits logos sont fragiles. On peut penser à la place à la valeur de la position existentialiste : embrasser l'absurde, faire le deuil du sens, pour devenir créateur de son propre sens. Ou, bien sûr, à la position stoïcienne, dont Frankl se rapproche parfois, Man's Search for Meaning étant souvent considéré comme un représentant du stoïcisme moderne. Une belle phrase qui résume la posture : « It is not freedom from conditions, but it is freedom to take a stand toward the conditions. » Ici, je n'ai à redire.
lundi 26 août 2019
Watership Down - Richard Adams
La plupart des personnages de Watership Down (1972) sont des... lapins. Dans l'ensemble, ce best-seller est un mélange étonnant, qui fonctionne très bien. Les lapins sont clairement anthropomorphisés, mais pas totalement : ils restent un peu bêtes, il y a certaines chosent qu'ils ne comprennent que difficilement, comme la flottaison du bois. Le ton est clairement adulte, mais encore une fois, pas totalement : on est souvent sur de l'aventure assez simpliste, et il règne une ambiance bon enfant, où tout est bien qui finit bien.
La partie de Watership Down la plus prenante à mes yeux, ce sont les diverses sociétés lapines explorées. Tout commence dans une chefferie classique : un leader fort, une caste de guerriers jouissant de privilèges, et le reste, les lapins communs. Mais notre héros, Hazel, et ses compagnons, vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ils forment une chefferie plus libérale, plus susceptible de plaire au lecteur car plus proche des formes occidentales du pouvoir contemporain. Ils rencontrent tout d'abord une société dystopique classique : des lapins échangent leur liberté contre la facilité : ils se font nourrir par des humains, mais savent qu'ils ne mourront pas de vieillesse, mais dans des collets. C'est, entre autres, le même schéma que dans La Machine à Explorer le Temps de Wells. Et enfin, le gros morceau : une société totalitaire dont le leader devient le principal antagoniste.
Watership Down est globalement enthousiasmant : on se prend rapidement de sympathie pour ces petits lapins en quête de liberté (et de femelles). Ils sont chacun caractérisés avec des ficelles un peu grosses, mais bon, ce sont des lapins, alors ça passe.
Dans la seconde moitié, l'intérêt baisse un peu, la faute à trop de temps passé dans des aventures banales, c'est à dire essentiellement des questions de déplacement dans la forêt ou les prés. C'est un peu lassant. Aussi, ce livre me faisait parfois penser : « Hey, si j'avais des enfants, je leur mettrait ce bouquin entre les mains. » Mais cette intention était un peu refroidie par le traitement des personnages féminins, essentiellement des utérus sur pattes. Enfin, une ou deux lapines ont vaguement l'occasion d'exister en tant que personnages, et après tout il est questions de lapins, ça passe. Reconnaissons aussi la façon habile dont est traité l'antagoniste : développé, il en devient touchant et on comprend sa position idéologique.
Vraiment, sans être parfait, Watership Down est sans doute une étrangeté plus que digne d'intérêt.
dimanche 25 août 2019
The Demolished Man - Alfred Bester
Le point de départ attise la curiosité, et la première partie du roman, c'est à dire l'accomplissement du meurtre et le bras de fer entre Reich et Powel, flic Esper, parvient à captiver. L'écriture, vive et souvent expérimentale, accroche. Mais plus ça avance, plus tout ça semble confus et incohérent. Ça dégénère dans des allures de courses-poursuites fourre-tout, où les bonnes idées, balancées en vrac, ne parviennent pas à enlever une impression de superficialité. La fascination de l'auteur pour la psychologie à tendance freudienne est franchement déconcertante et tourne même vers le malsain dans la vague relation amoureuse entre Powel et une jeune femme perturbée. Toute la trame repose en fait sur des délires d'inconscient, de supra-conscient... Ça n'a pas très bien vieillit et ne fait guère sens.
Notons néanmoins une scène particulièrement saisissante vers la fin : Powel prend contrôle de l'esprit de Reich, et lui inflige l'illusion que l'univers s'auto-efface sans que personne d'autre que Reich le remarque. Une façon radicale de le heurter au cœur de son ambition démesurée : conquérir l'ensemble du monde humain. Probablement le meilleur passage du livre.
samedi 24 août 2019
The Cellist of Sarajevo - Steven Galloway
Dans The Cellist of Sarajevo (2008), il est question du siège de Sarajevo, chronologiquement resserré par l'auteur. Les forces serbes entourent la ville, bombardent, et les snipers font régner la terreur. Un évènement authentique sert de fil conducteur aux trois arcs narratifs : un violoniste décide de jouer chaque jour pendant 22 jours là où 22 personnes ont été tuées par un obus en faisant la queue pour leur ration de pain.
La peinture de Sarajevo pendant ce long siège se concentre essentiellement sur le quotidien des civils, à travers deux personnages qui passent leur temps à marcher dans les rues. L'un va chercher de l'eau pour sa famille, et l'autre un repas gratuit à la boulangerie où il travaille. Il faut bien avouer qu'au bout d'un moment c'est un peu répétitif : les deux hommes marchent dans les rues sous la menace perpétuelle des bombardements et des snipers. Mais du coup, il est pertinent que le troisième fil narratif concerne justement une sniper. Elle est directement actrice dans le conflit. Par son intermédiaire, l'auteur explore la radicalisation des défenseurs, qui adoptent les pratiques moralement questionnables des assaillants. Elle est aussi impliquée dans un duel de snipers pour protéger le violoniste, ce qui donne lieu à quelques scènes de tension bien menées, très cinématographiques. Par contre, je n'ai pas aimé la conclusion choisie par l'auteur pour ce personnage : elle perd sa pulsion vitale, et se résigne à se faire assassiner par ses frères d'armes bosniaques, pour qui elle est devenue trop modérée. Une conclusion à mon sens gratuitement déprimante, ou en tout cas mal amenée.
La lecture de ce bouquin est, par contre, clairement enrichissante. On ressent vraiment toutes les fissures qui imprègnent les populations des Balkans, à quel point la guerre est civile. Et la haine se faufile toujours dans l'esprit :
You could hate a person for what they did. You could hate a murderer, you could hate a rapist, and you could hate a thief. This was what first drove her to kill the men on the hills, because they were all these things. But know, she knows, she's mainly driven by a hatred of them, the idea of them a group, and not by their actions.
 |
| ATTENTION !! SNIPER Photos prises en photo à Sarajevo |
Libellés :
Galloway Steven,
Littérature,
Univers réaliste
samedi 3 août 2019
Girl at War - Sara Nović
1990, Zagreb, Croatie. Ana, une dizaine d'années, vit paisiblement avec ses parents. C'est l'époque, et le genre d'endroit, où les enfants peuvent encore passer leurs journées à jouer entre eux dans les rues, sans supervision. Mais la Croatie veut se détacher de la Yougoslavie, et les forces serbes, aussi bien que les nationalistes serbes habitant la Croatie, ne sont pas de cet avis. La guerre commence.
La première partie de Girl at War (2015) décrit la vie d'Ana et de sa famille dans la guerre naissante, le quotidien du civil embarqué dans un conflit dont il se passerait bien, et se conclut sur la mort des parents d'Ana, tués par des milices serbes. Ana survit en faisant la morte à côté des cadavres de ses parents. C'est excellent : la guerre à moitié civile vue du point de vue d'un enfant accroche brutalement. Mais ensuite, Sara Nović fait le choix de bousculer la chronologie pour passer à dix ans plus tard, quand Ana étudie l'anglais à New York. C'est frustrant, parce qu'il est évident que l'auteure manipule son lecteur : on comprend qu'Ana s'est retrouvée enfant-soldat, et qu'il faudra attendre plus loin dans le roman pour en apprendre plus. On a vraiment l'impression d'un artifice littéraire dont le seul but est de créer du suspense. Et du coup, on comprend moins bien Ana car on ne sait pas pas encore ce qu'elle a vécu. J'ai eu du mal à m’intéresser à la jeune femme qu'est devenue Ana. Certes, on comprend qu'elle ait des problèmes, mais elle apparait presque plus comme une ado confuse que comme porteuse d'un trauma de guerre. Des phrases comme « Had I died in the forest, at least I would be with my family and ignorant of such profond loneliness. » ou « I basically broke up with my last boyfriend because he was too nice. », au lieu de créer une dynamique pertinente de conquête d'un trauma, font un peu soupirer.
Ensuite on retourne en arrière, quand Ana, ses parents morts, se retrouve isolée dans un village pris dans le tourbillon de la guerre. Une femme prend soin d'elle, et elle se retrouve d'abord à assister les villageois transformés par la force des choses en milice, puis à porter et utiliser un AK. On est loin de l'idée qu'on peut se faire de l'enfant-soldat africain, rendu meurtrier instable par un abrutissement aux drogues. Dans le village, tout le monde prend les armes pour se défendre dans une guérilla permanente. Les gens qui font d'Ana un soldat ne sont pas malveillants, il ne veulent pas l'envoyer à la mort. Ils font simplement partie d'une petite communauté forcée à la violence, où toute paire de mains valides peut faire la différence. Et Ana trouve dans la manipulation de l'AK un dérivatif efficace pour faire le deuil de ses parents. Pour la quatrième et dernière partie, retour dix ans plus tard, où Ana retourne en Croatie pour faire la paix avec son passé. C'est un peu moins intéressant.
Vraiment, c'est dommage que les passages avec Ana adulte échouent, à mon sens, à captiver autant que ceux avec Ana enfant. Ses tourments émotionnels restent flous et difficilement saisissables. J'aurais bien vu là l'occasion de plonger dans les détails du conflit et dans les méandres de la violence humaine, Ana cherchant la paix par la compréhension. Mais c'est me projeter sur Ana.
Inscription à :
Commentaires (Atom)