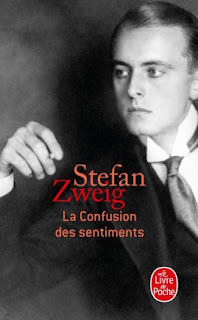|
En maraude...
|
Premier jour, début aout juillet.
Anne-Aël nous dépose Siméon et moi à Montreuil-le-Chétif ; hop, nous voilà sur la route. Je ne connais pas la région, c'est la première fois que j'y mets mes pieds usés. Notre direction, c'est au nord, les Alpes mancelles : un simple ravin qui, dans le coin, fait office de montagne. Il parait que les villages sont mignons. Siméon n'a guère l’habitude de ce genre d'aventure pédestre, ainsi il me laisse tenir les reines, c'est-à-dire le petit écran qui parasite ma poche droite et où s'affiche la carte qui me sert trente fois par jour. Ce n'est pas pour me déplaire, j'aime les cartes, j'aime les manipuler, j'aime choisir où aller, quel chemin tenter, quelle piste suivre.
Nous ne sommes même pas sortis du village que déjà je traine Siméon dans un charmant verger, où j'observe les fruitiers. Ce sera récurrent : des vergers, nous allons en croiser. Quelques cerisiers du coin sont encore en fruit, notamment une variété jaune, dont nous faisons un premier festin un peu plus loin. Nous allons jusqu'à sauter pour tirer les branches vers le bas. Les petits fruits sont excellents, et bien entendu, ils sont toujours meilleurs quand ils sont récoltés en maraude, n'en déplaise à Saint Augustin.

Ensuite, nous vivons une après-midi hautement édifiante. Dans un champ au bord de la route, nous apercevons un chevreuil allongé sous un énorme tilleul, spectacle improbable, tellement improbable d'ailleurs que le doute n'est pas permis : la créature est morte. Comme les mouches vertes, nous sommes très attirés par le spectacle de la mort, aussi décidons-nous d'enjamber le talus — ici peu praticable — pour aller nous instruire. La bête, figée dans la rigor mortis, a l'apparence dormeuse du sommeil, et Siméon évoque à propos Le Dormeur du val. Alors que, comme un charognard, je tourne curieusement autour du cadavre, il me semble que ses yeux me suivent, comme si, seuls, ils vivaient encore. Illusion troublante qu'un examen plus approfondi vient dissiper. Nous constatons que la bête s'est prise dans le câble électrique qui sépare deux champs, et que, dans sa panique, sous les coups de poignard de l’électricité, elle s'est étranglée elle-même. Je touche l'un de ses sabots. Nous repartons.

Après la mort, nous rencontrons la vie naissante, jeune et frétillante. Alors que nous nous trempons les pieds sous le pont de Douillet, des couinements indéfinissables émergent des fourrés. Craignant une chienne ou une laie avec des petits, nous commençons tranquillement à décamper quand deux minuscules chiots émergent en couinant, cette fois, joyeusement. Ils se jettent sur nous comme si nous étions leurs parents. Je songe au processus évolutionnaire qui a favorisé non seulement ce comportement — la familiarité instantanée avec les humains — mais aussi les traits physiques qui appuient sur les bons boutons dans notre cerveau. Certainement, ces chiots abandonnés descendent de nombreux chiens qui ont dû passer avec succès cette épreuve. Nous sommes attendris, certes, nous aussi sommes faits pour ça. J'hésite à leur donner une boite de thon, mais ils ont l'air bien portants, sans doute ont-ils été abandonnés quelques heures auparavant au maximum, et je crains qu'ils se mettent à nous suivre jusqu'au bout du monde si je les nourris. Alors que nous repartons, hésitants, ne pouvant guère faire mieux que prévenir les prochaines personnes que nous croiserons, la situation se résout d'elle-même. Une petite famille s'arrête là pour faire du kayac avec leur oie de compagnie (oui oui). Nous les mettons au courant de la situation, et voilà, ils adoptent les chiens, dans l'instant. Ils sont moins détachés que nous je suppose. Une étonnante scène se déploie sous nos yeux : une mère avec un chiot dans les bras, un fils avec un chiot dans les bras et une fille avec une oie dans les bras.

Vraiment, difficile d'imaginer meilleure leçon de vie. Si j'étais un père promenant sa progéniture, je la jugerais plus instruite par cette journée que par une semaine d'école. Après Sougé-le-Ganelon, nous continuons à travers ces longues collines monoculturées jusqu'aux portes des Alpes mancelles. La nuit tombe, et nous posons la tente au niveau d'un départ de canoé, près d'un pont qui précède de peu Saint-Léonard-des-Bois. Bien qu'au bord de la route, nous sommes au calme. Une fois les chaussures retirées, nous filons plonger les pieds dans la Sarthe, ici fine et transparente. Alors que Siméon reste mélancoliquement assis au bord de la rivière — songeant sans doute à sa finitude — je pars traverser l'eau jusqu'à l'autre rive, passant de rocher en rocher, puis remontant le courant. J'aime me baigner dans les rivières claires, à l'ombre des arbres qui s'en abreuvent — guère ailleurs.
Second jour.
Nous pourrions être à Saint-Léonard-des-Bois en quinze minutes, mais nous prenons un détour, car nous sommes là pour marcher, explorer, prendre notre temps. Il s'agit de traverser le pont de façon à aborder ensuite Saint-Léonard-des-Bois de l'ouest, via la butte de Narbonne. Nous maraudons toujours, et toujours des cerises jaunes. Encore de nombreux vergers, que nous explorons avec passion, et nous évoquons les nombreuses plantes sauvages comestibles qui bordent le chemin. Siméon continue à m’éduquer sur les frênes, que jusque-là j'avais toujours été incapable d'identifier. Dans les bois, les premiers du séjour, l'ambiance change, et une gigantesque greffe naturelle s'offre à nous : un tronc double qui fusionne à nouveau au-dessus de nos têtes. Je songe à notre ancêtre vaguement commun qui, il y a 4000 ans peut-être, s'en est inspiré pour la première greffe. Nous grimpons sous les arbres jusqu'à nous trouver sur la butte que nous voyions de loin. Tout d'abord, de l'autre côté, un vaste pierrier, chaos rocheux, puis la plaine et ses cultures, et, enfin, Saint-Léonard-des-Bois, encaissé mais pas étouffé, adorable en somme. Siméon trépigne, il veut un café, alors nous descendons.

Assis en terrasse, seuls sur la place du village, nous nous étonnons de toutes ces photos de voitures qui sont affichées un peu partout. Le Mans fait rayonner la culture des 24 heures, je suppose. Siméon ne prend pas un, mais deux cafés ; je fais de même, il m'entraine dans sa débauche. C'est aussi l'occasion de se ravitailler, notamment en fromage frais local. Nous en consommerons plusieurs au fil du séjour, agrémentés différemment. Ensuite, un petit tour dans l'église, qui est largement au-dessus de la moyenne, grâce à ses peintures murales assez bien conservées. Divers motifs se déploient dans un déchainement de doré pâle et de bordeaux délavé, entrecoupés par des scénettes. J’apprécie particulièrement le serpent, qui trône en bonne place, et je m'interroge sur sa signification. Pour payer l'allumage d'un lampadaire qui éclaire d'antiques statuettes, Siméon fait preuve d'une morale chrétienne exemplaire en insérant une petite pièce dans la fente consacrée.

Ensuite, nous filons en direction du canyon, encore une fois arrêtés par de jolis et antiques vergers. Plus émoustillant encore, le Domaine du Gasseau nous plait suffisamment pour que nous nous y arrêtions déjeuner. Il s'agit d'une sorte d’hôtel-restaurant agrémenté de diverses activités d'extérieur et d'un superbe jardin, c'est bien entendu ce dernier qui nous arrête. C'est un jardin qui a plus une vocation éducative que productive, ce qui ne l'empêche pas d'être aguichant, et ça a l'avantage de m'enlever tout remord quand je me sers allégrement en groseilles. Pendant que Siméon, comme il l'a déjà fait hier au bord de la Sarthe, fait un petit enregistrement sonore pour ses sonnets sur écoute, j'explore. Tout est planté dans un désordre ordonné, entièrement mulché, de façon très permaculturelle. De multiples aromatiques cohabitent avec les tomates, les kiwis s'élèvent sur des pergolas de métal, les baies longent les murs et laissent la place à des poiriers palissés, le coin des courges accueille comme mon propre potager des courgettes blanches d'Égypte, et les haricots grimpent sur les filets tenus par des bambous. Il tombe une petite pluie et nous décidons de manger ici, sur une énorme souche transformée en table et protégée par un modeste pare-soleil qui nous sert de pare-à-pluie.

En sortant, je découvre un mûrier — l'arbre, pas la ronce — qui donne des baies noires énormes, bien plus grosses que celles des morus alba pendula qui chez moi m'en ont donné abondement un peu plus tôt, car plus au sud. Je suis profondément ému en constatant que, bien que l'arbre soit dans un coin fortement passant de la propriété, les baies non cueillies tapissent le sol d'une purée noire. J'en dévore avidement des poignées entières sous le regard désapprobateur des adultes qui gardent une classe ou une colo juste à côté ; moi, je suis persuadé de donner le bon exemple.

Alors que nous reprenons notre marche le long de la Sarthe, nous tombons sur une haie de noisetiers — phénomène fréquent dans les environs — et de cornus mas, cornouiller mâle (qui par ailleurs n'est pas particulièrement mâle). Je songe douloureusement au cornouiller mâle que j'ai planté chez moi, en compagnie de feijoas et de pêchers. Après avoir abattu une petite partie de notre interminable haie de cyprès, il s'agissait de voir ce qui pouvait pousser entre les souches de ces résineux, et si les feijoas semblent à leur aise, le cornouiller mâle m'a l'air de tristement décliner. Siméon me montre comment identifier l'arbre en observant les filaments des feuilles qui se maintiennent quand on la déchire, à la façon du grand plantain. Cette haie est vraiment régulière, noisetiers alternant avec cornouiller, alors, suspicieux, je regarde au sol, et je découvre la bâche de plastique qui a servi à la plantation. Les arbres ont sans doute plus de 10 ans, voire plus de 15, mais le plastique est toujours là, seulement recouvert par ce qui lui tombe dessus au fil des années.

Nous traversons la Sarthe dans un bac à chaine, moment presque anachronique, afin de faire une petite boucle de l'autre côté de la rivière jusqu'à un belvédère. Il faut grimper sous la pluie fine, rejoindre le plateau où les monocultures habillent les douces collines, être tenté par des cerises jaunes inatteignables et des mirabelles pas encore mûres, avant d'atteinte le haut du canyon qui nous offre une vue dominante sur les méandres profonds de la Sartre et ses pierriers. Puis petite boucle, jolis vergers, retour de la pluie et nouvelle traversée en bac, dans lequel nous trouvons une belle carte IGN du secteur dans un étui plastique, qui fait la joie de Siméon.

Alors que nous faisons enfin face à nos côtes les plus importantes jusque-là — les Alpes ! — nous tombons sur des cerisiers sauvages particulièrement âgés et, surtout, un néflier sauvage. Je crois que c'est la première fois que j'en voie un libre, dans la nature, mais il faut bien avouer qu'il y a encore deux ans je l'aurais sans doute passé sans rien remarquer. Puis, le long du chemin, au bord d'un verger abandonné, c'est une greffe qui attire mon attention. Du moins, une tentative de greffe, car c'est un échec. Je m'y penche, et les raisons sont évidentes. Le porte-greffe est un cerisier sauvage épais de quatre ou cinq centimètres et la technique utilisée est la greffe en fente. Tout d'abord, ce qui attire immédiatement le regard, ce sont ces gros bouts de bois attachés au porte-greffe : c'est pour empêcher les oiseaux de se poser sur la greffe, une supposée astuce qu'on lit dans les livres non spécialisés, mais qu'aucun pro ne s'embête à pratiquer. J'examine la greffe de près. Il est évident que la greffe en fente est extrêmement traumatisante pour l'arbre, d'autant plus quand, comme c'est le cas ici, le greffon est de très petite taille : le plus gros de la blessure est parfaitement inutile et ne peut que nuire à la greffe, laissant fuir l'eau et rentrer les maladies. En regardant de côté, on peut même voir de l'autre côté du tronc à travers la fente. Dans ce cas, il aurait fallu faire une greffe en couronne, qui aurait été beaucoup moins traumatisante. La taille du greffon est adaptée, et il y aurait eu la place d'insérer au moins trois greffons, multipliant ainsi les chances de succès. D'ailleurs, même en fente, il aurait fallu mieux remplir la blessure avec au moins un greffon supplémentaire, de l'autre côté.

La pluie commence à tomber sérieusement et, à l'occasion d'une pause sous la canopée, nous nous équipons en conséquence. C'est parti pour durer, il faut continuer. L'arrivée humide à Saint-Céneri-le-Gérei ne nous empêche pas de constater que le lieu est particulièrement esthétique, on comprend pourquoi il a inspiré les nombreux peintres qui avaient l'habitude de s'y retrouver et de peindre sur les murs de l'auberge locale, conférant sa réputation au village. Nous arrivons au bar — car ce village de 120 habitants a bel et bien un bar très vivant — et, face à la pluie, nous nous y réfugions, après une tentative avortée de nous installer en terrasse. Là, pendant toute la fin de journée, nous papotons en avalant des pintes. La clientèle me semble être une sorte de bourgeoisie artiste, installée là sans doute grâce à l'histoire particulière du village. Les gens sont très accueillants et nous parlons avec plusieurs d'entre eux, notamment pour nous renseigner sur où passer cette nuit mouillée, jusqu'à finalement grignoter notre dîner dans le bar. Nous faisons la fermeture, peut-être à 20h, et engageons la conversation avec le dernier client qui traine en terrasse, incarnation même de l'artiste bourgeois. Rapidement, nous nous retrouvons à passer la nuit chez lui. Il est couturier et, dans sa « résidence d'artistes », il nous confie à une sorte de cabane de jardin reconvertie en chambre d'extérieur habillée de tissus à motifs panthère. Mais avant, il allume un barbecue, nous laisse gérer la cuisson des brochettes, et nous avons l'occasion de papoter un peu plus. Modeste, il refuse de parler de lui et nous conseille d'utiliser Google si nous voulons satisfaire notre curiosité. Il parle plutôt de Dieu, de l'art, des oiseaux qui nichent dans un arbuste à côté, etc. Nous faisons de notre mieux pour maintenir la conversation avant d'aller nous coucher dans la cabane, où j'utilise des rouleaux de tissu comme couverture.

Troisième jour.
Le matin venu, nous laissons un mot de remerciement et prenons le temps de visiter Saint-Céneri-le-Gérei avant de reprendre notre pérégrination. Après le café au bar, le même qu'hier, nous montons dans le village, vers la butte qui héberge l'église, fermée pour rénovations. Plus que jamais le village est adorable, fleuri, riche en belles maisons, et la vue depuis la butte est encore plus charmante et verdoyante que celle de la veille.

Nous redescendons vers la chapelle qui s'élève sur une langue de terre entourée par les méandres de la Sarthe, ici un peu plus profonde que la veille. De l'autre côté de la rivière, inaccessible, se trouve une source miraculeusement créée par Saint Cénéri, selon la légende. La chapelle, sobre, est dédiée au saint, qui est réputé pour soigner les problèmes d'incontinence et les troubles de la vision. Ce qui m'interpelle particulièrement, ce sont les nombreux petits papiers où les visiteurs croyants laissent leurs souhaits. Ces papiers sont épinglés à la robe d'une statue de Saint Cénéri, ou juste laissés là, sur la table. J'en lis autant que possible, fasciné par cet aperçu de la vie intérieure d'une foule de gens qui offrent là un échantillon vif de leurs peurs et de leurs désirs. Je relève quelques phrases :
Merci d'aider Lucas de devenir un jeune homme qu'il grandit dans sa tête qu'il vienne au [?] et à l'école. Merci.
Merci de veiller sur nos familles, amis et personnes qu'on aime !
I wish to have a good [?] friends and for my basketball career to become famously good and worldwide. Amen.
Merci de m'aider dans cette épreuve pour retrouver un travail et un toit dans la Sarthe. Merci pour tout.
Saint Cénéri, protégez notre terre, souriez-nous, sauvez les âmes innocentes de ce monde.
Protège ma fille fille [?] afin qu'elle soit toujours en bonne santé !
Saint Cénéri, faites en sorte que le pipi au lit la nuit pour Louis s'arrête. Je vous remercie.
Aide-moi à toucher ma part de la maison le plus rapidement possible. Amen.

Siméon fait un petit enregistrement sonore pendant que j'essaie de le prendre en photo d'une façon qui parvienne à rendre la majesté des arbres qui s'élèvent sur la pente de l'autre côté de la rivière et souligne le contraste avec l'étendue lisse et tondue où se trouve la chapelle. Ensuite, nous entamons notre mouvement de demi-tour. Au lieu de nous faire descendre au fond du canyon, je nous fais passer par les hauteurs, où quelques pistes isolées pourrait faire croire que nous sommes plus au sud. Je rate un tournant, et nous revoilà au fond du canyon, puis au Domaine du Gasseau, où une fois de plus je me gave de mûres en piétinant toutes celles qui, trop matures et sans personne de motivé pour les manger, sont tombées au sol. A Saint-Léonard-des-Bois, nous rachetons du fromage frais et allons le manger au bord de la Sarthe, où nous faisons sécher la tente. Nous avons aussi une vue parfaite sur les toilettes publiques où se déroule un vrai feuilleton : une mère est coincée à l'intérieur avec sa fille, et des agents de la ville tentent de les délivrer. Nous en profitons pour nous doucher dans les douches publiques, c'est très pratique, d'autant plus que les verrous ne se bloquent pas avec nous à l’intérieur.

Avant de quitter les Alpes mancelles, nous faisons une boucle par le Haut Fourché, la falaise qui domine Saint-Léonard-des-Bois à l'est. Une fois que nous dominons le village, nous faisons face à la butte de Narbonne, par laquelle nous sommes arrivés la veille. Une fois redescendus, et le village traversé une dernière fois, nous partons en direction de Fresnay-sur-Sarthe, où nous avons rendez-vous avec Anne-Aël le lendemain pour le retour. Pour éviter les routes goudronnées, qui ceci dit ne sont pas si mal dans la région, nous faisons un détour par un GR. Le soir, la tente est plantée dans un champ extrêmement calme, à côté de quelques vaches et d'une population de cerisiers sauvages à petits fruits noirs séchés sur l'arbre et à priori comestibles ; peut-être Prunus padus. Un chevreuil lâche des aboiements frappants et détale à une dizaine de mètres de la tente. Durant la nuit, un autre, ou le même, nous réveille avec des cris similaires.
Quatrième jour, et ensuite.
Le lendemain, nous continuons vers Fresnay-sur-Sarthe par des chemins calmes. Seule chose notable, une motte féodale à Assé-le-Boisne, sur laquelle Siméon fait un petit enregistrement sonore pendant que je sors un Zola. J’apprécie que la motte soit recouverte d'arbres fruitiers assez anciens pour la plupart. Nous arrivons à Fresnay-sur-Sarthe en passant par le Coteau des Vignes, où trône un charmant verger, mais aussi quelques pommiers, directement sur la pente du coteau, et, plus haut, des mirabelliers. Dernier évènement : au bord de route, reste d'une antique haie sans doute, un gigantesque cormier, fruitier méconnu. Celui-là impressionne par sa majesté et on distingue les jeunes cormes accrochées à ses branches. Je soupçonne que celui que j'ai planté sur mon terrain n'atteindra jamais cette taille de mon vivant.

Quelques jours plus tard, Siméon habitant littéralement juste à côté d'un château, nous passons voir le châtelain, ou plutôt son terrain. C'est un ami du châtelain qui nous accueille, un bourgeois potentiellement très chrétien (comme le châtelain) qui habite à Versailles. Il vient parmi tous les hectares de son ami exercer sa passion du jardin, et passionné il est, c'est évident. Il déborde d'énergie et parle avec flamme. Il nous montre le petit potager qu'il a façonné et clôturé, plus qu'honorable en partant de rien. Mais, surtout, la raison pour laquelle nous sommes là, le verger : il était complètement abandonné il y a encore peu de temps et le travail de réhabilitation a été phénoménal, mais rapide, grâce à la puissance irrésistible des énergies fossiles. Tout a été vigoureusement débroussaillé, les arbres nettoyés et taillés. Sur les murs qui entourent le verger, on devine d'un côté d'anciennes vignes, qui devaient recouvrir la pierre, et de l'autre des poiriers en espaliers, collés à la pierre, qui me rappellent la maison normande où j'allais autrefois passer mes vacances. De l'autre côté de ce mur, une autre partie du verger, encore envahie par les ronces qui avalent littéralement les pommiers et donnent une impression de jungle. Nous rentrons à la charmante et modeste location de Siméon et Anne-Aël, où leur petit triangle de terrain leur permet de planter quelques courgettes, haricots, concombres et tomates, dans l'ombre métaphorique du château. A l'intérieur, les bibliothèques fructifient peu importe sa saison.
 |
| Vue sur Fresnay-sur-Sarthe. |
 |
Bonus : c'est moi !
|