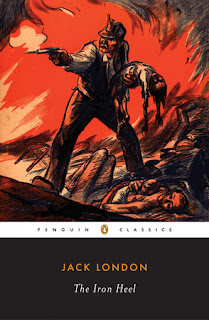Le genre de livre hautement complexe dont il n'est vraiment pas aisé de faire un compte-rendu. Tim Jackson commence dans une préface bienvenue par contextualiser son livre. A l'origine, c'est un rapport commandé par le gouvernement anglais. Mais remettre en cause la croissance, on s'en doute, n'est guère du goût des autorités qui mettent le rapport au placard. Pourtant, Tim Jackson attire l'intérêt d'un public venu d'horizons divers, et c'est sous forme de livre qu'il finit par faire passer ses recherches. Puis c'est partit : il s'attaque aux bases économiques et idéologiques de la société moderne.
L'idée de départ est fort simple : dans un monde aux ressources naturelles limitées que peut bien valoir le culte de la croissance perpétuelle ? « Vivre sur une planète finie ne peut se résumer à consommer toujours plus de choses. » (p.34) Les autorités politiques sont vaguement conscientes de ce problème et font quelques ébauches de solution, comme l'Accord de Paris : limiter l'augmentation de la température à 1,5°C d'ici la fin du siècle. Mais pour tenir cet objectif « les émissions cumulées de dioxyde de carbone dans l’atmosphère depuis 1870 doivent rester sous 2350 milliards de tonnes métriques. Or, 2000 milliards de tonnes métriques ont été émises jusqu'à présent. En d'autres termes, le "budget carbone" maximum disponible entre aujourd'hui et la fin du siècle n'est que de 350 milliards de tonnes. Au taux d'émission actuel, ce budget serait épuisé en une décennie. » (p.53) En des termes plus simples : c'est foutu d'avance.
L'auteur se tourne ensuite vers l'économie et le culte de la croissance, qui, en gros, n'est pas tenable et a mené à la crise de 2008. Il continue longuement à critiquer la croissance en incluant dans l'équation une vision plus humaine et altruiste de la notion de prospérité : « Aux États-Unis, le revenu réel par habitant a triplé depuis 1950, mais le pourcentage de personnes se disant très heureuses n'a pratiquement pas augmenté. Il est même en léger recul depuis les années 1970. Au Japon, la satisfaction de vivre n'a que peu évolué ces dernières années. Au Royaume-Uni, le pourcentage de personnes se disant "très heureuses" a baissé de 52% en 1957 à 36% en 2005, alors que les revenus réels ont plus que doublé au cours de cette période. » « Il semblerait que la croissance économique soit une sorte de "jeu à somme nulle". La population s'enrichit globalement. Certaines personnes s'en tirent mieux que d'autres et les positions peuvent changer dans la société. En revanche ce processus n'accroit que peu ou pas du tout le bien-être global. Nous pourrions même être tentés de qualifier la croissance économique de "jeu à somme négative", parce qu'au bout de compte les coûts environnementaux et sociaux du "jeu" peuvent produire des répercussions profondément négatives sur nous tous. » (p.91) « Le capitalisme affirme nous offrir une diversité des désirs. Mais cet élargissement du choix comporte une caractéristique clé : les objets du désir sont avant tout de nature matérielle. La liberté de ne pas consommer est parfois plus difficile à trouver que la liberté de consommer. De plus, une sorte de liberté peut en cacher une autre. La liberté de se déplacer systématiquement et partout en voiture empiète sur l'espace de ceux qui préféreraient aller à pied ou prendre le bus. La liberté de faire du shopping avec voracité empiète sur la sociabilité de l'espace public. La liberté de vivre une vie matérialiste sape notre liberté de comprendre les autres et de prendre soin d'eux. » (p.103)
Avec l'aide d'une série de graphiques très parlants, l'auteur entreprend de démontrer que si la richesse d'un pays est souvent synonyme de qualité de vie, elle n'est pas absolument nécessaire. L’Amérique du sud est à ce tire un bon exemple. En résumé, Tim Jackson mentionne certaines réalités : « les retours rapidement décroissants de la croissance au-delà d'un certain revenu, les immenses avantages de la croissance des revenus avant ce point et la performance remarquable de certains pays pauvres capables d'atteindre des niveaux de bien-être équivalents à ceux des pays les plus riches alors que leurs revenus sont plusieurs fois inférieurs. » (p.112) Ainsi, au-delà d'un certain point (que l'occident a sans doute dépassé depuis longtemps) l'accroissement de la richesse ne cause plus d'accroissement du bien-être. Et un petit point en passant sur les crises économiques : « les pertes humanitaires, quand il y a turbulence économique, pourraient dépendre d'avantage de la structure sociale et de la réaction politique que de la gravité de l'instabilité économique que subit le pays. » (p.113)
Ensuite, une notion que je suis ravi d'avoir appris : le découplage. Si j'ai bien compris (ce dont je ne suis pas certain : ce terme a l'air d'avoir un sens assez variable), il s'agit de l'idée selon laquelle le progrès technologique réduisant progressivement les coûts énergétiques de la production, il suffit de laisser la croissance faire son boulot et on arrivera automatiquement à une sorte de croissance verte. C'est le mythe selon lequel le progrès résout tous les problèmes. Mais, dans les faits, ça ne fonctionne pas : « La baisse de l'intensité carbonique a été "avalée" par l'augmentation de la production économique. » (p.124) Ainsi, « croire que la capitalisme possède une propension à l'efficacité qui nous permettrait de stabiliser le climat ou de nous protéger contre la rareté des ressources est aussi simpliste qu'illusoire. La vérité, c'est qu'il n'existe aucun scénario crédible, socialement juste et écologiquement soutenable pour faire croître en permanence les revenus de neuf milliards de personnes. » (p.134)
Tim Jackson se lance ensuite dans une critique du consumérisme. Pour aller vite, je me contenterai de citer une seule phrase : « La culture de la consommation se perpétue pour la raison précise qu'elle excelle dans l'échec. » (p.150) En effet, si l’acquisition matérielle subvenait avec succès à notre désir d'épanouissement, elle aurait une fin. Cette absence de fin, ce désir perpétuellement renouvelé, est la preuve qu'elle ne comble aucun besoin spirituel. En toute logique, l'auteur se penche ensuite sur la nécessité de poser des bornes à l'épanouissement humain. Et plutôt que consommer toujours plus, mieux vaudrait aller à l'encontre du mouvement d'atomisation des communautés et de la propagation de la solitude. Pour montrer que le consumérisme pousse dans un sens contraire à ces objectifs, l'auteur cite
The Living Standard de Amartya Sen. « Pour pouvoir mener "une vie sans honte, pour pouvoir visiter ses amis et se détendre avec eux, suivre le fil de ce qu'il se passe et ce dont les autres parlent, etc., il faut un ensemble de biens et de services plus coûteux dans une société globalement plus riche, dans laquelle la plupart des gens possèdent déjà, par exemple, un moyen de transport, de beaux vêtements, une radio et un poste de télévision, etc." En résumé, suggère-t-il, "Il faut parfois jouir de revenus (et de produits de base) élevés pour obtenir un même niveau de capabilités dans l'absolu."» (p.160) Ensuite, une explication du « prix élevé du capitalisme » selon le psychologue Tim Kasser : « Des valeurs matérialistes comme la popularité, l'image et la réussite financière s'opposent psychologiquement à des valeurs "intrinsèques" comme l'acceptation de soi, l'appartenance, le sens de l'inclusion dans une communauté d'individus, ces dernières étant notre source la plus profonde de bien-être. Elles sont les composantes de la prospérité. Les conclusions de Kasser sont frappantes. Les personnes vivant selon des valeurs intrinsèques plus élevées sont à la fois plus heureuses et plus responsables sur le plan environnemental que celles vivant au gré des valeurs matérialistes. » (p.162)
L'auteur se consacre longuement à proposer des solutions pour une prospérité sans croissance. Je vais m'abstenir de tenter de résumer la chose, ce ne serait pas joli à voir. L'ensemble, bien que souvent rapide voire élusif, est vraiment porteur de propositions. Reste à voir si l'humanité pourra se sortir à temps de ses dogmes. En attendant, on peut se tourner avec un plaisir quelque peu morbide vers la science-fiction.
258 pages, 2017 (2009 pour la première édition), deboek supérieur